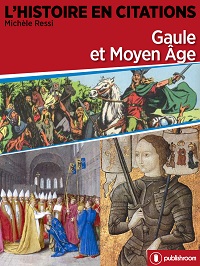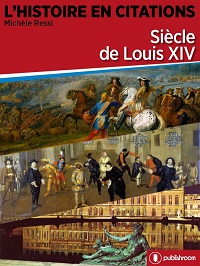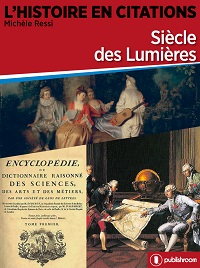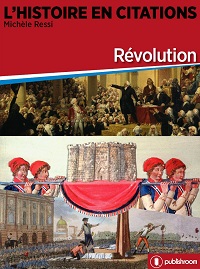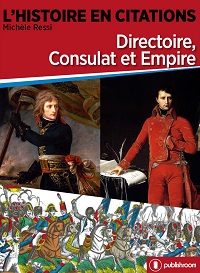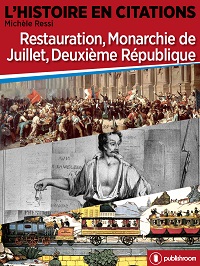« Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. » (proverbe romain)
Et pourtant, l’on ne cesse d’en débattre depuis toujours !
En deux semaines, vous allez en voir vraiment de toutes les couleurs et il y en aura pour tous les goûts, au fil des références factuelles, historiques et artistiques de la Gaule à nos jours !
En marge de l’Histoire en citations qui sert toujours de base, nous allons (re)découvrir les cathédrales polymorphes et les vitraux multicolores. Au-delà de la « peinture d’histoire » , catégorie reine du classicisme, l’histoire de la peinture nous donnera une vision sans cesse renouvelée des couleurs. Les modes évoluent, la musique et le cinéma s’invitent dans le jeu, le sport lui-même.
Et à la fin, c’est le bleu qui gagne.
GAULE
« Voici la ronde des jurons
Qui chantaient clair, qui dansaient rond,
Quand les Gaulois De bon aloi
Du franc-parler suivaient la loi,
Jurant par-là, Jurant par-ci,
Jurant à langue raccourci’,
Comme des grains de chapelet
Les joyeux jurons défilaient :
(Refrain)
Tous les morbleus, tous les ventrebleus,
Les sacrebleus et les cornegidouilles,
Ainsi, parbleu, que les jarnibleus
Et les palsambleus (…) » .Georges BRASSENS (1921-1981), La Ronde des jurons (1958)
Auteur-compositeur-interprète à la belle époque de la chanson française (à texte), Brassens aime jouer avec le feu de la censure et tous les conformisme de la bienséance. Il fut d’ailleurs censuré (à la radio nationale).
La terminaison « bleu » est un euphémisme coloré qui évite de dire Dieu – et donc de blasphémer. « Mordieu ! » c’est jurer « par la mort de Dieu! » . Fallait oser, à l’époque où la France devenait chrétienne – avant d’être fille aînée de l’Église et en proie aux guerres de Religion.
À la fin du XVIe siècle, Henri IV adorait jurer, au grand dam de son confesseur (jésuite qui plus est !), Pierre Coton. Ses deux jurons préférés : Ventre Saint Gris (déformation amusante de Ventre Dieu, double sacrilège où Dieu est remplacé par Saint-Gris, alias Saint François d’Assise) et Jarnidiu (Je renie Dieu) devenu Jarnidiou avec l’accent gascon. Nous allons retrouver en son temps le très populaire Vert-Galant, ses amours et son panache blanc.
MOYEN ÂGE
« Toute l’église resplendit de la lumière merveilleuse et ininterrompue des fenêtres étincelantes qui rayonnent leur beauté à l’intérieur. »
Abbé SUGER (vers 1081-1151), De constructione ecclesiae sancti Dionysii
Ministre et ami de Louis VI le Gros, puis de Louis VII, il développe l’autorité royale contre le pouvoir des nobles et assure une meilleure justice. Abbé de Saint-Denis pendant trente ans (1122-1151), il remplace l’ancienne abbatiale carolingienne du VIIIe siècle, veillant de près à la reconstruction. Il « signe » son abbaye, mais ne donne pas dans ses écrits les noms du maître d’œuvre, des maîtres maçons et des ouvriers qui ont participé à la reconstruction de l’abbatiale. La basilique actuelle est le résultat de plusieurs siècles de travaux.
Ébloui par les vitraux de Notre-Dame de Chartres, Suger évoque les chapelles rayonnantes du chevet : « Notre-Dame de la Belle-Verrière » est l’une des 175 représentations de la Vierge et peut-être le vitrail le plus célèbre au monde. Marie règne sur son trône céleste. On l’appelait communément la « Vierge bleue » : le fameux « Bleu de Chartres » .
Mais ce « bleu roman » très lumineux fut mis au point dans les années 1140 sur le chantier de la basilique Saint-Denis, avant d’être utilisé dans la cathédrale de Chartres. Son fondant sodique coloré au cobalt le rend plus résistant que les rouges ou les verts de la même époque. Notre-Dame de la Belle-Verrière faillit disparaître lors du terrible incendie de 1194. Seul le panneau central — celui de Marie et de son Enfant — et les trois verrières qui surplombent le portail royal ont miraculeusement résisté au désastre. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l’histoire du pays, mais encore de l’histoire de la science et de l’art.
« Les poèmes sont des vitraux coloriés. Si l’on regarde de la place publique dans l’église, tout est sombre et triste (…) Mais entrez seulement ! Saluez la Sainte-Chapelle ! Là tout est couleur et clarté ; histoire, ornements, brillent soudain ; une noble lumière agit avec force. Enfants de Dieu, cela est fait pour vous ; que vos cœurs soient touchés et que vos yeux soient ravis. »
Wolfgang GŒTHE (1749-1832), Parabole, Dieu et le monde
Les vitraux de Notre-Dame (avec la Sainte-Chapelle), de Chartres (avec le fameux « bleu de Chartres » ) ou de tout autre cathédrale ayant préservé ses joyaux à travers les siècles n’ont cessé de fasciner le visiteur, qu’il soit poète, croyant ou simplement sensible à la beauté.
Au Moyen Âge, les vitraux font office de livre d’images : le peuple majoritairement illettré peut apprendre l’histoire sainte. Il faut simplement retenir le principe de lecture de gauche à droite et de bas en haut : scènes des Évangiles canoniques ou apocryphes, enfance de Jésus, relations de miracles, vie de Marie, vie des saints. On trouve aussi des évocations profanes et locales sur les protecteurs de la paroisse, les légendes en cours.
« Aux lueurs colorées que laissent filtrer les vitraux, toute cette magnificence de conte oriental chatoie, miroite, étincelle dans la pénombre. »
Pierre LOTI (1850-1923), Jérusalem (1894)
Figuratifs et colorés, les vitraux existent à l’époque mérovingienne et vers 1100, le moine Théophile témoigne déjà de la maîtrise des techniques. Les vitraux des églises romanes sont très clairs, pour compenser l’étroitesse des ouvertures dans les murs de pierre. Avec l’architecture gothique, les fenêtres s’agrandissent, la tonalité des vitraux peut donc se foncer, la palette du verrier se diversifie. Le bleu est soutenu, le bleu-rouge domine dans les fonds, les couleurs se nuancent : vert-olive et vert-émeraude, rouge carmin et rouge vermillon. Le jaune est peu employé. Plus tard apparaît le violet (placage de verre rouge et bleu) et la sanguine, brun-rouge.
On appelle « sertissage en chef d’œuvre » l’incrustation d’un verre, souvent rond, tenu par un plomb, à l’intérieur d’un autre verre plus grand et de couleur différente. Ce travail délicat permet au compagnon d’obtenir sa maîtrise, d’où le nom de « chef d’œuvre » . Grâce à ce procédé, on peut dessiner les blasons diversement colorés des donateurs.
A la Renaissance, les scènes deviennent plus réalistes, les visages plus expressifs, les formes plus précises et les couleurs plus nuancées… L’histoire du vitrail est une magie sans cesse renouvelée.
« Je ne comprends pas l’abandon du vitrail qui s’éveillait et s’endormait avec le jour. L’art a préféré la lumière mais le vitrail, animé par le matin effacé par le soir, faisait pénétrer la création dans l’église du fidèle. »
André MALRAUX (1901-1976), La Tête d’obsidienne (1974)
La magie du vitrail continue de s’exercer sur tous les visiteurs et Malraux (futur ministre de la Culture) est l’un des plus « éclairés » . Rappelons la parole de Jésus à ses disciples : « Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 12.
« Pour moi, un vitrail est une partition transparente entre mon cœur et le cœur du monde. »
Marc CHAGALL (1887-1985), La Rose bleue ou le Christ, 1964
Avec Pablo Picasso, Chagall est l’un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle. Son œuvre ne se rattache à aucune école, même s’il emprunte au surréalisme et au néo-primitivisme. Il est surtout inspiré par la tradition juive et le folklore russe. Ce peintre toujours original qui a pratiqué la gravure, la sculpture, la poésie, la céramique et la mosaïque, est l’un des rares contemporains créateur de vitraux aux États-Unis, en Israël, en Europe et notamment en France, dans six villes, dont Nice – où l’auditorium du musée Chagall expose La Création du monde, trois vitraux qui se lisent de droite à gauche, dans le sens de la lecture hébraïque… et du principe valant déjà au Moyen Âge pour tous les vitraux.
« Restauration des sculptures polychromées du portail occidental de la cathédrale d’Angers. »
MINISTERE DE LA CULTURE, Régions, DRAC, Pays de la Loire, Monuments historiques. Chantiers en cours
Quand on évoque les couleurs médiévales en matière architecturale, on pense naturellement aux vitraux des cathédrales et à leur magie. Mais on oublie les murs de pierre et les statues de ces monuments toujours à redécouvrir !
En 2009, lors d’un nettoyage de la cathédrale d’Angers et sous le badigeon recouvrant les sculptures du portail occidental apparurent des vestiges d’une « polychromie exceptionnelle » résultant de sept couches picturales superposées. Les plus anciennes datent de la construction du portail au XIIe siècle. En 1617, la foudre endommage fortement le tympan du portail, en partie, re-sculpté et entièrement repeint, dans un souci d’harmonisation avec les sculptures anciennes.
En 2020, dans quelques villes célèbres pour leur cathédrale, Orléans, Rouen, Strasbourg, des reconstitutions éphémères relevant de « Son et lumière » spectaculaires donnent une idée plus festive que fidèle et sans doute exagérée de cette réalité médiévale.
« Avoir le sang bleu » ..
Cette expression remonte au temps de la noblesse. Le bleu commence son irrésistible ascension – résumée à la fin de cet édito. Succédant au rouge impérial, il devient couleur royale avec les armoiries des premiers Capétiens : fleurs de lys sur fond d’azur, emblème du roi de France vers 1130. Deux siècles après, le bleu se retrouvait sur un tiers des blasons.
Mais le « sang bleu » aurait une autre origine… plus originale. Les nobles se distinguent du peuple par bien des manières, la plus visible étant la pâleur de leur peau : ils n’allaient pas au soleil et ne travaillaient pas la terre comme l’écrasante majorité des paysans. Ayant la peau très blanche, les veines (bleutées) ressortaient.
Au sommet de la hiérarchie aristocratique, les Grands d’Espagne sont les premiers au Moyen Âge à se flatter de leur sangre azul (« sang bleu » ). L’expression se diffuse peu à peu vers l’Italie et Stendhal en voyage le remarque en 1817. Il lance l’expression dans notre pays et depuis cette époque, les nobles sont réputés avoir le « sang bleu » . Nous y reviendrons.
ANCIEN RÉGIME
« Vainqueur de gens et conquéreur de terre,
Le plus vaillant qui onques fut en vie,
Chacun pour vous doit noir vêtir et querre [chercher].
Pleurez, pleurez, fleur de la chevalerie. » 315Eustache DESCHAMPS (vers 1346-vers 1406), Ballade sur le trépas de Bertrand Du Guesclin
Le noir est la couleur du deuil et de la mort – en France. En Inde et au Japon, on pleure ses morts en blanc, en Chine c’est en rouge, en Iran en bleu…
Capitaine puis connétable, Du Guesclin incarna en guerrier le sentiment patriotique naissant. D’une laideur remarquable et d’une brutalité qui fit la honte de sa famille, il gagna le respect de la noblesse par son courage, sa force et sa ruse, pour devenir le type du parfait chevalier, héros populaire dont poèmes et chansons célèbrent les hauts faits. Cette ballade est l’œuvre la plus connue d’Eustache Deschamps, poète et premier auteur d’un art poétique.
« Manger son pain blanc en premier. »
« Si tu manges ton pain blanc en premier, tu manges ton pain noir plus tard. » ,Guillaume DUBOIS, dit CRÉTIN (1460-1525), Chroniques Françaises (1515-1516)
Homme d’Église, poète et rhéteur, on lui doit la première expression sur le pain blanc, devenue ensuite dicton dans un pays où le pain représente la base de l’alimentation pour le peuple, gardant au fil de l’histoire et jusqu’à nos jours une importance symbolique.
Le pain était à l’origine une chose grisâtre, faute d’une farine blanche et débarrassée de ses impuretés comme aujourd’hui. Mais quand le paysan ou l’ouvrier pouvait avoir accès à une farine plus propre et fine – généralement réservée à la haute société – il se faisait du pain plus clair que d’ordinaire, pain « blanc » (bien loin de la blancheur actuelle) à la qualité et au goût réputés supérieurs. Du coup, les gens avaient tendance à le manger en premier, se condamnant à partager le moins bon plus tard.
Cette vieille métaphore a depuis longtemps quitté le four à pain pour se généraliser à toutes les occasions où l’on a commencé par faire les choses agréables – « manger le pain blanc » – sans savoir qu’on devrait ensuite subir des désagréments divers – le « pain noir » appelé aussi « pain noir de l’adversité » . L’expression s’emploie généralement a posteriori, quand une personne a profité de d’une situation aisée pour se trouve ensuite dans le besoin ou la peine.
« Vive Henri IV
Vive ce roi vaillant !
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et de se battre
Et d’être un Vert Galant ! » 605Vive Henri IV, chanson anonyme. Chansons populaires du pays de France (1903), Jean-Baptiste Weckerlin
Premier couplet contemporain du roi. Au fil du temps, d’autres s’ajoutent, à mesure qu’Henri IV devient l’un des mythes de l’histoire de France. Au XVIIIe siècle, le culte du Bon roi atteint son apogée. La Partie de chasse d’Henri IV (1774), pièce de Charles Collé qui reprend la chanson, fait un triomphe après les foudres de la censure – la comparaison se faisant fatalement au désavantage de Louis XV qui n’est plus le Bien-Aimé, en fin de règne.
Quant au caractère public des amours royales, il dépasse la médiatisation qu’en fait aujourd’hui la presse people. Que ce soit pour applaudir ou médire, pour dire la vérité ou répandre la rumeur, chansons et pamphlets (souvent anonymes) sont les premiers médias populaires. L’amour des femmes est quand même le point faible du Vert Galant. À 56 ans, il mettra en danger la paix du royaume pour littéralement courir après sa dernière maîtresse Charlotte Marguerite de Montmorency, âgée de 15 ans.
« Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez au chemin de la victoire et de l’honneur. » 616
HENRI IV (1553-1610), à ses compagnons, avant la bataille d’Ivry, 14 mars 1590. Histoire universelle (posthume), Agrippa d’Aubigné
Le « panache blanc » entrera dans la légende et la commune de l’Eure (près de Chartres) prendra le nom d’Ivry-la-Bataille. Les soldats semblent hésiter : les troupes de la Ligue (ultra-catholique) commandées par le duc de Mayenne sont trois fois supérieures en hommes et en armes.
Le roi va trouver les gestes et les mots qu’il faut. Il plante un panache de plumes blanches sur son casque et harangue ses troupes : « Mes compagnons, Dieu est pour nous, voici ses ennemis et les nôtres ! Voici votre roi ! Gardez bien vos rangs. Et si vous perdez enseignes, cornettes ou guidons, ce panache blanc que vous voyez en mon armet vous en servira, tant que j’aurai goutte de sang. Suivez-le. Si vous le voyez reculer, je vous permets de fuir… » Et le roi charge en tête de ses hommes.
« Quand une fois j’ai pris ma résolution, je vais droit à mon but, je renverse tout, je fauche tout, et ensuite je couvre tout de ma robe rouge. » 684
Cardinal de RICHELIEU (1585-1642). Histoire du ministère du cardinal de Richelieu, tome II (1816), Antoine Jay
Michelet fait un saisissant portrait du « sphinx à robe rouge » : « Que de contrastes en lui ! Si dur, si souple, si entier, si brisé ! Par combien de tortures doit-il avoir été pétri, formé et déformé, disons mieux, désarticulé, pour être devenu cette chose éminemment artificielle qui marche sans marcher, qui avance sans qu’il y paraisse et sans faire de bruit, comme glissant sur un tapis sourd, puis, arrivé, renverse tout. Il vous regarde du fond de son mystère. »
Mystère en vertu de quoi l’« homme rouge » est très diversement jugé par les contemporains comme par les historiens. Son Testament politique nous donne quelques pistes, même s’il n’est pas entièrement écrit de sa main et si le sphinx garde toujours quelques secrets.
« Les couleurs dans la peinture, ce sont des leurres qui persuadent les yeux comme des vers dans la poésie. »
Nicolas POUSSIN (1594-1665), Mesures de la célèbre statue de l’Antinoüs, suivies de quelques observations sur la peinture (1672)
C’est le peintre classique par excellence, sans doute le plus connu (et le mieux reconnu) en France comme à l’étranger. L’essentiel de sa formation et de sa carrière se passe à Rome – véritable capitale artistique européenne. Mais son séjour à Paris (de 1640 à 1642) lui permet de rencontrer Richelieu qui lui passe commande pour son château parisien (le Palais Royal). Louis XIII fait de même. Poussin obtient le brevet de « premier peintre ordinaire du roi » et la direction générale de tous les ouvrages de peintures et d’ornements pour l’embellissement des maisons royales, avec 3 000 livres de gages.
Certains autres peintres (classiques) du roi le critiquent et le jalousent – les bonnes places sont chères et le marché de la peinture restera très étroit durant deux siècles. Cela affecte sa santé fragile et il retourne à Rome pour une belle fin de carrière. Il approfondit er raffine son classicisme à l’école des Anciens, il « rumine la matière » , autrement dit il pense longuement au sujet à traiter, réalisant de nombreux dessins, travaillant parfois un an sur la toile. Sa cote augmente, il devient l’un des peintres les plus célèbres de Rome et de son temps, les autres artistes chantent ses louanges de son vivant, appréciant autant le caractère de l’homme que la qualité de ses œuvres. Sa main qui tremble maladivement freine malheureusement son activité. Après sa mort, il continue d’être étudié et admiré, notamment dans les collections royales et par l’enseignement de l’Académie, car Poussin incarne la primauté du dessin sur la couleur – une histoire à suivre.
Ce peintre très classique va pourtant influencer les artistes modernes : après Cézanne, les cubistes pour sa cohérence plastique. Picasso étude la composition du Massacre des Innocents et reprend dans ses dessins l’attitude de certains personnages de femmes qu’on retrouve dans Guernica, son tableau le plus connu… et exceptionnellement sans couleur : « Picasso utilise beaucoup le blanc, le noir et le gris dans les moments où il veut dire quelque chose de très important et où il ne veut pas perdre son temps dans la couleur » , selon Carmen Giménez, administratrice du musée Reina Sofía qui exposé Guernica depuis 1981.
« La fonction de la couleur est de satisfaire les yeux tandis que le dessin satisfait l’esprit. »
Charles LE BRUN (1619-1690), Discours, Sentiments sur le discours du mérite de la couleur, 9 janvier 1672
La « querelle du coloris » ou « querelle des poussinistes et des rubénistes » est une forme de débat esthétique dont l’élite cultivée raffole en France, opposant la plupart du temps les Anciens aux Modernes et n’empêchant pas les auteurs ou artistes de créer en fonction de leur talent ou de leur génie. Sauf que… l’Académie fait quand même la loi, surtout au XVIIe siècle, aboutissant par définition à un académisme contre lequel les nouveaux peintres du XIXe siècle se révolteront, à commencer par les impressionnistes. En attendant, le mécénat et les commandes publiques dépendent de l’Académie et les collectionneurs privés sont influencés par ses choix – le marché de l’art aura au moins le mérite d’élargir la clientèle, la diversité des courants esthétiques et le nombre des créateurs vivant de leur métier.
En 1672, cette déclaration de Le Brun, peintre très classique et directeur de l’Académie royale de peinture et de sculpture (créée en 1648) tente d’apaiser le conflit, même s’il est personnellement plus favorable au dessin, l’essentiel de ce qu’enseigne cette institution.
Cette histoire de l’art fait naturellement partie de l’histoire de France, au même titre que les batailles militaires et les institutions politiques. Elle en est même le plus fidèle reflet, la « peinture d’histoire » arrivant en tête dans la hiérarchie des genres, censée demander aux artistes un plus grand effort intellectuel de connaissance, d’interprétation et de composition. Juste après, le portrait – qui vaut aussi témoignage historique. Moins « noble » , la « peinture de genre » (scène de la vie quotidienne), puis la peinture de paysage, la peinture animalière et la nature morte.
Les « fêtes galantes » seront un genre nouveau, spécialement créé pour le génie de Watteau admis à l’Académie en 1717, avec son Pèlerinage à l’île de Cythère. C’est la victoire des coloristes ! Le débat rebondira jusqu’au XIXe siècle, le romantisme de Delacroix, génie passionnément coloriste, s’opposant au classicisme d’Ingres, dessinateur de génie.
« Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » 842Jean de LA FONTAINE (1621-1695), Fables, Les Animaux malades de la peste (1678)
Expression toujours valable, si la réalité ne l’est plus – l’égalité devant la justice sera l’un des acquis majeurs de la Révolution. Notons que La Fontaine se sert « d’animaux pour instruire les hommes » , mais aussi pour faire une satire de son époque, comme Molière et La Bruyère.
« Qu’est-ce qu’un cardinal ? C’est un prêtre habillé de rouge qui a cent mille écus du roi, pour se moquer de lui au nom du pape. » 960
CHAMFORT (1740-1794), Pensées, maximes et anecdotes (posthume, 1803)
Le « rouge cardinal » est un rouge soutenu dont le nom évoque justement la robe portée par les cardinaux de l’Église catholique. L’expression s’emploie toujours pour les fleurs et dans la mode, depuis le XIXe siècle. Quant à l’humour de Chamfort, il est typique du siècle de Voltaire qui prend la liberté de se moquer du clergé.
Le clergé reste l’un des fondements de l’Ancien Régime et sans doute le plus profondément loyaliste. Mais la religion est contestée dans son ensemble, ébranlée par la philosophie nouvelle et déconsidérée par diverses pratiques et querelles, cependant que le haut clergé (tous les évêques sont nobles après 1760) a des préoccupations plus laïques que religieuses.
« L’homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie, et rouge en Amérique, n’est que le même homme teint de la couleur du climat. »
BUFFON (1707-1788), Œuvres Complètes, tome V (1846)
Encyclopédiste des Lumières, mais dans le domaine des sciences de la nature où il est véritablement pionnier. Cette affirmation (quelque peu naïve) décrédibilise les théories raciales, souvent sources de racisme. Elle sera reprise sous d’autres formes au XXe siècle.
« On se sert des couleurs, mais on peint avec le sentiment. »
CHARDIN (1699-1779), Chardin, biographie d’Étienne Jollet (1998)
La peinture est naturellement l’art d’utiliser les couleurs et l’occasion d’en parler à l’infini – notons au passage que les peintres ont aussi l’art du mot et s’expriment de manière aussi claire qu’originale sur leur passion dont ils ont fait métier. Cette réflexion va se retrouver au cours du débat esthétique et néanmoins violent qui oppose durant deux siècles les défenseurs (classiques) du dessin aux promoteurs (de plus en plus révolutionnaires) de la couleur.
Reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands peintres européens du siècle des Lumières (philosophiques), Jean Siméon Chardin devient académicien « dans le talent des animaux et des fruits » , autrement dit le niveau inférieur de la hiérarchie des genres reconnus – la « peinture d’histoire » étant la catégorie reine. Mais ses clients fortunés savent apprécier son art. Le « Bonhomme Chardin » reste surtout pour ses portraits, ses natures mortes et ses pastels – avec une utilisation originale et déjà très libre des couleurs, et des audaces qui préfigurent l’impressionnisme du siècle suivant.
« Ô Chardin ! Ce n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. » „,
DIDEROT (1713-1784), Salon de 1763
Philosophe des Lumières très libre d’esprit, c’est aussi un critique d’art passionné (comme Baudelaire au siècle suivant) qui s’exprime devant un sujet apparemment modeste : Le Bocal d’olives signé Chardin.
Il est tout à fait logique que l’admiration de Diderot vise l’utilisation (déjà) révolutionnaire des couleurs : « On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes aux autres et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur qu’on a soufflée sur la toile ; ailleurs une écume légère qu’on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze vous expliqueraient ce faire bien mieux que moi ; tous en feront sentir l’effet à vos yeux. Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se crée et se reproduit. »
On ne saurait mieux décrire avec des mots le choc de l’image.
« Nous étions vingt ou trente
Brigands dans une bande,
Tous habillés de blanc,
À la mode des…
Vous m’entendez ?
Tous habillés de blanc
À la mode des marchands. » 1137La Complainte de Mandrin (1755), chanson
L’auteur est anonyme, mais le texte semble bien daté de l’année de sa mort. Tout est fait pour rendre le bandit Mandrin sympathique, humain, proche du peuple.
Depuis le Moyen Âge, chaque catégorie sociale se distingue par ses vêtements et par leur couleur. Les nobles portent des couleurs vives et chatoyantes – les teintures sont très coûteuses et flatteuses pour mieux se distinguer. Le peuple est forcé à plus de modestie, le bourgeois (sauf particulièrement riche) ne se distingue pas davantage. Quant au bandit, il n’a pas non plus intérêt de se faire remarquer.
« La première volerie / Que je fis dans ma vie / C’est d’avoir goupillé, / La bourse d’un… / Vous m’entendez ? / C’est d’avoir goupillé / La bourse d’un curé… » Un couplet le fait mourir pendu, sur la place du marché. Petite erreur historique. Mais le personnage entre véritablement dans la légende et y demeure, avec la complicité de chanteurs populaires comme Yves Montand : « Compagnons de misère, / Allez dire à ma mère, / Qu’elle ne me reverra plus, / J’suis un enfant, vous m’entendez… / Qu’elle ne me reverra plus, / J’suis un enfant perdu. »
RÉVOLUTION
« Voici une cocarde qui fera le tour du monde. » 1336
LA FAYETTE (1757-1834), 17 juillet 1789. Petite histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours (1883), Victor Duruy
La cocarde va surtout faire carrière dans notre Histoire !
Rappelons le rôle du très populaire « Héros des deux mondes » : à 19 ans, il s’engage personnellement et financièrement dans la guerre d’Indépendance des « Insurgents » contre l’Angleterre – et contre la politique étrangère de Louis XVI. Le Congrès des jeunes États-Unis d’Amérique le fait citoyen d’honneur en 1781. La France des Lumières et de la Révolution y a gagné un allié pour les siècles à venir.
Nommé commandant de la garde nationale le lendemain de la prise de la Bastille (15 juillet), La Fayette fait un geste véritablement historique et lourd de symboles : il prend la cocarde bleue et rouge aux couleurs de Paris, y joint le blanc, couleur du roi, et présente cette cocarde tricolore à Louis XVI venu « faire amende honorable » à l’Hôtel de Ville de Paris. Le roi met la cocarde à son chapeau et, par cet autre geste également symbolique, il reconnaît la Révolution. Mais ce geste est sans lendemain.
« Allons, avec la cocarde,
Aux tyrans, foutre malheur ;
Puis, allons à l’accolade,
Foutons-nous là de bon cœur.
Au diable toutes les frontières
Qui nous tenaient désunis,
Foutre, il n’est point de barrières
Sur la terre des amis. » 1454Jacques HÉBERT (1757-1794), Le Réveil du Père Duchesne, chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
C’est un couplet bien dans le ton du Père Duchesne, l’un des journaux les plus populaires de l’époque, distribué aux armées pour éveiller la conscience politique des soldats.
« Je suis de la couleur de ceux qu’on persécute. » 1395
TOUSSAINT LOUVERTURE (1743-1803). Toussaint Louverture (1850), Alphonse de Lamartine
Ainsi parle le héros de ce poème dramatique en cinq actes et en vers. La couleur de la peau, associée à la « race » , renvoie naturellement au racisme, une longue histoire qui n’en finit pas de finir.
La nuit du 22 au 23 août 1791, François Toussaint prend la tête de la révolte des Noirs à Saint-Domingue, colonie des Antilles (île d’Haïti). Restés esclaves après le timide décret du 13 mai, ils veulent les mêmes droits que les citoyens blancs. À l’opposé, les colons s’effraient du droit de vote donné aux mulâtres. L’insurrection aboutit à des massacres entre Blancs et Noirs, sucreries et plantations de café sont dévastées.
Les planteurs vont demander secours à l’Espagne et l’Angleterre, mais Toussaint se rallie à la Révolution quand le gouvernement français abolit l’esclavage en 1794.
Son courage lui vaudra le surnom de Louverture, celui qui ouvre et enfonce les brèches dans les troupes adverses ! Il devient gouverneur de la colonie prospère, les anciens esclaves travaillant comme salariés dans les plantations. Il proclame l’autonomie de l’île en 1801. Mais Bonaparte enverra 25 000 hommes contre Toussaint qui mourra (de froid) en captif, dans le Jura. L’indépendance d’Haïti, premier État noir indépendant en 1804, est la victoire posthume de ce grand leader noir. Et le 23 août est devenu « Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition » .
« Pays, Patrie, ces deux mots résument toute la guerre de Vendée, querelle de l’idée locale contre l’idée universelle, paysans contre patriotes. » 1489
Victor HUGO (1802-1885), Quatre-vingt-treize (1874)
Les insurgés vendéens (les Blancs) vont réunir jusqu’à 40 000 hommes et remporter plusieurs victoires contre les patriotes (les Bleus) en ce printemps 1793, avant d’échouer devant Nantes (29 juin).
Dernier roman historique situé en 1793, année charnière et riche en événements, il met en scène trois personnages : un prêtre révolutionnaire, un aristocrate royaliste et vendéen, et son petit-neveu rallié à la Révolution. Ce choc des extrêmes rappelle la Commune (1871) et ses drames vécus par Hugo. Les guerres civiles se suivent et se ressemblent tragiquement.
La Convention envoie des troupes républicaines dès juillet, mais les grands combats suivis de massacres seront organisés sous la Terreur, à partir d’octobre. Au total, la guerre de Vendée et la guerre des Chouans (mêmes causes, mêmes effets, en Bretagne et Normandie) feront quelque 600 000 morts, dont 210 000 civils exécutés, 300 000 morts de faim et de froid (100 000 enfants). Ce génocide (mot employé par certains historiens) est, sans conteste, le plus lourd bilan à porter au passif de la Révolution.
« Les yeux verts, le teint pâle, habit nankin rayé vert, gilet blanc rayé bleu, cravate blanche rayée rouge. »
François GÉRARD (1770-1837), note au bas d’un croquis rehaussé d’aquarelle de ROBESPIERRE (musée Carnavalet de Paris)
Peintre d’histoire (catégorie reine) et portraitiste connu, élève de David, il a réalisé une esquisse du nouveau « maître de la France » durant une séance de la Convention. Ce mélange original et délicat des couleurs reflète l’élégance légendaire du personnage qui parle toujours au nom du Peuple et incarne la Terreur, avant le coup d’État de Thermidor qui va y mettre fin le 27 juillet 1794.
« Du pain et la Constitution de 1793 ! » 1619
Mots d’ordre criés par le peuple envahissant la Convention, 20 mai 1795, prélude à la TERREUR BLANCHE. Histoire de France, 1750-1995 : Monarchies et Républiques (1996), René Souriac, Patrick Cabanel
Seconde insurrection populaire : journées des 1er, et 2 et 3 prairial an III (20 au 22 mai 1795). Les mêmes causes produisent les mêmes effets, la disette s’aggrave à Paris, la Constitution de 1793 reste suspendue, les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau se soulèvent, les insurgés envahissent la Convention et massacrent le député Féraud. Encore une tête au bout d’une pique ! On évite de peu le bain de sang à Paris, mais il s’ensuit une réaction très violente contre les terroristes révolutionnaires.
La Terreur blanche sévit surtout dans le sud-est de la France : les bandes royalistes pourchassent et massacrent Jacobins, républicains, prêtres constitutionnels, protestants, généralement avec la complicité des autorités cherchant à anéantir le terrorisme révolutionnaire.
L’ÉPOPÉE NAPOLÉONIENNE
« N’est-ce pas que je suis de la poule blanche ! » 1714
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), à sa mère, après l’attentat de la rue Saint-Nicaise, 24 décembre 1800. Histoire de la France (1986), André Bendjebbar
« Être de la poule blanche » est une expression corse qui signifie avoir de la chance et ce Corse fut toute sa vie très superstitieux.
C’est miracle s’il n’est pas mort, ce soir de Noël 1800. Au passage de son carrosse, c’est l’explosion de la « machine infernale » – tonneau de 200 livres de poudre et rempli de clous. L’attentat fait 22 morts, une cinquantaine de blessés, 46 maisons détruites. Le fracas ébranle tout le quartier Saint-Honoré… Le Premier Consul est indemne. Il dormait, épuisé, toujours prompt à récupérer, avant d’aller à La Création du monde de Joseph Haydn à l’Opéra (alors place Louvois). Il se rendra d’ailleurs au spectacle, sans se soucier de son épouse Joséphine (légèrement blessée) dans une autre voiture du cortège, avec sa fille Hortense.
Le 10 octobre, et cette fois dans sa loge à l’Opéra, il a échappé de peu au couteau de cinq conjurés – la « conspiration des poignards » . Bonaparte est persuadé que cette série d’attentats contre sa personne est l’œuvre des Jacobins. Mais Fouché a d’autres informations et le ministre de la Police est toujours bien informé.
« L’aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame. » 1927
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Golfe-Juan, Proclamation du 1er mars 1815. Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène, de mémoires et documents écrits par l’empereur Napoléon (1821-1822)
L’empereur annonce littéralement la couleur dès le premier jour, se pose devant l’armée en soldat de la Révolution et honnit le drapeau blanc de la Charte constitutionnelle : « Arrachez ces couleurs que la nation a proscrites, et qui pendant vingt-cinq ans servirent de ralliement à tous les ennemis de la France ! Arborez cette cocarde tricolore ; vous la portiez dans nos grandes journées […] Reprenez ces aigles que vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à Iéna. »
Il n’en faut pas plus, pas moins non plus, pour que Napoléon gagne cet incroyable pari : rallier les troupes envoyées pour l’arrêter, soulever d’enthousiasme les populations, et traverser la France en vingt jours, sous les yeux de l’Europe pétrifiée. Ainsi commence le vol de l’Aigle, sur la route Napoléon.
« Soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà ! » 1932
NAPOLÉON Ier (1769-1821) ouvrant sa redingote grise et montrant sa poitrine nue aux soldats venus l’arrêter, 7 mars 1815. 1815 (1893), Henry Houssaye
La scène se passe à Laffrey, près de Grenoble. L’officier fidèle au roi a crié « Feu ! » à ses hommes, Napoléon a eu ce geste, ce mot. Aucun ne tire, le cri de « Vive l’empereur ! » répond à sa voix. Tous les soldats jettent les cocardes blanches et remettent les cocardes tricolores remisées dans leur sac il y a un an. Tous se rallient à l’empereur, dans la « prairie de la Rencontre » : Stendhal raconte la scène, Steuben (artiste allemand) la peint et l’immortalise.
DE LA MONARCHIE DE JUILLET AU SECOND EMPIRE
« Les femmes de la haute noblesse affectent de parler du nez. J’ai entendu l’une d’elles dire d’une autre femme : A-t-elle du sang bleu ? ce qui veut dire : Est-elle vraiment noble ? et j’ai eu la sottise de rire aux éclats (sang bleu se prononce de même en milanais et en français). »
STENDHAL (1783-1842), Rome, Naples et Florence… (Œuvres complètes, volume 10)
Entré avec des relations mais sans vocation au ministère de la Guerre sous le Consulat, il est envoyé en mission à Milan en 1800 : premier coup de foudre pour l’Italie. Avec la musique et la peinture, ces trois passions vont donner sens à sa vie. Perdant son emploi à la chute de l’Empire, il retourne dans ce pays qui le fascine, écrivant ce journal de voyage vibrant de ses sensations artistiques plus que touristiques.
Il note cette anecdote datée de 1817 à Milan, « le plus beau lieu de la terre. » Tout lui fait bonheur et profit dans cette ville, les musées, les monuments, les femmes et la Scala, temple de l’opéra ! Il introduit ensuite dans les salons parisiens la locution haute en couleur. Il la reprend dans un prochain roman : « Je montais les chevaux de l’homme d’affaires, qui voulait bien le souffrir par respect pour mon sang bleu, mais il commençait à trouver mon séjour un peu long ; mon père m’avait assigné une pension de douze cents francs, et se croyait damné de donner du pain à un jacobin. » La Chartreuse de Parme, 1839.
Hector Malot écrit Le Sang bleu qui fait explicitement référence aux nobles dont la peau blanche et fine laissait voir le bleu des veines. Avec ce roman, il s’agit pour lui de contribuer à ce que Mona Ozouf décrit comme « le lent travail de transaction entre les deux France, celle de la tradition, celle de la Révolution » entrepris par les écrivains du siècle.
« Le Rouge et le Noir » (1830):
STENDHAL (1783-1842). Le plus connu de ses romans
Le titre original était Julien, mais Stendhal l’a remplacé par Le Rouge et le Noir qui paraît toujours énigmatique. L’auteur n’a pas donné d’explication, d’où diverses interprétations. Voici la plus courante.
Le rouge symbolise l’armée et le noir le clergé. Le héros, Julien Sorel, hésite tout le temps entre l’armée et sa passion pour Napoléon ou le clergé qui lui a permis de faire ses études et favorisé son ascension sociale. Selon le critique littéraire Paul-Émile Daurand-Forgues, Stendhal a bien donné cette explication à ses amis : « Le rouge signifie que, venu plus tôt, Julien, le héros du livre, eût été soldat ; mais à l’époque où il vécut, il fut forcé de prendre la soutane. »
Notons que l’auteur aime titrer ses romans avec des noms de couleurs : Le Rouge et le Noir, Le Rose et le Vert, Lucien Leuwen (Le Rouge et le Blanc).
« Le drapeau rouge que vous nous rapportez n’a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie ! » 2146
Alphonse de LAMARTINE (1790-1869), chef du gouvernement provisoire, derniers mots de son discours du 25 février 1848. Les Orateurs politiques de la France, de 1830 à nos jours (1898), Maurice Pellisson
Le poète a pris rang de héros politique et populaire. Son lyrisme fait merveille, aux grandes heures du siècle romantique.
La veille, 24 février, il a accepté la proclamation de la République comme un fait accompli. Mais ce jour, il refuse l’adoption officielle du drapeau rouge et, seul des onze membres du gouvernement provisoire, il a le courage d’aller vers la foule en armes qui cerne l’Hôtel de Ville. Lui seul aussi est capable d’apaiser les insurgés du jour et de rallier le lendemain les modérés à la République.
« On se redit, pendant un mois, la phrase de Lamartine sur le drapeau rouge, « qui n’avait fait que le tour du Champ de Mars tandis que le drapeau tricolore » , etc. ; et tous se rangèrent sous son ombre, chaque parti ne voyant des trois couleurs que la sienne – et se promettant bien, dès qu’il serait le plus fort, d’arracher les deux autres. » 2147
Gustave FLAUBERT (1821-1880), L’Éducation sentimentale (1869)
Le romancier voit juste, certes aidé par le recul du temps : la confusion et l’enthousiasme des premiers jours masquent toutes les incompatibilités d’opinion.
« Le gouvernement provisoire déclare que la nation adopte les trois couleurs disposées comme elles l’étaient pendant la République. Ce drapeau portera ces mots : République française. » 2149
Gouvernement provisoire, Décret du 25 février 1848. Histoire de la révolution de 1848 : Gouvernement provisoire (1862), Louis-Antoine Garnier-Pagès
Le gouvernement provisoire pense à tout et va prendre une série de mesures dans les premiers jours : de la proclamation de la République à l’abolition des titres de noblesse, en passant par une réforme démocratique de la garde nationale, la dissolution de la Chambre des députés, la proclamation du suffrage universel et l’annonce de l’élection prochaine d’une Assemblée constituante, la reconnaissance de toutes les libertés d’expression (presse, théâtre, clubs), l’abolition de la peine de mort en matière politique, la limitation de la journée de travail (dix heures à Paris, onze heures en province), etc.
« Le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge. » 2173
Gustave FLAUBERT (1821-1880), L’Éducation sentimentale (1869)
Flaubert rejette ici dos à dos le bourgeois et le peuple.
Les représailles ont suivi les combats. Bilan humain des journées de juin : plus de 4 000 morts chez les insurgés, 1 600 parmi les forces de l’ordre (armée et garde nationale). Et 3 000 prisonniers ou déportés en Algérie. Bilan politique : la rupture est consommée entre la gauche populaire, prolétaire et socialiste (à Paris, mais très minoritaire dans le pays) et la droite conservatrice à laquelle vont peu à peu se joindre les républicains modérés, pour former le parti de l’Ordre.
« La couleur ajoute des ornements à la peinture, mais elle n’en est que la dame d’atour, puisqu’elle ne fait que rendre plus aimables les véritables perfections de l’art. » ;
Jean-Auguste Dominique INGRES (1780-1867) Notes et pensées extraites d’un article d’Henri Delaborde, paru dans la Gazette des beaux-arts (1869)
À 23 ans, l’élève de l’Académie des Beaux-Arts a l’insigne honneur de peindre Bonaparte, Premier consul (1804). La commande vient du nouveau maître de la France en personne, mais il n’a pas le temps de poser. Ingres devra s’inspirer d’un tableau d’Antoine-Jean Gros, comme lui dans la classe de David, le plus célèbre peintre de l’école néo-classique.
Deux ans plus tard, c’est Napoléon Ier sur le trône impérial (1806) en costume de sacre, assis sur le trône impérial. Tous les codes de cette peinture d’histoire très académique sont au rendez-vous (sceptre, main de justice, couronne de lauriers, abeilles d’or, grand collier de la Légion d’honneur…), avec la précision quasi hyper réaliste des moindres détails et la dominante du rouge impérial.
Sa carrière est bien lancée, il multiplie les portraits de commande, il découvre Rome, la peinture de Raphaël et le Quattrocento (contraction de « millequattrocento » , le XVe siècle de la Renaissance italienne). Il en reste marqué à jamais, comme peintre et comme enseignant. Son originalité s’exercera dans ses nus féminins, toujours fascinants et répondant à ce précepte : « Dessiner ne veut pas dire simplement reproduire des contours ; le dessin ne consiste pas uniquement dans le trait. Le dessin, c’est encore l’expression, la forme intérieure, le plan, le modelé. Voyez ce qui reste après cela ! Le dessin comprend les trois quarts et demi de ce qui constitue la peinture. Si j’avais à mettre une enseigne au-dessus de ma porte, j’écrirais : École de dessin, et je suis sûr que je ferais des peintres (…) Les grands peintres, comme Raphaël et Michel-Ange, ont insisté sur le trait en finissant. Ils l’ont redit avec un pinceau fin, ils ont ainsi ranimé le contour ; ils ont imprimé à leur dessin le nerf et la rage. »
Pour résumer sa pensée théorisée à l’envi, nul besoin d’étudier la nature, il suffit d’étudier les Anciens, les maîtres du dessin qui prime logiquement sur la couleur : ils SONT la nature et peuplent le musée personnel, pour ne pas dire le Panthéon d’Ingres, à l’exclusion des autres artistes qui se veulent coloristes : « Il est sans exemple qu’un grand dessinateur n’ait pas eu le coloris qui convenait exactement aux caractères de son dessin. Aux yeux de beaucoup de personne, Raphaël n’a pas coloré. Il n’a pas coloré comme Rubens et Van Dyck : parbleu, je le crois bien ! Il s’en serait bien, gardé : Rubens et Van Dyck peuvent plaire au regard, mais ils le trompent ; ils sont d’une mauvaise école, coloriste, de l’école du mensonge. Titien, voilà la couleur vraie, voilà la nature sans exagération, sans éclat forcé ! c’est juste. »
On a reproché à Ingres cette exigence qui devient intolérance, mais elle exprime avant tout sa passion artistique : « Oui sans doute Rubens est un grand peintre, mais c’est ce grand peintre qui a tout perdu. Chez Rubens il y a du boucher ; il y a avant tout de la chair fraîche dans sa pensée et de l’étal dans sa mise en scène. » On ne saurait être plus réaliste.
Le maître est toujours formel : « Vous êtes mes élèves ; par conséquent mes amis, et, comme tels, vous ne salueriez pas un de mes ennemis, s’il venait à passer à côté de vous dans la rue. Détournez-vous donc de Rubens dans les musées où vous le rencontrerez ; car si vous l’abordez, pour sûr il vous dira du mal de mes enseignements et de moi. »
Très présent dans les musées, Ingres s’oppose à Delacroix, l’autre grand pilier de la peinture française. Avec eux, deux conceptions de la peinture s’affrontent : le disegno (dessin) et l’effacement de l’artiste derrière le sujet pour les (néo)classiques, le colorito (couleur) et l’affirmation de l’expression et de la touche individuelle pour les romantiques.
« La couleur est par excellence la partie de l’art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent d’abord à la pensée, la couleur n’a aucun sens pour l’intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité. » 22
Eugène DELACROIX (1798-1863), Journal, 2 janvier 1853
Delacroix reste célèbre pour une « peinture d’histoire » , mais sa Liberté guidant le peuple (1830) n’a rien d’académique ni de classique ! Elle devient l’étendard du romantisme, divise les critiques et déchaîne les passions, au Salon officiel de 1831. Elle célèbre les Trois Glorieuses journées des 27, 28 et 29 juillet 1830, le soulèvement du peuple parisien qui met fin à la Restauration. Liant allégorie antique et représentation contemporaine, le lyrisme et la violence de cette œuvre magistrale surprennent le public. Une jeune femme à la poitrine nue, coiffée du bonnet phrygien, tenant un drapeau tricolore figure La Liberté. Elle marche armée, accompagnée d’un enfant des rues brandissant des pistolets (il inspira peut-être son Gavroche à Victor Hugo ).
L’image du peuple combattant divise la critique. Delescluze parle de « ce tableau peint avec verve, coloré dans plusieurs de ses parties avec un rare talent » (Journal des débats du 7 mai 1831). Mais pour le Journal des artistes du 8 mai : « M. Delacroix a peint notre belle révolution avec de la boue. » D’autres critiques trouvent inacceptable la figure de la Liberté, qu’ils qualifient de « poissarde, fille publique, faubourienne » . Son réalisme dérange : la nudité de son torse, la pilosité des aisselles. Les détails morbides, les représentations sans concession du sale choquent les partisans d’un nouveau régime qui souhaite apaiser les classes populaires et donner une image idéalisée des combats.
Louis-Philippe en fait pourtant l’acquisition en octobre, pour 3 000 francs, l’expose au musée Royal (palais du Luxembourg), puis à Versailles. L’année suivante, les massacres par la police des manifestants de la rue Transnonain à Paris, rendent difficile l’exposition du tableau des Barricades. Il est rendu à l’artiste !
La première Exposition universelle à Paris en 1855, souhaitée par l’empereur Napoléon III, est l’occasion d’une belle reconnaissance pour Delacroix. Aux côtés d’Ingres et d’Horace Vernet, il est au Palais des beaux-arts, avenue Montaigne. Une exposition particulière, réunissant plus de trente de ses œuvres qu’il a choisies, lui est dédiée. Delacroix est ainsi désigné comme l’un des grands peintres français de son temps. La toile est finalement accueillie au musée du Louvre en 1874. La Liberté guidant le peuple devient, sous la Troisième République, un tableau iconique.
Ce parcours chaotique est à l’image de sa carrière. En janvier 1857, à la septième tentative, il est enfin accepté au sein de l’Académie des beaux-arts. Théophile Gautier a critiqué certaines toiles, mais au fil des ans, l’admiration l’emporte : « M. Delacroix comprend parfaitement la portée de son art, car c’est un poète en même temps qu’un homme d’exécution. Il ne fait retourner la peinture ni aux puérilités gothiques ni aux radoteries pseudo-grecques. Son style est moderne et répond à celui de Victor Hugo dans Les Orientales : c’est la même fougue et le même tempérament. »
Défendant le peintre toujours attaqué, Baudelaire écrit un article apologétique pour la Revue française, « Salon de 1859 » qui conclut par ces mots : « Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond, tout cela est évident, tout cela a été dit. Mais d’où vient qu’il produit la sensation de nouveauté ? Que nous donne-t-il de plus que le passé ? Aussi grand que les grands, aussi habile que les habiles, pourquoi nous plaît-il davantage ? On pourrait dire que, doué d’une plus riche imagination, il exprime surtout l’intime du cerveau, l’aspect étonnant des choses, tant son ouvrage garde fidèlement la marque et l’humeur de sa conception. C’est l’infini dans le fini. C’est le rêve ! et je n’entends pas par ce mot les capharnaüms de la nuit, mais la vision produite par une intense méditation, ou, dans les cerveaux moins fertiles, par un excitant artificiel. En un mot, Eugène Delacroix peint surtout l’âme dans ses belles heures. » Delacroix répond au poète par une lettre restée célèbre : « Comment vous remercier dignement pour cette nouvelle preuve de votre amitié ? […] Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts. »
Delacroix souffrit toujours de cette guerre entre classiques et romantiques, dessinateurs et coloristes. Il se voulait et voulait tout à la fois : « Dans la nature, une teinte qui semble uniforme est formée de la réunion d’une foule de teintes diverses, perceptibles seulement pour l’œil qui sait voir (…) C’est avec les teintes ignobles qu’on produit l’effet de tons splendides. »
« Le parfums, les couleurs et les sons se répondent. »
Charles BAUDELAIRE (1821-1867), Fleurs du Mal (1857), Correspondances
Poète maudit (et censuré), c’est aussi un critique d’art éclairé. Au Salon de 1845, il défendait déjà ardemment Delacroix comme représentant du romantisme. C’est à propos de sa peinture et de l’œuvre de Théophile Gautier que Baudelaire lance la formule qui caractérise son art : « Manier savamment une langue, c’est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. C’est alors que la couleur parle, comme une voix profonde et vibrante… »
Il utilise souvent la synesthésie (association de deux sens) pour créer une fusion artistique des sens, notamment dans le sonnet Correspondances : « Comme de longs échos qui de loin se confondent / Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. / Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, / Doux comme des hautbois, verts comme des prairies, / Et d’autres corrompus, riches et triomphants. »
« Mais le vert paradis des amours enfantines,
L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ? »Charles BAUDELAIRE (1821-1867), Fleurs du Mal (1857), Moesta et Errabunda (Triste et Vagabonde) dans Spleen et Idéal
Le poète se plaît à opposer l’image du bonheur idéalisé – l’enfance – aussitôt associé à l’idée qu’il est bien loin et perdu à jamais, la seule chance de le recréer se trouvant dans le rêve et l’écriture poétique, stimulés par les « paradis artificiels » des diverses drogues.
Ici, le paradis de l’enfance est peint en vert. On le retrouvera peint en bleu par Charles Trenet. « Des goûts et des couleurs » , chacun en dispose à son gré – hors les classiques du rouge sang, du noir associé à la mort et au deuil (en Occident).
« Un public qui a perdu l’habitude de voir des couleurs assemblées est obligé de faire un effort pour comprendre l’harmonie qui résulte de cet assemblage. »
Eugène VIOLLET–LE–DUC (1814-1879), Dictionnaire, article Peinture
Architecte de métier, restaurateur de génie… il en a parfois abusé, notamment dans la restauration des cathédrales, accusé d’avoir réinventé un Moyen Âge de fantaisie dans sa volonté de rendre sa splendeur à un bâtiment en triste état, en début du chantier.
Le débat est sans fin : aux yeux des spécialistes comme des profanes, on en fait toujours trop ou pas assez. Mais la « restauration à l’identique » est impossible, vu que ces monuments religieux aussi imposants que fragiles ont été retouchés et complétés au fil des siècles.
Pour s’en tenir à Notre-Dame dont la restauration dirigée par Viollet-le-Duc s’est étalée entre 1845 et 1867, il a « osé » lui ajouter cette fameuse flèche qui s’est effondrée en direct sous les yeux du monde entier, lors du tragique incendie du 15 au 16 avril 2019. Après débats, controverses et consultations diverses, il fut décidé de reconstituer Notre-Dame telle qu’elle était, dotée d’une « nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque » . Donc, ce sera la cathédrale « de Viollet-le-Duc » , hommage posthume à ce visionnaire – on peut le comparer au baron Haussmann qui métamorphosa Paris, préfet très contesté sous le Second Empire et finalement reconnu pour son génie architectural.
Dans son Dictionnaire, Viollet-le-Duc récuse par avance d’éventuelles critiques sur l’usage de la couleur que certains pourraient juger malvenue, voire intrusive, dans un écrin immaculé comme une cathédrale. Invoquant les découvertes des archéologues et les témoignages historiques, il rappelle que la peinture fut toujours présente dans les monuments anciens, y compris médiévaux. C’est le XVIIe siècle, avec sa vision erronée d’une prétendue pureté antique, qui a imposé le dogme de la pierre brute. Il va même plus loin, reprochant au classicisme d’avoir détérioré le goût et le sens esthétique du public par son refus borné des couleurs : « Nos yeux se sont si bien déshabitués des harmonies colorantes, grâce au classicisme moderne. » La peinture est indispensable et ne saurait se contenter d’un simple rôle de contraste. Il lui faut assumer des tons « très vigoureux » pour atténuer l’aspect blafard de parois qui n’étaient pas conçues à l’origine pour être contemplées de l’intérieur. Il faut par ailleurs tenir compte des qualités d’éclairages différentes de ces espaces, liées à l’exposition nord-sud de la cathédrale, ce qui suppose encore une répartition équitable entre les tons froids et chauds des couleurs.