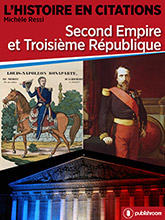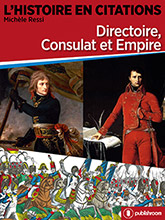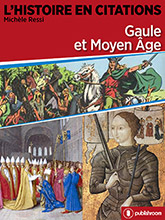V. Révolution
 Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
1. Les femmes du peuple en action : citoyennes, manifestantes, tricoteuses, vivandières et cantinières.
« Étant démontré, avec raison, qu’un noble ne peut représenter un roturier, ni celui-ci un noble, de même, un homme ne pourrait avec plus d’équité représenter une femme, puisque les représentants doivent avoir absolument les mêmes intérêts que les représentés : les femmes ne pourraient donc être représentées que par des femmes. »1317
Cahier de doléances et réclamation des femmes, signé d’une Madame B.B. (cauchoise restée anonyme). « La revendication de la démocratie paritaire », Marie-Blanche Tahon, Politique et Sociétés, volume XVII (1998)
Les femmes, c’est un peu le « quart ordre » de l’époque. Sous la Révolution va s’exprimer un courant féministe, mais les hommes qui gouvernent n’accorderont pas aux femmes les droits bientôt reconnus aux « nègres » et aux juifs. Elles auront seulement le droit de mourir sur l’échafaud. Restent des initiatives remarquables et remarquées, d’autant plus quand elles sont groupées.
« Vous avez brisé le sceptre du despotisme […] et tous les jours vous souffrez que treize millions d’esclaves portent les fers de treize millions de despotes ! »1325
Requête des dames à l’Assemblée nationale. L’Assemblée constituante, le Philosophisme révolutionnaire en action (1911), Gustave Gautherot
Les grandes oubliées de l’histoire se manifestent à nouveau et ce n’est qu’un début. Après les citoyennes vient le tour des manifestantes, le 5 octobre 1789.
Aux femmes de Paris venues à Versailles demander audience au roi pour réclamer du pain :
« Vous n’en manquiez pas quand vous n’aviez qu’un roi. Allez en demander à nos douze cents souverains ! »1352Comte de SAINT-PRIEST (1735-1821), 5 octobre 1789. Bibliographie moderne ou Galerie historique, civile, militaire, politique, littéraire et judiciaire (1816), Étienne Psaume
Secrétaire d’État à la Maison du roi, nommé ministre de l’Intérieur en août, il désigne en ces termes les députés de la Constituante. Ces nouvelles journées révolutionnaires des 5 et 6 octobre ont pour cause le chômage et la misère, tout ce qui exaspère le peuple de Paris. Aux raisons économiques s’ajoute l’attitude de Louis XVI qui n’a sanctionné ni l’abolition de la féodalité, ni la Déclaration des droits, puis la rumeur de la cocarde tricolore foulée aux pieds lors d’un banquet devant la famille royale.
C’en est trop : une foule de femmes et de chômeurs marche sur Versailles, armée de piques et de fourches. Une délégation est reçue le soir du 5 octobre par le roi. Il promet d’assurer le ravitaillement de Paris où le pain demeure le premier besoin alimentaire du peuple. La manifestation, d’abord pacifique, va dégénérer après une nuit de liesse bien arrosée, alors que La Fayette, présent à Versailles avec ses gardes nationaux, n’a rien vu venir et dort ! Mirabeau le surnommera Général Morphée.

« Nous ne manquerons plus de pain ! Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron. »1356
Cri et chant de victoire des femmes du peuple ramenant le roi, la reine et le dauphin, sur le chemin de Versailles à Paris, 6 octobre 1789. Histoire de la Révolution française (1847), Louis Blanc
Épilogue des deux journées révolutionnaires. Les 6 000 à 7 000 femmes venues la veille de Paris crient aujourd’hui victoire : le roi a promis le pain aux Parisiens. « Père du peuple », il doit assurer la subsistance et le pain tient une grande part dans le budget des petites gens, d’où l’expression : boulanger, boulangère, petit mitron.
« Tant que les femmes ne s’en mêlent pas, il n’y a pas de véritable révolution » écrit Choderlos de Laclos en 1783, dans L’Éducation des femmes. Mais la très symbolique marche des femmes fut encadrée au départ par des meneurs qui ont participé à la prise de la Bastille, trois mois plus tôt. On a vu des hommes armés de piques et de fourches, certains travestis en femmes, trahis par leur voix.
Le soir à 20 heures, le maire de Paris accueille le carrosse royal sous les vivats et les bravos du peuple. Quand Louis XVI peut enfin s’installer aux Tuileries, il n’imagine pas qu’il est désormais prisonnier du peuple parisien.
« Ce sont les femmes qui ont ramené le roi à Paris, et ce sont les hommes qui l’ont laissé échapper ! »1387
Cri de protestation des femmes de Paris, 21 juin 1791. Les 50 mots clefs de la Révolution française (1983), Michel Péronnet
Allusion aux deux journées révolutionnaires d’octobre 1789. Le 21 juin au matin, on constate la disparition de la famille royale, au palais des Tuileries. L’alerte est donnée, La Fayette, commandant de la garde nationale, envoie des courriers tous azimuts pour faire arrêter les fuyards. Paris est en émoi.
Rappelons les faits de la fameuse « fuite à Varennes ». La nuit du 20 juin, la famille royale a fui avec la complicité du comte suédois Axel de Fersen, amant passionné de la reine. Leur but : rejoindre à Metz la garnison royaliste du marquis de Bouillé, pour se placer sous sa protection. Mais la berline royale est trop imposante, l’opération mal organisée… et le roi, déguisé en valet, est reconnu le 21 à Sainte-Menehould (en Champagne) par Jean-Baptiste Drouet, le fils du maître des postes – qui précède le roi à Varennes et donne l’alerte. Bayon, aide de camp de La Fayette, arrive à Varennes au matin du 22 juin. La berline royale est reconduite à Paris sous escorte, rejointe par trois députés envoyés par l’Assemblée : Pétion, Barnave et Latour-Maubourg.
Paris crie à la trahison. Le plan de Louis XVI n’est que trop clair. Il voulait marcher sur Paris avec les troupes royalistes, renverser l’Assemblée, mettre fin à la Révolution et restaurer la monarchie absolue. Il faut éviter l’émeute, on colle un peu partout des affiches avec ce mot d’ordre : « Celui qui applaudira le Roi sera bâtonné, celui qui l’insultera sera pendu. » Toute manifestation est donc interdite, pour ou contre le roi et sa famille qu’on ramène de Varennes.
« Y a-t-il guillotine aujourd’hui ?
— Oui, lui répliqua un franc patriote, car il y a toujours trahison. »1572Reflet de l’état d’esprit du sans-culotte et du terrorisme légal. Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf
La guillotine est un spectacle et « les tricoteuses » s’installent au pied des bois de justice, autrement dit aux premières loges. Les patriotes voient les ennemis du peuple bel et bien punis, cependant que Robespierre multiplie les discours à la Convention, justifiant inlassablement la Terreur. Là encore, les « tricoteuses » sont à l’écoute, même si elles n’ont pas voix au chapitre, ni droit de vote.
« Les Tricoteuses Jacobines, ou de Robespierre. Elles étaient un grand nombre à qui l’on donnait 40 sols par jour pour aller dans la tribune des Jacobins applaudir les motions Révolutionnaires. »
Légende d’une gouache de Jean-Baptiste LESUEUR (1749-1826), Les Tricoteuses Jacobines, vers 1793. Paris, musée Carnavalet
Une gouache de ce peintre inspiré par la politique de manière toujours originale représente un de ces groupes de femmes qui assistaient régulièrement aux séances de la Convention, des clubs populaires et du Tribunal révolutionnaire tout en tricotant.
« Citoyennes « tricoteuses » durant la Révolution… On désignait ainsi les femmes sans-culottes, en majorité tenancières de boutiques (blanchisseries, poissonneries etc.), qui se déplaçaient dans toute la France pour assister aux assemblées pendant la Révolution. Elles écoutaient en tricotant, n’ayant pas la possibilité de prendre la parole ; de là vient l’expression une tricoteuse, terme péjoratif qui désigne une femme aux opinions révolutionnaires. »
Tamara LANDAU (née en 1949), Les tricoteuses : les femmes, le sang et la Révolution, Insistance 2007/1 (n°3)
Initialement surnommées « Jacobines, habituées des tribunes », leurs appels véhéments à la Terreur et leur participation à la chute des Girondins valurent à ces citoyennes le surnom d›« enragées » ou de « furies de la guillotine ». Le 13 mai 1793, elles participeront à la « Fessée républicaine » qui fera sombrer Théroigne de Méricourt dans la folie. Au cours du XIXe siècle, le terme de tricoteuses désignera de façon plus générale toutes les femmes ayant participé aux mouvements revendicatifs entre 1789 et 1795.
« J’ai pris part à tous vos exploits
En vous versant à boire.
Songez combien j’ai fait de fois
Rafraîchir la victoire. »1437BÉRANGER (1780-1857), La Vivandière (1817), chanson
Autre phénomène et première historique sous la Révolution, les femmes se sont engagées pour défendre la « patrie proclamée en danger » par décret du 11 juillet 1792. Les vivandières (étymologie en relation avec la viande et les vivres) suivent les armées pour y vendre non seulement des vivres, des boissons, du tabac, mais aussi des objets de première nécessité.
Présent à Paris aux premières heures de la Révolution, républicain de cœur, Pierre Jean de Béranger trouve aussitôt son expression dans la chanson patriotique. Il n’imaginait pas que son nom reste dans l’histoire et c’est pourtant l’un de nos chansonniers les plus populaires !
Il rend ici hommage à l’entrée sur la scène de l’histoire de ces femmes volontaires aux armées : « Vivandière du régiment / C’est Catin qu’on me nomme / Je vends, je donne et bois gaîment / Mon vin et mon rogome [alcool]. / J’ai le pied leste et l’œil mutin, / Tintin, tintin, tintin, r’lin tintin ; / J’ai le pied leste et l’œil mutin : / Soldats, voilà Catin ! » - d’où l’autre nom de « cantinières ». Catin, diminutif de Catherine (prénom en vogue), devient plus tard synonyme de « femme de mauvaise vie » ou prostituée.
Cantinières et vivandières suivront toutes les guerres de la Révolution et de l’Empire. N’oublions pas les blanchisseuses, également inscrites dans les registres.

2. Marianne, symbole allégorique de la République française et par extension de la France, depuis la Révolution.
« Et l’élixir de Dumouriez,
Frotté à la plante des pieds,
Lui a bien dégagé le poumon :
Marianne se trouve mieux (bis). ».Guillaume LAVABRE (1755-1845), La Guérison de Marianne (La Garisou de Marianno) (1792)
Cordonnier de Puylaurens (dans le Tarn) et poète à ses heures, il écrit en occitan la première chanson où figure le nom de Marianne (prénom courant dans la région) associé à la toute jeune République en termes imagés, mais conformes à la réalité. Rappelons le contexte véritablement historique.
Sous les ordres du général Dumouriez, le maréchal de France Kellermann rallié à la Révolution remporte la victoire de Valmy, le 20 septembre 1792. L’armée prussienne commandée par le duc de Brunswick qui marchait sur Paris fait retraite à l’est, au niveau de ce petit village de Champagne-Ardenne : l’invasion de la France est stoppée (miraculeusement, vu les forces respectives !) Les troupes françaises crient pour la première fois « Vive la Nation » et le lendemain la République est décrétée par le premier décret de la nouvelle Convention, le 21 septembre. En vertu de quoi « Marianne se trouve mieux ».
« Elle est née dans le Paris 1790
Comme une rose épanouie
Au jardin des fleurs de lys.
Marianne a cinq enfants
Qu’elle élève de son mieux
Marianne a maintenant
Quelques rides au coin des yeux.
Dieu ! Mais que Marianne était jolie
Quand elle marchait dans les rues de Paris
En chantant à pleine voix
Ça ira, ça ira… toute la vie. »Michel DELPECH (née en 1946) Que Marianne était jolie ! (1972), musique de Pierre Papadiamandis
En termes allégoriques, la chanson évoque l’histoire de la France, de la Révolution dans le Paris de 1790 jusqu’à Mai 68.
Les « cinq enfants » de Marianne, dont « quatre fils qu’elle a perdus », fait allusion à la Cinquième République et aux quatre autres républiques « défuntes ».
L’origine du prénom est incertaine. Seule certitude, « Marianne » est la contraction de Marie (la Vierge, mère de Jésus) et Anne (sa propre mère), les deux prénoms les plus répandus au XVIIIe siècle dans les milieux populaires à la campagne et parmi les domestiques des noble. Ils sont logiquement choisis et associés pour représenter la très jeune République née le 21 septembre 1792 (abolition de la monarchie votée à l’unanimité des députés au premier jour de la Convention).
À partir de juin 1848 (Deuxième République), le prénom « Marianne » désigne de façon clandestine la République. Mais au cours du XIXe siècle, Marianne, surnom donné aux jeunes femmes de mœurs légères, est également employé de manière péjorative par les très nombreux adversaires de la République : curieux consensus entre les révolutionnaires républicains et leurs adversaires aristocrates pour qui Marianne est un prénom méprisable.
Quant au bonnet rouge de Marianne, il rappelle le bonnet phrygien des esclaves affranchis sous la Rome antique et symbolise la Liberté, première valeur de la trilogie républicaine. Marianne incarne symboliquement la France libérée de l›« esclavage » de la monarchie absolue et les sans-culottes de la Révolution portaient volontiers ce bonnet rouge.
Le buste féminin a évolué au cours des siècles. À l’origine, c’est une femme sculptée à l’antique aux traits réguliers et sévères, poitrine cachée par un voile moulant retenu par une agrafe. Le sein se dévoile ensuite, l’attitude devient provocante, « révolutionnaire ». Voir La Liberté guidant le peuple, célèbre tableau d’Eugène Delacroix, allégorie de la révolution parisienne des Trois Glorieuses journées de juillet 1830. Au XXe siècle, les traits du visage sont adoucis et personnalisés. Une Marianne aura le buste de Brigitte Bardot, avant Catherine Deneuve. En 1999, la mairie de Frémainville (Val d’Oise) inaugure une Marianne noire. Ainsi va l’Histoire et l’incarnation républicaine de notre Marianne.
« À bas la Marianne, la fille à Bismarck,
La France est à nous, la France de Jeanne d’Arc. »2646Me MAGNIER (fin XIXe-début XXe siècle), Quand on pendra la gueuse au réverbère, chanson
Dans cette chanson écrite sans doute en 1909, signée d’un avocat à la cour d’appel de Paris et très en vogue chez les Camelots du roi (extrême droite) dans l’entre-deux-guerres, la République est traitée de « gueuse », femme de mauvaise vie. Il est aussi question de régler leur compte aux « youpins » (juifs), aux « métèques » (étrangers) et aux francs-maçons, à Briand, Painlevé, Doumergue et autres politiciens honnis par l’Action française. Dans le même esprit, Charles Maurras prône le « nationalisme intégral » dont la violence répond d’ailleurs à celle des militants de gauche.
« Il n’y a pas si longtemps
Que l’on se battait pour elle
Et j’ai connu des printemps
Qui brillaient sous son soleil.
Marianne à cinq enfants,
Quatre fils qu’elle a perdus
Le cinquième à présent
Qu’elle ne reconnaît plus.
Dieu ! Mais que Marianne était jolie
Quand elle marchait dans les rues de Paris
En chantant à pleine voix
Ça ira, ça ira… toute la vie. »Michel DELPECH (né en 1946), Que Marianne était jolie ! (1972), musique de Pierre Papadiamandis
La suite de la chanson fait naturellement allusion à l’autre révolution, la plus récente et la plus plaisante – celle de la jeunesse et de la société, en Mai 68.
« Marianne est une rebelle, elle ne laissera pas tomber Gavroche. »
Noël MAMÈRE (né en 1948), Ma république (1999)
Journaliste et homme politique français, partisan d’une écologie politique, membre des Verts puis d’Europe Écologie Les Verts (EÉLV) jusqu’en 2013, maire de Bègles de 1989 à 2017 et député de 1997 à 2017, candidat à l’élection présidentielle de 2002, il obtint 5,25 % des suffrages, soit le meilleur score réalisé par les écologistes à ce jour.
Quant à Gavroche, faut-il rappeler que ce gamin de Paris naît (et meurt sur une barricade révolutionnaire le 6 juin 1832) dans Les Misérables de Victor Hugo, roman historique, social et philosophique, publié en 1862, maintes fois adapté à l’écran et sur scène.

3. Olympe de Gouges (1755-1793), l’une des premières féministes déclarées, victime des révolutionnaires.
« La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune. »1397
Olympe de GOUGES (1755-1793), Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, septembre 1791. Le XIXe siècle et la Révolution française (1992), Maurice Agulhon
Le préambule du texte est dédié à la reine. Cette féministe, l’une des premières de l’histoire à se situer clairement sur le plan politique, mourra guillotinée en 1793 après bien d’autres provocations, y compris sur des scènes de théâtre où elle exprime ses idées, défiant déjà la censure sous l’Ancien Régime.
Elle plaide ici pour l’égalité entre les sexes, ce qui inclut le droit de vote et l’éligibilité (permettant de monter à la tribune en tant que député). Mais c’est impossible aussi longtemps que la femme est considérée comme juridiquement mineure, soumise au père ou à l’époux – cela vaudra également avec le Code civil napoléonien, incontestable progrès juridique, mais notoirement misogyne. Les femmes seront finalement la « minorité » la plus durablement brimée, dans cette histoire. Quelques-unes vont s’illustrer, héroïnes et souvent martyres, dans la suite de la Révolution.
Olympe de Gouges se bat aussi pour la cause des Noirs et l’abolition de l’esclavage.
« Enfants de la Patrie, vous vengerez ma mort. »1552
Olympe de GOUGES (1755-1793), guillotinée le 3 novembre 1793. Son mot de la fin. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, avec le Journal de ses actes (1880), Henri Alexandre Wallon
Féministe coupable d’avoir écrit une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a aussi défendu le roi, puis courageusement attaqué Robespierre en « brissotine » (synonyme de girondine) avant d’être arrêtée en juillet 1793.
Femme de lettres, femme libre jusqu’à la provocation, elle est comparable à George Sand au siècle suivant, mais ce genre d’attitude est encore plus mal vu en 1793 ! Et la reconnaissance espérée par la condamnée sera tardive.
« Rappelez-vous cette virago, cette femme-homme, l’impudente Olympe de Gouges qui abandonna tous les soins du ménage, voulut politiquer […] Cet oubli des vertus de son sexe l’a conduite à l’échafaud. »1553
Pierre-Gaspard CHAUMETTE (1763-1794), au club des Jacobins, novembre 1793. Les Femmes et la politique (1997), Armelle Le Bras-Chopard, Janine Mossuz-Lavau
La suite de son cours de morale qui invoque la Nature et les droits naturels est d’une implacable misogynie : « Tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le feu vengeur des lois, et vous voudriez les imiter ? Non, vous sentez que vous ne serez intéressantes et vraiment dignes d’estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, c’est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. »
Procureur de la Commune insurrectionnelle de Paris, Chaumette fait cette même année un discours dans le même esprit à la tribune de la Convention, preuve que le thème lui tient à cœur : « Depuis quand est-il d’usage de voir les femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir sur la place publique, dans la tribune aux harangues, à la barre du Sénat, dans les rangs de nos armées, remplir les devoirs que la nature a répartis à l’homme seul ? »
Qu’en pensaient nos tricoteuses, assistant toujours muettes à ce genre de propos ?

4. Mme Roland (1754-1793), ennemie personnelle de Danton, égérie des Girondins et plus courageuse que tous « ses » hommes, face à la mort.
« Le monde appelle fous ceux qui ne sont pas fous de la folie commune. »
Mme ROLAND (1754-1793), Correspondance politique (1790-1793)
Cette pensée prend toute sa valeur à l’heure de la Terreur dont elle fut parmi les plus courageuses victimes.
Madame Roland est surtout connue pour avoir été la femme de son mari : l’histoire est injuste. Très cultivée, courtisée, mais fidèle, révolutionnaire de la première heure, elle est montée à Paris avec Jean-Marie Roland de la Platière en 1791. Elle tient salon rue Guénégaud, reçoit les Brissot, Buzot, Pétion, Robespierre, Couthon, brille de tous les feux de son intelligence et se passionne pour la politique, plus excitante que la vie conjugale avec un époux de vingt ans son aîné - qualifié par elle de vénérable vieillard et qu’elle aime comme un père. C’est elle, l’âme du mouvement girondin.
Elle donne bientôt à dîner deux fois par semaine et s’épanouit dans ce rôle de « salonnière » où s’illustrèrent nombre de femmes au siècle des Lumières (Mme du Deffand, Mme Geoffrin, Julie de l’Espinasse et autres Mme Necker). Tous les hommes en vue du parti « patriote » fréquentent son salon. Détestant Mirabeau et les Monarchiens qui tentent de maintenir une monarchie constitutionnelle à l’anglaise, favorable à tous les combats pour l’égalité civique (celle des hommes de couleur, des citoyens passifs, etc.), elle commence à jouer de son influence en républicaine ardente.
Son mari est nommé à l’Intérieur grâce aux relations de sa femme dont l’influence est prépondérante durant les trois mois de ce ministère girondin (mars-juin 1792). C’est elle qui rédige la fameuse « lettre au roi » signée par Roland qui adjure Louis XVI de renoncer à son veto - lettre qui lui vaut d’être renvoyé trois jours plus tard. Après le 10 août 1792 qui consacre la chute de la monarchie, Roland est rappelé au ministère. Véritable égérie, elle prend de plus en plus de pouvoir. Elle n’invite plus les Montagnards – leur folie devient inquiétante. Femme d’un ministre respecté, adulée par ses amis, exaltée comme une reine par ses nombreux soupirants, elle jouit de l’opinion flatteuse qui l’entoure. L’influence qu’on lui prête, grossie par la suspicion, alimente les rancœurs de libellistes toujours prêts à la calomnie et au mensonge. Dès l’automne, Manon et son mari se heurtent aux perfidies, allusions scandaleuses, atteintes odieuses à leur intimité destinées à déconsidérer les mœurs de l’une, le caractère de l’autre. Roland étant ridiculisé sous le surnom de « Coco Roland », les Hébertistes et les Montagnards discréditent la « Reine Coco », accusée d’accaparement et d’étalage de luxe – un crime à l’époque. Elle tient bon ! La « folie » manifeste des massacres de septembre va bouleverser le cours de sa vie.
« Le tocsin qui sonne n’est point un signal d’alarme, c’est la charge contre les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, Messieurs, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France est sauvée. »1428
DANTON (1759-1794), Législative, 2 septembre 1792. Discours de Danton, édition critique (1910), André Fribourg
« De l’audace… » La fin du discours est célébrissime et propre à galvaniser le peuple et ses élus : « Danton fut l’action dont Mirabeau avait été la parole », écrit Hugo (Quatre-vingt-treize).
Ce 2 septembre, la patrie est plus que jamais en danger. La Fayette, accusé de trahison, est passé à l’ennemi. Dumouriez qui a démissionné de son poste de ministre l’a remplacé à la tête de l’armée du Nord, sans parvenir à établir la jonction avec Kellermann à Metz. Verdun vient de capituler, après seulement deux jours de siège : les Prussiens sont accueillis avec des fleurs par la population royaliste. C’est dire l’émotion chez les révolutionnaires à Paris !
La rumeur court d’un complot des prisonniers, prêts à massacrer les patriotes à l’arrivée imminente des Austro-Prussiens. On arrête 600 suspects qui rejoignent les prisonniers. Quelques dizaines de sans-culottes font irruption dans les prisons parisiennes, la Conciergerie, l’Abbaye, Bicêtre. À la Force, la princesse de Lamballe, confidente de la reine, est dépecée par les émeutiers, sa tête plantée sur une pique promenée sous la fenêtre de Marie-Antoinette, prisonnière au Temple.
Les massacres du 2 au 6 septembre 1792 feront quelque 1 500 morts (sur 3 000 prisonniers). Des « droits commun » sont égorgés en même temps que les « politiques », nobles et prêtres.
« Vous connaissez mon enthousiasme pour la Révolution. Eh bien ! j’en ai honte. Elle est ternie par des scélérats, elle est devenue hideuse. »1433
Mme ROLAND (1754-1793), Lettre à un ami, 5 septembre 1792. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Mme Roland reflète l’opinion publique d’une grande partie de la France, au lendemain de cette folie meurtrière des sans-culottes parisiens. Épouvantée, elle devient favorable au fédéralisme et hostile au pouvoir populaire, vouant désormais à Danton une haine féroce qu’il lui rendra bien, étant le grand homme du jour (avant d’être supplanté par Robespierre).
« Danton conduit tout ; Robespierre est son mannequin, Marat tient sa torche et son poignard ; ce farouche tribun règne et nous ne sommes que des opprimés, en attendant que nous tombions ses victimes. »
Mme ROLAND (1754-1793), Lettre à Bancal, 9 septembre 1792. Correspondance
Elle a désormais perdu toute illusion sur la Révolution, plus lucide que tous ses amis girondins ! Elle pousse Buzot (la passion platonique de sa vie) et Roland à attaquer toujours plus violemment Robespierre et Danton. En vain. Et Danton, quoique sans la nommer, lui déclare la guerre.
« Nous avons besoin de ministres qui voient par d’autres yeux que ceux de leur femme. »
DANTON (1759-1794), Étude sur madame Roland et son temps (1864), Charles-Aime Dauban
Publiquement à la tribune, il voue « Coco » Roland au ridicule et Manon Roland à la haine des Montagnards. Elle devient furieuse. Les Montagnards multiplient désormais les attaques contre les Girondins. Cette guerre fratricide aboutira à la Terreur, « folie commune » de courte durée.
Lassé des attaques, le ministre de l’Intérieur démissionne le 23 janvier 1793. Le couple s’éloigne du pouvoir, mais Madame Roland ne peut renoncer à la politique, que ce soit raison ou folie.
Le 31 mai 1793, lors de la proscription des Girondins, elle ne fuit pas, comme elle aurait pu le faire et comme le font, entre autres, son mari et Buzot. Roland s’échappe vers Rouen, Manon Roland se laisse arrêter le 1er juin à son domicile. Incarcérée dans la prison de l’Abbaye, elle ressent comme un soulagement qu’elle décrit à Buzot dans une de ces pages de la correspondance passionnée et déchirante qu’ils échangent alors : « Je chéris ces fers où il m’est libre de t’aimer sans partage ». Relâchée le 24 juin, pendant une heure, elle est à nouveau arrêtée et placée à Sainte-Pélagie puis transférée à la Conciergerie où elle reste cinq mois.
« L’audace sur le front, le rire de la débauche sur les lèvres, la férocité de son visage dénonce celle de son cœur ; il emprunte inutilement de Bacchus une apparente bonhomie et la jovialité des festins ; l’emportement de ses discours, la violence de ses gestes, la bestialité de ses jurements le trahissent. »1298
Mme ROLAND (1754-1793), Mémoires (posthume)
Ce texte comporte une part de vérité. Mais le portrait est totalement à charge – Danton a ses défenseurs. Mme Roland déteste viscéralement Danton, l’ennemi politique de son mari et de tous les Girondins emprisonnés en attendant la mort.
« J’aime mieux mourir que d’être témoin de la ruine de mon pays ; je m’honorerai d’être comprise parmi les glorieuses victimes immolées à la rage du crime. »1511
Mme ROLAND (1754-1793), Mémoires (posthume, 1821)
En prison, elle écrit ses Mémoires (et certaines lettres qui n’y figurent pas), elle rédige aussi son Projet de défense au Tribunal révolutionnaire. Mais elle ne se fait pas d’illusion : « Il est nécessaire que je périsse à mon tour, parce qu’il est dans les principes de la tyrannie de sacrifier ceux qu’elle a violemment opprimés et d’anéantir jusqu’aux témoins de ses excès. À ce double titre, vous me devez la mort et je l’attends. »
« Le brigand qui persécute, l’homme exalté qui injurie, le peuple trompé qui assassine suivent leur instinct et font leur métier. Mais l’homme en place qui les tolère, sous quelque prétexte que ce soit, est à jamais déshonoré ! »1513
Mme ROLAND (1754-1793), Lettre au ministre de l’Intérieur, 20 juin 1793, prison de l’Abbaye. Lettres de Madame Roland de 1780 à 1793 (1902), publiées par Claude Perroud.
« L’homme en place », le ministre s’appelle Garat. C’est lui qui a remplacé Roland, son mari. Elle le connaît et le juge ainsi : « aimable homme de société, homme de lettres médiocre et détestable administrateur ». Il l’a laissé arrêter et emprisonner à l’Abbaye.
Jean-Marie Roland a réussi à fuir avec quelques Girondins. Les Montagnards n’ont cessé de multiplier leurs attaques dans le Père Duchesne contre « Coco Roland » et sa femme, « Madame Coco » ou « la reine Coco ». Elle abomine ce genre de surnom qui lui vient par ricochet, d’autant plus injuste qu’elle a plus de tempérament (naturel et révolutionnaire) que son mari ! Elle le prouvera jusqu’à la fin.
« Les tyrans peuvent me persécuter : mais m’avilir ? Jamais, jamais ! »1518
Mme ROLAND (1754-1793), Lettre à Buzot. Mémoires de Mme Roland (1840), Mme Roland, Jules Ravenel
Écrite dans sa prison de l’Abbaye, au début de l’été 1793. « Derrière les grilles et les verrous, je suis plus paisible avec ma conscience que mes oppresseurs ne le sont avec leur domination. » Transférée à la Conciergerie, dite l’antichambre de la mort, attendant son jugement, elle est respectée par les gardiens, elle peut avoir du matériel pour écrire et recevoir quelques visites. Ses Mémoires – sous-titrées Appel à l’impartiale postérité – sont destinées à sa fille Eudora. Jugée le 8 novembre, tout de blanc vêtue, à 39 ans, elle se présente devant le Tribunal révolutionnaire. La sentence est mise à exécution le soir même.
« Liberté, que de crimes on commet en ton nom ! »1554
Mme ROLAND (1754-1793), montant à l’échafaud et s’inclinant devant la statue de la Liberté (sur la place de la Révolution), 8 novembre 1793. Le Nouveau Tableau de Paris (1799), Louis Sébastien Mercier.
Son mari, poursuivi comme Girondin et réfugié à Rouen, apprenant la mort de sa femme, se tuera deux jours après. Son ami Buzot qui a fui comme son mari pour échapper au sort des Girondins, se suicidera lui aussi en juin 1794, apprenant la mort de Manon Roland.

5. Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), une carrière de portraitiste originale qui défie le monopole masculin dans les Beaux-Arts et fait place à l’enfant.
« Je n’ai eu de Bonheur qu’en peinture. »;
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Citation en exergue de l’Exposition au Grand Palais qui rend justice à l’artiste, septembre 2015
Une longue et belle vie d’artiste avec des succès plus que mérités, l’atout et le handicap d’être femme, des épreuves personnelles surmontées avec courage et le séisme historique de la Révolution, poursuivant sa carrière de portraitiste en Europe avant son retour en France. Considérée comme la grande portraitiste de son temps, comparée aux maîtres du genre, Quentin de La Tour ou Jean-Baptiste Greuze, elle devra pourtant attendre 2015 pour avoir en France une Exposition à son nom.
« J’ai constamment suivi ses avis ; car je n’ai jamais eu de maître proprement dit. »
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Souvenirs de Madame Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun (1835-1837)
Elle parle de Joseph Vernet, peintre français célèbre en Europe, qu’elle rencontre au Louvre à 14 ans. En tant que femme, l’Académie lui est théoriquement fermée, mais l’enfant surdouée n’a pas manqué de maîtres, à commencer par son père Louis Vigée, frappé par la justesse de ses premiers dessins. À sa mort, Gabriel-François Doyen, grand ami de la famille et peintre d’histoire coté en son temps, l’encourage à persévérer dans le pastel et dans l’huile. Elle suivra ce conseil.
« On pouvait exactement me comparer à l’abeille, tant j’y récoltais de connaissances… »
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Souvenirs de Madame Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun (1835-1837)
Comme la plupart des peintres, le Louvre sera sa grande école, avec le palais du Luxembourg et les collections d’art privées princières et aristocratiques où elle peut étudier à loisir les maîtres, copier des têtes de Rembrandt ou de Greuze, étudier les semi-tons et les dégradations. Elle gardera ce besoin d’apprendre, consciente qu’un don se travaille.
Déjà, on lui commande des portraits, elle commence à gagner sa vie. Son premier tableau reconnu en 1770 est un portrait de sa mère. Elle a 14 ans.
À 18 ans, elle obtient sa première commande de la Cour et à 23 ans, elle devient peintre officielle de la reine. La protection de Marie-Antoinette lui permet d’être reçue à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1783, mais pas comme peintre d’histoire. L’art du portrait y a sans doute gagné…
La même année, elle doit peindre Marie-Antoinette « d’après nature » : la reine apparaît vêtue d’une robe-chemise vaporeuse, sans corset ni paniers, simplement resserrée à la taille par un large ruban, sans bijou et coiffée d’un chapeau de paille, comme dans son domaine de Trianon. Un petit chef d’œuvre. Mais tant de naturel fait scandale… Mme Vigée Le Brun reprend ses pinceaux en urgence : même pose et même cadrage, mais la reine est vêtue d’une robe d’apparat en soie moirée gris bleu aux reflets argentés, parée de perles avec un chapeau à grandes plumes sur la tête. Ce tableau politiquement correct, Marie-Antoinette à la rose, aujourd’hui le portrait le plus célèbre de la dernière reine de France, obtient le succès mérité.
Les clients fortunés suivent. La petite bourgeoise a trouvé sa place dans la haute société. En 1775, Louise-Élisabeth Vigée a épousé Jean-Baptiste-Pierre Le Brun, joueur invétéré, coureur de jupons et peintre à ses heures. Il exploitera la célébrité de son épouse, lui donnant 6 francs sur des tableaux vendus 12 000, mais il se révélera marchand très talentueux et profitable à sa carrière.
« J’avais sur l’argent une telle insouciance, que je n’en connaissais presque pas la valeur. »
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Souvenirs de Madame Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun (1835-1837)
Au soir de sa vie, elle reconnaît l’évidence, mais nombre de privilégiés n’avaient pas cette intelligence à la fin de l’Ancien Régime. Un certain « souper grec » défraye la chronique par l’ostentation qui s’y déploie, on la soupçonne d’avoir dépensé une fortune. Des lettres et des libelles circulent dans Paris sur sa relation avec Calonne (ministre des Finances réputé pour son laxisme). On l’accuse aussi d’avoir des lambris d’or, d’allumer son feu avec des billets de caisse, de brûler du bois d’aloès dans sa cheminée. Le coût du dîner de 20 000 francs fut rapporté au roi Louis XVI qui s’emporta contre l’artiste de sa femme - elle-même fort dépensière et de plus en plus impopulaire.
« Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. »
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Souvenirs de Madame Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun (1835-1837)
Juillet 1789, elle travaille à Louveciennes chez la comtesse du Barry, dernière favorite de Louis XV dont elle fait le portrait, quand les deux femmes entendent le canon tonner dans Paris. Fervente royaliste, son hôtel particulier est saccagé par les sans-culottes et en octobre 1789, elle fuit la capitale. Elle part avec sa fille Julie, sa gouvernante et cent louis. Tandis que le marché de l’art s’effondre à Paris, elle trouve refuge en Italie, puis en Russie, sa « seconde patrie », et à Londres, à Viennes, invitée finalement dans toutes les cours d’Europe et peignant sans relâche. Rayée de l’infamante « liste des émigrés », elle rentre précipitamment sous le Directoire – sa mère est mourante, sa fille se marie « mal » et son mari a divorcé – d’une émigrée fatalement coupable.
« Je n’essaierai point de peindre ce qui se passa en moi lorsque je touchai cette terre de France que j’avais quittée depuis douze ans : la douleur, l’effroi, la joie qui m’agitaient tour à tour… Je pleurais les amis que j’avais perdus sur l’échafaud ; mais j’allais revoir ceux qui me restaient encore […] Ce qui me déplaisait bien davantage, c’était de voir encore écrit sur les murs : liberté, fraternité ou la mort. »
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Mémoires d’une portraitiste, 1855
Elle peine à retrouver sa place dans la société – et son mari avec qui elle renoue pourtant, lui rachetant bientôt son propre hôtel ! Elle part retravailler trois ans à Londres, retrouve la cour de Louis XVIII en exil et va même recevoir une commande d’une des sœurs de Napoléon, devenue par son mariage avec Murat reine de Naples… et cliente sans-gêne.
« J’ai peint de véritables princesses qui ne m’ont jamais tourmentée et ne m’ont pas fait attendre. »
Élisabeth VIGEE-LEBRUN (1755-1842), Mémoires d’une portraitiste, 1855
En 1805, l’artiste quinquagénaire et sûre de son grand talent partout reconnu ne ménage pas cette jeune reine parvenue.
En 1809, elle revient définitivement en France, partageant désormais sa vie entre Paris où elle tient salon en hiver et Louveciennes, près du château de son amie la comtesse du Barry (guillotinée en 1793). Elle peint toujours et sous la Restauration, ses tableaux retrouvent leur place au Louvre, à Versailles et à Fontainebleau. Elle salue naturellement le retour de Louis XVIII, « le monarque qui convenait à l’époque ». Mue par un esprit de curiosité infinie, elle ouvre grand son salon à la jeune génération romantique.
Mais sa fille meurt dans la misère et elle se reproche d’avoir été trop sévère avec elle, son frère Étienne sombre dans l’alcoolisme après une vie totalement ratée, son ami le peintre Antoine-Jean Gros se suicide. Elle-même tombe malade et finira aveugle, mais elle aura pris le temps de rédiger (et dicter en partie) ses mémoires et de prévoir son lieu de sépulture.
« Une belle femme, d’un abord agréable, d’une conversation enjouée, elle jouait d’un instrument, était une bonne actrice, avait des talents de société qui lui ont facilité son intégration dans les milieux mondains et un grand talent de portraitiste qui possédait l’art de flatter ses modèles. »
Geneviève HAROCHE-BOUZINAC, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, histoire d’un regard (2011)
C’est la leçon tirée par sa biographe, juste hommage rendu à cette vie d’artiste et cette œuvre originale à plus d’un titre. Sur ses quelque 900 tableaux, 660 sont des portraits mettant en valeur le charme essentiellement féminin, avec l’apparition du sourire et des dents apparentes.
À l’époque, c’était « mal vu », fait du peuple ou de sujets ne maîtrisant pas leurs émotions (peur, rage, extase…). Sans parler de la mauvaise hygiène, des dents gâtées ou des bouches édentées. Mais la dentisterie fait des progrès et les femmes se mettent à sourire, à commencer par Élisabeth Vigée-Lebrun dans son autoportrait.
Autre miracle, l’enfant paraît, soit objet de la « tendresse maternelle » (surnom donné à son premier autoportrait avec sa fille Julie), soit sujet unique du tableau. Ainsi a-t-elle immortalisé plusieurs fois son enfant et son ami le peintre Gros à sept ans, tous deux trop tôt disparus et pleurés par l’octogénaire.
« Ici, enfin, je repose. »
Épitaphe sur la tombe d’Élisabeth VIGÉE-LEBRUN, cimetière de Louveciennes
À la fin du XXe siècle, son œuvre est célébrée aux États-Unis avec une exposition en 1982, également très commentée et étudiée par les féministes américaines dans une analyse de la politique culturelle des arts, vue à travers les questions que pose sa carrière exceptionnelle : le parallélisme entre le lien qui l’unit à Marie-Antoinette, la société courtisane qui fonde sa clientèle royaliste, son attitude face à la Révolution, l’interdiction faite aux femmes d’étudier aux Beaux-Arts par la Constituante, son narcissisme et la maternité comme identité féminine prolongeant la remarque de Simone de Beauvoir.

6. Marie-Antoinette (1755-1793), destin de princesse et de femme qui passe du meilleur au pire et dépasse une reine devenue trop tard digne de ce nom.
« Ne parlez point allemand, Monsieur ; à dater de ce jour, je n’entends plus d’autre langue que le français. »1186
MARIE-ANTOINETTE d’Autriche (1755-1793), à M. d’Antigny, chef de la Cité (Strasbourg), 7 mai 1770. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Il lui adressait la bienvenue en allemand. On parle couramment le français dans toutes les cours d’Europe. C’est aussi la langue de la diplomatie. Mais Marie-Antoinette, à 14 ans, est sans doute l’une des princesses les moins couramment francophones, vue son éducation imparfaite à la cour d’Autriche.
La jeune « princesse accomplie » va à la rencontre de son fiancé le dauphin Louis (futur Louis XVI) et de toute la cour qui l’attend à Compiègne. Elle a déjà dû, selon l’étiquette de la cour, se dépouiller de tout ce qui pouvait la rattacher à son ancienne patrie, pour s’habiller à la mode française. Le mariage fut négocié par le ministre Choiseul et la mère de la mariée, également soucieux de réconcilier les Bourbons et les Habsbourg. L’alliance autrichienne renforce la position de la France en Europe, en cas de guerre avec l’Angleterre ou la Prusse.
« Madame, vous avez là deux cent mille amoureux. »1192
Duc de BRISSAC (1734-1792), gouverneur de Paris, à Marie-Antoinette, 8 juin 1773. Mémoires de Mme la comtesse du Barri (posthume, 1829), Jeanne Bécu du Barry
Le vieux courtisan lui montre la foule immense venue l’acclamer pour son entrée solennelle à Paris. La Dauphine de France découvre le peuple se pressant dans les jardins de Versailles pour l’entrevoir. Cet excès de popularité a retardé de trois ans son entrée dans la capitale – elle s’est mariée avec le Dauphin le 16 mai 1770, à Versailles.
Elle écrira à l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche : « Je ne puis vous dire, ma chère maman, les transports de joie, d’affection, qu’on nous a témoignés. Avant de nous retirer, nous avons salué avec la main le peuple, ce qui a fait grand plaisir. Qu’on est heureux dans notre état de gagner l’amitié d’un peuple à si bon marché ! Il n’y a pourtant rien de si précieux. Je l’ai senti et je ne l’oublierai jamais. » Plus dure sera la chute – on ne peut lire ces mots sans se rappeler la fin de l’histoire, sous la Révolution.
« Mon Dieu, guidez-nous, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ! »1205
LOUIS XVI (1754-1793) et MARIE-ANTOINETTE (1755-1793), Versailles, 10 mai 1774. Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre ; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI (1823), Jeanne-Louis-Henriette Genet Campan
Louis XV est mort, les courtisans se ruent vers le nouveau roi. Le petit-fils du défunt roi, âgé de 20 ans, est tout de suite effrayé par le poids des responsabilités, plus qu’enivré par son nouveau pouvoir. Marie-Antoinette est d’un an sa cadette. Est-elle déjà consciente de ce qui attend la reine de France ?
« Belle, l’œil doit l’admirer,
Reine, l’Europe la révère,
Mais le Français doit l’adorer,
Elle est sa reine, elle est sa mère. »1207Romance en l’honneur de Marie-Antoinette, chanson (1774). Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La jeune et jolie reine jouit d’une immense popularité depuis son arrivée en France il y a quatre ans et Versailles la salue en ce style précieux. C’est l’état de grâce, comme jamais avant et jamais après.
Certes, il y a des jalousies et déjà quelques soupçons contre l’« Autrichienne » à la cour. On aura plus tard la preuve qu’elle est manipulée par sa famille autrichienne, restant très attachée à sa mère, Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche durant trente ans et forte personnalité.
Délaissée par son royal époux, peu soucieuse de l’étiquette à la cour et moins encore des finances de l’État, dépensière et futile, Marie-Antoinette va accumuler les erreurs. « Ma fille court à grands pas vers sa ruine », confie sa mère à l’ambassadeur de France à Vienne, en 1775. Pour l’heure, et pour trois ans encore, le peuple adore sa reine. La suite sera d’autant plus brutale et en partie injuste.
« Plus scélérate qu’Agrippine
Dont les crimes sont inouïs,
Plus lubrique que Messaline,
Plus barbare que Médicis. »1242Pamphlet contre la reine. Vers 1785. Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf
Dauphine jadis adorée, la reine est devenue terriblement impopulaire en dix ans, pour sa légèreté de mœurs, mais aussi pour ses intrigues et son ascendant sur un roi faible jusqu’à la soumission. L’affaire du Collier va renforcer ce sentiment.
La Révolution héritera certes de l’œuvre de Voltaire et de Rousseau, mais aussi des « basses Lumières », masse de libelles et de pamphlets à scandale où le mauvais goût rivalise avec la violence verbale, inondant le marché clandestin du livre et sapant les fondements du régime. Après le Régent, les maîtresses de Louis XV et le clergé, Marie-Antoinette devient la cible privilégiée : quelque 3 000 pamphlets la visant relèvent, selon la plupart des historiens, de l’assassinat politique.
« Une femme, la honte de l’humanité et de son sexe, la veuve Capet, doit enfin expier ses forfaits sur l’échafaud. »1538
Jean-Nicolas BILLAUD-VARENNE (1756-1819), Convention, 3 octobre 1793. L’Agonie de Marie-Antoinette (1907), Gustave Gautherot
Un parmi d’autres conventionnels à réclamer la mise en jugement de la « Panthère autrichienne ». Marie-Antoinette, en prison depuis près d’un an, attendait son sort au Temple, avant son transfert à la Conciergerie, le 1er août 1793.
Le 3 octobre, au moment où la Convention vient de décréter que les Girondins seront traduits devant le Tribunal révolutionnaire, Billaud-Varenne parle en ces termes : « Il reste encore un décret à rendre : une femme, la honte de l’humanité et de son sexe, la veuve Capet, doit enfin expier ses forfaits sur l’échafaud. On publie qu’elle a été jugée secrètement et blanchie par le Tribunal révolutionnaire, comme si une femme qui a fait couler le sang de plusieurs milliers de Français pouvait être absoute par un jury français. Je demande que le Tribunal révolutionnaire prononce cette semaine sur son sort. » La Convention adopte cette proposition.
« Immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine, elle est si perverse et si familière avec tous les crimes qu’oubliant sa qualité de mère, la veuve Capet n’a pas craint de se livrer à des indécences dont l’idée et le nom seul font frémir d’horreur. »1541
FOUQUIER-TINVILLE (1746-1795), Acte d’accusation de Marie-Antoinette, Tribunal révolutionnaire, 14 octobre 1793. Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (1862), Émile Campardon
« Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche, âgée de 37 ans, veuve du roi de France », ayant ainsi décliné son identité, a répondu le 12 octobre à un interrogatoire (secret) portant sur des questions politiques et sur le rôle qu’elle a joué auprès du roi, au cours de divers événements, avant et après 1789. Elle nie pratiquement toute responsabilité.
Au procès, cette fois devant la foule, elle répond à nouveau et sa dignité impressionne. L’émotion est à son comble, quand Fouquier-Tinville aborde ce sujet intime des relations avec son fils. L’accusateur public ne fait d’ailleurs que reprendre les rumeurs qui ont moralement et politiquement assassiné la reine en quelque 3 000 pamphlets, à la fin de l’Ancien Régime. L’inceste (avec un enfant âgé alors de moins de 4 ans) fut l’une des plus monstrueuses.
« Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature se refuse à répondre à pareille inculpation faite à une mère : j’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. »1542
MARIE-ANTOINETTE (1755-1793), réplique à un juré s’étonnant de son silence au sujet de l’accusation d’inceste, Tribunal révolutionnaire, 14 octobre 1793. La Femme française dans les temps modernes (1883), Clarisse Bader
La reine déchue n’est plus qu’une femme et une mère humiliée à qui l’on a enlevé son enfant devenu témoin à charge, évidemment manipulé. L’accusée retourne le peuple en sa faveur. Le président menace de faire évacuer la salle. La suite du procès est un simulacre de justice et l’issue ne fait aucun doute.
Au pied de la guillotine, les dernières paroles de Marie-Antoinette sont pour le bourreau Sanson qu’elle a heurté, dans un geste de recul : « Excusez-moi, Monsieur, je ne l’ai pas fait exprès. » Un mot de la fin sans doute authentique, mais trop anodin pour devenir citation.

7. Théroigne de Méricourt (1762-1817), la Belle Liégeoise devenue la Furie de la Gironde, autre destin massacré par la Révolution.
« Citoyennes, armons-nous ; nous en avons le droit par la nature et même par la loi ; montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieures ni en vertus, ni en courage ; montrons à l’Europe que les Françaises connaissent leurs droits, et sont à la hauteur des lumières du dix-huitième siècle. »1408
Théroigne de MÉRICOURT (1762-1817), Discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes, 25 mars 1792. Discours imprimé par ordre de la Société Fraternelle de patriotes, de l’un & l’autre sexe, de tout âge & de tout état, séante aux Jacobins, rue Saint-Honoré (1792)
Belge, cantatrice et courtisane surnommée la Belle Liégeoise, elle entre en révolution comme on entre en religion - chose fort mal vue de la part d’une femme. Elle devient alors l’ « Amazone rouge » et la « Furie de la Gironde ». Le 13 mai 1793, accusée de soutenir Brissot (chef de file des Girondins) et prise à partie par des femmes jacobines au sein même de l’Assemblée, on lui inflige « la Fessée républicaine » : dénudée et fessée publiquement, elle subit cette forme de lynchage jusqu’à l’intervention de Marat. Elle ne s’en remettra jamais. Son frère la fait enfermer dans un asile pour qu’elle échappe à la mort. Elle y rencontrera la folie. Un siècle plus tard, Camille Claudel vivra le même calvaire. Mais il est difficile d’analyser « raisonnablement » la folie.
Théroigne est victime de cette idéologie d’aliénation où la femme seule et libre qui s’engage dans la voie politique n’est plus désignée que par les termes de Furie, Bacchante, virago, toquée, détraquée, hystérique, folle… Ce féminisme affiché, qui remettait en cause la suprématie masculine et contestait le rôle traditionnellement dévolu à la femme de mère au foyer et d’épouse, rendit Théroigne de Méricourt suspecte aux yeux des révolutionnaires.
« Comparez ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans l’ordre social. […] Françaises, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées ; brisons nos fers ; il est temps enfin que les Femmes sortent de leur honteuse nullité, où l’ignorance, l’orgueil, et l’injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. »
Théroigne de MÉRICOURT (1762-1817), Discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes, 25 mars 1792
Elle soutient dès 1790 la formation de groupes patriotes mixtes et féminins. Elle ne fut pas la seule à pâtir de cet ostracisme à l’encontre de son sexe, et, dès l’automne 1793, toute activité politique féminine fut officiellement interdite, avec la fermeture des clubs de femmes. Ce revirement de l’opinion à l’égard des femmes, traitées de monstres lorsqu’elles prenaient part à la vie politique, reflète la conception que les révolutionnaires, influencés par Rousseau, avaient alors de la société, dans laquelle l’espace politique était réservé aux hommes, tandis que les femmes devaient s’occuper de leur foyer.
« Nous aussi nous voulons mériter une couronne civique, et briguer l’honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu’à eux [les hommes], puisque les effets du despotisme s’appesantissent encore plus durement sur nos têtes que sur les leurs. »
Théroigne de MÉRICOURT (1762-1817), Discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes, 25 mars 1792
Plusieurs pistes sont avancées pour sa « folie ». Ce serait la fessée publique qui l’a faite sombrer. Elle serait tombée dans la démence par la peur panique de subir la guillotine. Son frère l’aurait faite interner pour la protéger… ou pour mettre la main sur ses biens ? L’état avancé de sa neurosyphilis ou son traitement au mercure aurait aggravé le mal. Elle meurt en 1817 à l’hôpital de la Salpêtrière, à l’âge de 54 ans.
Cette vie hors du commun pour l’époque inspire nombre d’artistes, dont Baudelaire et Dumas. Delacroix s’inspire d’elle pour La Liberté guidant le peuple et Sarah Bernhardt joue son rôle dans la pièce éponyme de Paul Hervieu. Enfin, la ville de Liège lui rend hommage en nommant un nouveau pont piétonnier sur la Meuse « la Belle liégeoise ».

8. Charlotte Corday (1768-1793), l’Ange de l’assassinat célèbre en un coup de poignard et martyre révolutionnaire en même temps que Marat.
« Vous savez l’affreuse nouvelle, ma bonne Rose. Votre cœur, comme mon cœur, en a tressailli d’indignation. Voilà donc notre pauvre France livrée aux misérables qui nous ont déjà fait tant de mal […] Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l’ont assassinée. »1486
Charlotte CORDAY (1768-1793), Lettre à une amie, 28 janvier 1793. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
C’est le cri du cœur d’une partie de la France, littéralement épouvantée d’avoir tué son roi. Autre conséquence directe, imprévue sinon imprévisible, et la plus dramatique de toutes par le nombre des victimes, la guerre de Vendée, une guerre civile qui va déchirer, endeuiller, marquer profondément le pays.
« Les factions éclatent de toutes parts : la Montagne triomphe par le crime et par l’oppression ; quelques monstres abreuvés de notre sang conduisent ces détestables complots […] Si je ne réussis pas dans mon entreprise, Français, je vous ai montré le chemin : vous connaissez vos ennemis. Levez-vous, marchez et frappez. »1519
Charlotte CORDAY (1768-1793), Adresse aux Français, amis des lois et de la paix. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Cette jeune normande de 25 ans est « montée à Paris » pour tuer Marat. Elle écrit le 12 juillet 1793 un long texte dans le style de l’époque – descendante de Corneille, notre grand auteur tragique du XVIIe siècle classique, elle a aussi beaucoup lu Plutarque, Tacite et Rousseau. On le trouvera sur elle le lendemain, lors de son arrestation près de la baignoire où elle vient de poignarder Marat – un eczéma sur tout le corps l’oblige à passer des heures dans l’eau pour moins souffrir, et il a reçu la visiteuse, censée lui apporter une liste de traîtres à la patrie.
Elle va en quelque sorte venger le roi, venger la France : en assassinant l’assassin responsable de la mort du roi, elle fait acte de justice. Le retentissement de ce « fait divers politique » est considérable.
« Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais républicaine bien avant la Révolution. »1522
Charlotte CORDAY (1768-1793), à son procès devant le Tribunal révolutionnaire, 17 juillet 1793. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
En un jour, la jeune fille de 25 ans devient une héroïne cornélienne digne de son illustre aïeul . Elle compte parmi les figures de la Révolution. Le poète André Chénier la salue par ces mots : « Seule, tu fus un homme », ce qui contribuera à le perdre. Le député de Mayence, Adam Lux, qui la vit dans la charrette l’emmenant à l’échafaud, s’écria : « Plus grande que Brutus », et ce mot lui coûta la vie.
Lamartine la baptise l’Ange de l’assassinat et Michelet retrouve les accents qu’il eut pour Jeanne d’Arc : « Dans le fil d’une vie, elle crut couper celui de nos mauvaises destinées, nettement, simplement, comme elle coupait, fille laborieuse, celui de son fuseau. » Mais rien ni personne ne pouvait plus freiner cette marche programmée vers la Terreur. D’autant que les Girondins, « légion de penseurs », ne sont plus là pour contrer les Montagnards, ce « groupe d’athlètes » - deux beaux surnoms signés Hugo dans Quatre-vingt-treize, grande fresque historique.

9. Madame Tallien (1773-1835), « Notre-Dame de Thermidor » rescapée de la guillotine, femme libre et scandaleuse, puissante et enviée sous le Directoire et le Consulat.
« Quel roman que ma vie ! »,
Thérésa CABARRUS, dite Madame TALLIEN (1773-1835), Michel Peyramaure, La Reine de Paris (2008)
Beaucoup de personnages historiques ont pu le penser, avec ce sens du destin qui les caractérise souvent. Napoléon l’a écrit. Le jeune Bonaparte a d’ailleurs rencontré Madame Tallien sous le Directoire, séduit par cette femme aussi belle que spirituelle, certes un peu trop libre à son goût (la « putain de Paris » est alors la maitresse de Barras). Il a finalement épousé l’une de ses amies tout aussi frivole, Joséphine de Beauharnais qui fréquentait les mêmes salons mondains. L’originalité véritablement historique de Madame Tallien est ailleurs, résumée par ses deux surnoms qui disent sa générosité, qualité rare (surtout à l’époque) : Notre Dame de Bon Secours, Notre Dame de Thermidor. Grâce à quoi la petite histoire va changer le cours de l’Histoire.
Jeune aristocrate fille d’un grand banquier franco-espagnol, séduite par les idéaux des Lumières, elle a cru que la Révolution était un jeu, un sujet de conversation en société. Mariée un peu vite (14 ans) à Jean-Jacques Devin de Fontenay, banquier libertin et conseiller à la chambre du Parlement, elle apprend à voir les hommes comme ils sont parfois : menteurs et volages. Elle se jure de ne plus jamais donner son cœur à l’un d’eux. Après son divorce prononcé le 25 avril 1793 (l’un des acquis révolutionnaires), elle sera plus lucide. En attendant, elle a brillamment tenu salon dans son hôtel du Marais à Paris. Entraînée par ses amis, inscrite au Club de 1789 où se façonnaient toutes les idées progressistes, elle recevait les élites révolutionnaires du jour, Mirabeau, La Fayette, Rivarol, Lepeltier de Saint-Fargeau son amant de l’époque. Elle s’amusait du tutoiement citoyen et se coiffait de la cocarde tricolore. Grande, élancée, brune, elle se flattait à vingt ans d’être l’une des attractions de cette époque exaltée. Au printemps 1793, la proscription des Girondins par la Montagne marque la fin de l’insouciance.
Elle émigre avec sa fille vers Bordeaux, pour retrouver ses deux frères. Déjà généreuse et détestant l’injustice, elle intervient auprès de révolutionnaires pour faire libérer sa famille et les premières victimes de la Terreur. Mais elle tombe sous le coup de la loi des suspects votée par la Convention et se retrouve prisonnière au château de Ha.
« Le pays a été divisé en deux classes : celle qui fait peur et celle qui a peur. »1533
Jean-Lambert TALLIEN (1767-1820) définissant le régime de la Terreur. La Peur au XVIIIe siècle : discours, représentations, pratiques (1994), Jacques Berchthold, Michel Porret
Ce Montagnard est assurément du côté de la classe qui fait peur et il a pris goût à ce « jeu » terrible ! Membre du Comité de sûreté générale (devenu le « ministère de la Terreur » s’occupant de tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure), Tallien est envoyé comme représentant en mission à Bordeaux pour y organiser la Terreur… Jusqu’au jour où il va rencontrer la femme de sa vie, parmi les prisonniers.
« Monsieur, si vous m’aidez, je vous serais éternellement reconnaissante. »
Thérésa CABARRUS, dite Madame TALLIEN (1773-1835), Lettre à Tallien. Histoire : Thérésa Cabarrus, un coup de cœur sous la Terreur, Amélie de Bourbon Parme, Le Parisien, 4 juillet 2018
À la veille d’être guillotinée, elle en appelle à Tallien, l’homme chargé de faire appliquer les décrets du Comité de salut public. Comme elle l’écrira plus tard : « Quand on traverse la tempête, on ne choisit pas sa planche de salut. » Et puis, elle a vingt ans et à peine sortie d’un premier mariage malheureux, c’est quand même trop jeune pour mourir !
Il vient la voir dans sa geôle du château du Hâ, près de Bordeaux : pour lui, c’est un coup de foudre qui va changer sa vie… et sauver la sienne. En plus, c’est un fort bel homme.
« Je ne laisserai pas une femme comme vous, qui a contribué à propager les idées révolutionnaires, dans un tel cachot ! »
Jean-Lambert TALLIEN (1767-1820). Histoire : Thérésa Cabarrus, un coup de cœur sous la Terreur, Amélie de Bourbon Parme, Le Parisien, 4 juillet 2018
Il la fait libérer, il va l’installer chez lui. Il lui offre une vie fastueuse et lui permet de protéger nombre de suspects, avec une telle générosité qu’on la surnommera Notre-Dame de Bon-Secours. Entre décembre 1793 et mars 1794, le nombre d’exécutions est réduit de près de la moitié : « Depuis plusieurs mois, je ne me suis pas couchée une seule fois sans avoir sauvé la vie à quelqu’un » écrit-elle. Mme de La Tour du Pin, épargnée grâce à l’intervention de son amie, écrira dans ses Mémoires : « Il était difficile de penser que tant de jeunesse, tant de beauté, de grâce et d’ingéniosité étaient dévouées à un homme qui envoyait chaque matin à la mort un si grand nombre de personnes innocentes. » Et Tallien touchait de l’argent sur les têtes sauvées.
Fouché à Lyon et Carrier à Nantes ont quand même des résultats beaucoup plus « satisfaisants », alors que trop de suspects sont acquittés à Bordeaux. Tallien est convoqué à Paris par le Comité de salut public en juillet 1794. Accusée d’avoir une trop grande influence sur lui, Thérésa se retrouve emprisonnée à La Force et risque de nouveau la guillotine !
« Je meurs d’appartenir à un lâche. »
Thérésa CABARRUS, dite Madame TALLIEN (1773-1835), Lettre à Tallien, 25 juillet 1794, La Gazette Drouot, 18 novembre 2011. Chantal Humbert
Furieuse que son amant (père de son prochain enfant) n’intervienne pas pour la sauver et n’ose tenir tête à Robespierre le maître de la France, elle lui écrit ces mots. Piqué au vif, Tallien réagit. Il entre dans la conjuration contre Robespierre et s’illustre à la Convention, le 27 juillet (9 Thermidor an II), empêchant Saint-Just de prendre la parole pour défendre la ligne dure de la Révolution. C’est le fameux « coup d’État de Thermidor » qui met fin à la Terreur.
« Salut, Neuf-Thermidor, jour de la délivrance !
Tu viens purifier un sol ensanglanté.
Pour la seconde fois, tu fais luire à la France
Les rayons de la liberté. »1609Marie-Joseph CHÉNIER (1764-1811), paroles, et Étienne-Nicolas MÉHUL (1763-1817), musique, Hymne au 9 Thermidor, chanson. Œuvres de M.-J. Chénier (1824), Marie-Joseph Chénier, Antoine-Vincent Arnault
Marie-Joseph Chénier (frère d’André le poète), membre du club des Jacobins, député à la Convention, auteur dramatique à succès, continuera sa carrière politique sous Bonaparte. Méhul composa d’autres hymnes patriotiques, de la musique religieuse et une trentaine d’opéras. Le même couple auteur-compositeur a cosigné Le Chant du départ, qualifié de « seconde Marseillaise » en raison de sa célébrité.
« Le 9 thermidor fut le plus beau jour de ma vie, puisque c’est un peu par ma petite main que la guillotine a été renversée. »
Thérésa CABARRUS, dite Madame TALLIEN (1773-1835) Histoire : Thérésa Cabarrus, un coup de cœur sous la Terreur, Amélie de Bourbon Parme, Le Parisien, 4 juillet 2018
Elle écrira ses mots à la fin de sa vie. Libérée trois jours plus tard, Thérésa est désormais surnommée « Notre-Dame de Thermidor », car la révolution thermidorienne sauve de nombreuses vies.
Elle bénéficie de l’énorme popularité de Tallien qu’elle épouse fin 1794 – leur fille sera baptisée Rose-Thermidor. Adulée, admirée, héroïne vivante ô combien, elle lance la mode néogrecque qui lui va si bien. Parée des épreuves endurées, elle se fait peindre par Jean-Louis Laneuville. Représentée dans l’antichambre de la mort, elle tient pathétiquement ses cheveux coupés pour offrir son cou ravissant à la guillotine.
« Cette femme serait capable de fermer les portes de l’enfer. »
William PITT le Jeune (1759-1806), Christian Gilles, Madame Tallien, la Reine du Directoire, Biarritz, Atlantica, 1999
William Pitt (élu à 24 ans) est le plus jeune Premier ministre d’Angleterre (pays de monarchie constitutionnelle depuis le XVIIe siècle). Apprenant l’attitude de la jeune femme qui poussa Tallien à agir, il aura ce mot superbe.
Un an après le coup d’État de Thermidor, le Directoire commence, période de transition heureuse avant le Consulat et l’Empire. Et la vie romanesque de Madame Tallien rebondit. Thérésa se jette dans les bras de Barras l’homme fort du régime. Dans son nouveau château, elle tient un salon où se pressent les artistes et les muses du nouveau régime, Joséphine de Beauharnais, Juliette Récamier et bien d’autres célébrités.
Elle devient l’une de ces « Merveilleuses » qui célèbrent la fin de la rigueur révolutionnaire par leurs tenues et leurs mœurs « légères ». La presse se déchaîne contre les bacchanales du « cinquième sultan » (du Directoire) et de la « plus grande putain de Paris ». Peu lui importe ! Entourée, adulée comme une reine, elle dédaigne la cour empressée d’un jeune officier qu’elle juge un peu rustre, Napoléon Bonaparte, lui préférant Ouvrard, le richissime fournisseur des Armées.
De 1794 à 1799, Mme Tallien fut réellement la femme la plus puissante, la plus enviée et la plus critiquée de France. La voyant un jour à l’Opéra, vêtue d’une simple tunique de soie blanche sans manche (et sans rien dessous), Talleyrand eut ce mot : « Il n’est pas possible de s’exposer plus somptueusement ». Le baron Gérard, peintre impérial, immortalise ses courbes sculpturales en 1804… Et la fête continue.
Sous la Restauration, malgré son passé d’égérie révolutionnaire, son âge et ses six enfants de paternités diverses et incertaines, elle va séduire un fervent monarchiste, le prince de Chimay, François Joseph de Riquet de Caraman dont elle aura quatre enfants… et avec qui elle terminera le roman de sa vie.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.