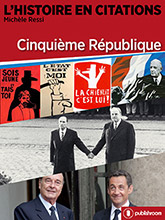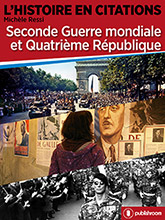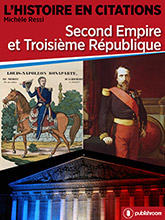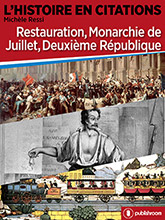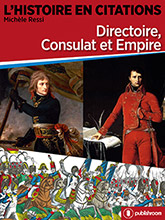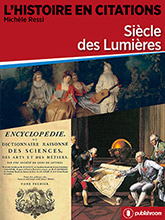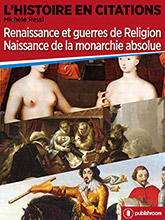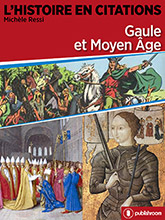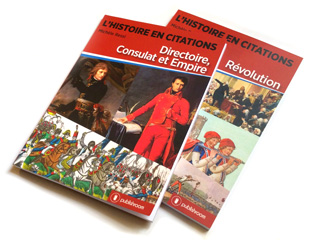« L’air est plein de poignards. »
Joseph FOUCHÉ (1759-1820), ex-ministre de la Police, mi-janvier 1804
La Politique, un métier à risque extrême !
Entre attentats (« tentatives criminelles ») et assassinats (« meurtres avec préméditation »), l’Histoire est violente, des origines à nos jours et dans le monde.
Rappelons quelques noms de victimes politiques célèbres à divers titres : César et Cicéron dans l’Antiquité. Plus proches de nous, Abraham Lincoln (1865), Élisabeth d’Autriche dite Sissi (1898), François-Ferdinand d’Autriche (attentat de Sarajevo, 1914), Trotsky (1940), Mahatma Gandhi (1948), JFK (1963), Robert Kennedy (1968), Martin Luther King (1968), Enrico Mattei (1978), Indira Gandhi (1984)… et le dernier en date, Evgueni Prigojine (« crash » d’avion en Russie, 2023).
Pour s’en tenir à l’Histoire de France, cet édito en deux parties recense 20 victimes sur des centaines de cas… et nombre de rescapés.
Napoléon et de Gaulle ont échappé par miracle à deux attentats fameux : la « machine infernale » (bombe qui détruit une partie du quartier St-Honoré, Noël 1800) et le Petit-Clamart (DS 19 présidentielle criblée de 150 balles, 22 août 1962). Particulièrement exposé, Henri IV avait échappé à quelque 25 tentatives avant Ravaillac !
Assassinat ou exécution ? La question concerne la mort de Louis XVI et celle du duc d’Enghien, tous deux jugés, mais par un tribunal peu conforme aux critères de la justice.
Certaines époques sont particulièrement violentes : guerres de Religion, Révolution, Seconde guerre mondiale. Les attentats anarchistes à la fin du XIXe siècle frappent au-delà de notre pays et jusqu’au début de la Grande guerre de 14-18. Des cas restent non élucidés – le jour-même de son assassinat en 1942, l’Amiral Darlan parlait de quatre pistes possibles.
Bref ! Voici un long roman policier national plus vrai que nature.
De la Renaissance à l’Empire
1/ 1563 - François de Guise
Grand militaire d’Henri II et chef du parti catholique ultra, assassiné au début des guerres de Religion par un gentilhomme protestant, Poltrot de Méré.
« De là vient le discord sous lequel nous vivons,
De là vient que le fils fait la guerre à son père,
La femme à son mari, et le frère à son frère. »503Pierre de RONSARD (1524-1585), Discours des misères de ce temps, Remontrance au peuple de France (1562)
Prince des poètes, devenu poète des princes, Ronsard est protégé par Michel de L’Hospital, chancelier de Catherine de Médicis. Le massacre de Wassy est l’acte I des grandes « misères de ce temps » qui inspirent ses Discours au patriotisme écorché vif et font de ce fervent catholique l’un de nos premiers grands auteurs engagés.
1er mars 1562. François de Guise et ses gens, revenant de Lorraine, voient des protestants au prêche dans la ville de Wassy – pratique interdite par l’Édit de janvier (ou édit de tolérance de Saint-Germain). Ils foncent dans la foule au son des trompettes. Bilan : 74 morts (hommes, femmes et enfants) et une centaine de blessés !
C’est ce qu’on appellera la « première Saint-Barthélemy ». Les massacres de huguenots se suivent et se ressemblent dramatiquement à Sens et à Tours, dans le Maine et l’Anjou. La responsabilité de François de Guise, chef du parti catholique, est toujours discutée dans ce massacre.
Ainsi commence la première des huit guerres de Religion – trente-six années de guerre civile presque sans répit, jusqu’à l’édit de Nantes (1598) sous Henri IV.
« Il a déployé la force de son bras. »
Grande Bible de Tours. François de Lorraine (1520-1563) : duc de Guise et nouveau Roi mage, Éric Durot, Histoire, économie & société, 2008/3
Le thème du « bras armé » est partout visible au château du Grand Jardin que fit construire Claude de Guise à Joinville. Quand il meurt en 1550, son fils François devient le nouveau « bras armé de Dieu », reprenant la devise de sa famille.
François de Guise étant déjà couronné par Dieu, il est son lieutenant. Le lien divin ne se fait donc pas seulement par le service dû au Roi Très-Chrétien, mais directement, sans intermédiaire. La grande famille des Guises peut ainsi être définie « comme une race royale sans couronne » (Lucien Romier).
« Quant à la religion, François de Guise s’en remettait à ceux qui étaient plus savants que lui en théologie. Bien s’assurait-il que tous les conciles ne le pourraient détourner ni lui faire changer l’ancienne manière et forme de ses prédécesseurs, principalement quant aux saints sacrements. »
Louis REGNIER, sieur de La Planche (vers 1530-1580), Histoire de l’État de France, tant de la république que de la Religion sous le règne de François II (1576)
Ces arguments permettent de comprendre le rapport de François de Guise à Dieu et à la religion.
Il veut avant toute chose conserver la religion de ses pères qui seule permet le salut collectif et individuel. Les adeptes de la nouvelle religion (dite réformée) trompent le peuple. Les prédicants sont les nouveaux antéchrists, ils détournent les catholiques de la voie du salut et les éloignent de Dieu, « sous couleur de la religion ».
Le duc se place ainsi dans une double continuité : celle de l’orthodoxie et celle du lignage.
« Aye, mon mignon mon ami, l’amour et la crainte de Dieu. »
François de GUISE (1519-1563) à son fils aîné, le prince de Joinville. Les derniers moments du duc François de Guise d’après un manuscrit de Lancelot de Carle (février 1563). Article de Jean-Pierre Babelon. Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1987
Commandant l’armée du roi Charles IX (12 ans), le duc de Guise est vainqueur des huguenots à Rouen en octobre 1562 et à Dreux, en décembre de la même année. Il tente ensuite de reprendre Orléans.
Avec son armée de 20 000 hommes, il s’empare des Tourelles le 9 février et prépare l’assaut de la ville pour le 19. La veille, 18 février au soir, après avoir traversé le Loiret en barque pour regagner son logis des Vaslins, un coup de pistolet l’atteint dans le dos, tiré par un gentilhomme de son armée en embuscade - un protestant nommé Jean Poltrot de Méré. Grièvement blessé, le duc de Guise mourra quelques jours plus tard.
On soupçonnera l’amiral Coligny, converti à la nouvelle religion, d’avoir commandité le crime – l’assassin le met en cause sous la torture, puis se rétracte… avant de renouveler ses aveux. Jehan de Poltrot soi-disant seigneur de Méré est condamné à être tenaillé de fers chauds en quatre endroits de son corps, puis écartelé par quatre chevaux jusqu’à ce que « mort naturelle » s’ensuive. Son supplice en place de Grève attire une foule immense, le 18 mars 1563.
La controverse à propos de Coligny agite la cour pendant des années, l’amiral déclarant « se réjouir de la mort de Guise, mais n’être pour rien dans cet attentat. » Les Guise n’auront de cesse de tirer vengeance de ce chef protestant, finalement assassiné au début du massacre de la Saint-Barthélemy (1572).
« Et si à quelqu’un d’entre vous ou à d’autres je me trouvais redevable d’aucune dette dont il ne me souvienne, j’entends que à la première demande il y soit promptement satisfait. »
François de GUISE (1519-1563), mot de la fin, 24 février 1563. Les derniers moments du duc François de Guise. D’après un manuscrit de Lancelot de Carle (février 1563). Article de Jean-Pierre Babelon. Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1987
Mortellement blessé, après une agonie de six jours, telles sont ses dernières paroles.
Enterré le 19 mars 1563, il reçoit des funérailles quasi royales en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au lieu de l’attentat, sur la commune actuelle de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (département du Loiret), on peut voir une grosse pierre appelée « la pierre du duc », sur laquelle la victime se serait assise, atteinte par le projectile mortel.
2/ 1569 - Louis de Condé
Prince du sang (royal), converti au calvinisme et chef (modéré) des huguenots, assassiné par Montesquiou, capitaine des gardes du futur Henri III.
« Libéral et très affable à toutes personnes et avec cela excellent chef de guerre, néanmoins amateur de la paix. »2
François de LA NOUE (1531-1591), Discours politiques et militaires du seigneur de La Noue (1587)
Louis de Bourbon est prince du sang (issu légitimement par les mâles d’un petit-fils de France), fondateur de la maison de Condé et chef militaire des troupes huguenotes lors des trois premières guerres de Religion. Converti au protestantisme dès 1558, mais modéré, son rang, son expérience militaire, puis la mort précoce de son frère aîné Antoine de Bourbon le désigneront à la tête du camp huguenot dès la première guerre de Religion.
« Il n’était fils de bonne mère qui n’en voulût goûter. »493
Blaise de MONLUC (1502-1577), Commentaires (posthume)
Soldat à 16 ans sous les ordres du chevalier Bayard, servant sous quatre rois successifs avec sa fière devise « Deo duce, ferro comite » (« Dieu pour chef, le fer pour compagnon »), fait maréchal de France à 72 ans, couvert de gloire et de blessures, Monluc reste fidèle à la religion catholique et s’indigne en 1559 de voir les seigneurs de France embrasser le calvinisme.
Ainsi Louis Ier, prince de Condé (futur chef du parti protestant contre les Guise) et trois neveux du connétable de Montmorency, le plus célèbre étant l’amiral Gaspard de Coligny. Pour Monluc, militaire gascon pur et dur, tout protestant est un rebelle et un ennemi du roi : c’est pour cette trahison et non par fanatisme religieux qu’il participera à la répression, durant les guerres de Religion. Il s’en justifie dans ses Commentaires, « bible du soldat » selon Henri IV, document clair et précis sur l’histoire politique et militaire du XVIe siècle.
« Ils ont décapité la France, les bourreaux ! »495
Jean d’AUBIGNÉ (??-1563), à son fils, devant le château d’Amboise, mars 1560. La Vie d’un héros, Agrippa d’Aubigné (1913), Samuel Rocheblave
Enfant de 8 ans, Agrippa d’Aubigné sera marqué à vie par la vue des conjurés protestants pendus sur la terrasse du château. C’est l’épilogue de la fameuse conjuration d’Amboise.
Les chefs protestants (Condé, Coligny, Henri de Bourbon) voulaient exprimer leurs doléances et soustraire le jeune roi François II à l’influence de ses oncles, le duc de Guise et le cardinal de Lorraine, catholiques responsables de la répression religieuse. Refusant la violence, ils projettent l’enlèvement organisé par d’autres gentilshommes, dont Jean d’Aubigné. Le complot échoue, le « tumulte » d’Amboise est noyé dans le sang. Le prince de Condé sera arrêté, mais relâché, aussitôt prêt à une nouvelle conjuration.
La guerre civile imminente est différée par un autre drame, la mort du jeune roi François II à 15 ans (probablement d’un abcès du cerveau, après des otites à répétition).
« Quels fols sont ceux-ci, qui s’entr’aiment aujourd’hui et s’entre-tuent demain ! »504
Mot des reîtres au service du prince de Condé. Discours politiques et militaires (1587), François de la Noue
François, seigneur de La Noue, né en Bretagne en 1531 et d’abord au service du roi de France, se convertit très tôt à la Réforme (1558) et prend part aux guerres de Religion aux côtés des huguenots. Il perd son bras gauche et gagne le surnom de « Bras de Fer ». Il finit par concilier, non sans mal, l’obéissance au roi et le respect de la foi réformée. Ce n’est jamais un fanatique, comme il y en a tant à cette époque, chez les militaires comme chez les théologiens.
Quant aux « reiîres » du prince de Condé, cavaliers mercenaires d’origine le plus souvent allemande, ils s’étonnent de voir les catholiques et les réformés de France un jour s’embrasser, le lendemain se battre avec fureur. Mais le chroniqueur qui rapporte ce fait reconnaît que « certes il est malaisé de voir ses parents et amis, et ne s’émouvoir point ».
« Doux est le péril pour Christ et le pays ! »510
Prince Louis de CONDÉ (1530-1569), sa devise. La Célèbre Bataille de Jarnac, racontée par Agrippa d’Aubigné (alors âgé de 17 ans)
Troisième guerre de Religion : Condé (le Prince) et Coligny (l’Amiral) sont les deux chefs convertis au calvinisme, mais modérés – ils ont refusé de participer à la conjuration d’Amboise (1560). Catherine de Médicis veut les faire enlever, ils se réfugient à La Rochelle qui devient une place forte protestante.
Condé prend la tête de l’armée, avec sa fière devise sur ses étendards et malgré une jambe brisée par un cheval. L’affrontement avec l’armée royale a lieu le 13 mars 1569 à Jarnac. Blessé durant le combat, Condé se retrouve immobilisé sous son cheval mort, jambe déjà brisée. Faisant fi de tous les usages et des lois de la chevalerie qui auraient voulu qu’il soit capturé et mis à rançon, Montesquiou un capitaine des gardes du duc d’Anjou le tue de sang-froid d’un coup de pistolet, avant d’exposer son corps à dos d’âne en signe d’ultime humiliation.
(Notons que l’expression « coup de Jarnac » trouve son origine ailleurs, dans un duel de 1547 entre le favori du roi Henri II et le baron de Jarnac qui lui trancha le jarret d’un coup d’épée fatal.)
Coligny réussit à sauver 6 000 hommes, noyau de la nouvelle armée protestante. Henri de Navarre (futur Henri IV), présent à la bataille, devient à 16 ans le chef des armées protestantes. Et l’Histoire s’emballe…
« La messe ou la mort. »530
CHARLES IX (1550-1574), à Henri Ier de Bourbon-Condé, le 24 août 1572. Précis de l’histoire de France jusqu’à la Révolution française (1833), Jules Michelet
Henri Ier de Bourbon-Condé (fils de Louis, assassiné à Jarnac) a fait alliance avec son cousin Henri de Navarre, devenant l’un des chefs protestants les plus actifs. Il est mené devant le jeune roi qui jure « par la mort Dieu » : il n’hésitera pas à faire tomber sa tête, s’il ne se convertit pas. « Je te donne trois jours pour changer d’avis […] Trois jours, après quoi il faudra choisir : la messe ou la mort. »
Henri Ier va abjurer, comme le futur Henri IV et pour la même raison. La vie vaut bien une messe. Mais ce genre de conversion sous la contrainte vaut peu et ne dure pas. Et les guerres de Religion vont continuer de s’enchaîner.
3/ 1572 - Coligny
Célèbre amiral, catholique converti à la Réforme et conseiller de Charles IX : son assassinat par un sbire des Guise déclenche le massacre de la St-Barthelemy.
« Commençons à former ce monstre par le ventre. »509
Amiral Gaspard de COLIGNY (1519-1572). Choix de Chroniques et Mémoires sur l’histoire de France (1836), Jean Alexandre C. Buchon
Pour ce grand militaire, esprit logique et organisateur, la fourniture des vivres est le premier souci d’un chef d’armée – autrement dit, l’intendance passe avant tout, quand il s’agit de mettre sur pied une armée.
Élevé dans la religion catholique, Coligny est très en faveur à la cour, avant de passer à la Réforme. C’est, avec Condé, l’un des chefs huguenots, mais de la tendance modérée qui cherche à négocier plutôt qu’à massacrer. Il participe activement à la troisième guerre de Religion (1568-1570) et sauve 6 000 hommes après l’assassinat de Condé. C’est le noyau de la nouvelle armée protestante.
« Qu’il se souvienne qu’il est périlleux de heurter contre la fureur française ! »511
HENRI III (1551-1589) (encore duc d’Anjou) parlant de Coligny, Moncontour, le 3 octobre 1569. Choix de Chroniques et Mémoires sur l’histoire de France (1836), Jean Alexandre C. Buchon
L’amiral de Coligny à la tête des huguenots, craignant la mutinerie de ses mercenaires faute de paiement et la défection de certains princes alliés, a engagé le combat avec des forces inférieures. Son armée est taillée en pièces par celle du futur Henri III qui n’a que 18 ans et s’illustre ici comme à Jarnac.
Coligny obtient pourtant la paix de Saint-Germain (paix de la Reine) signée par Catherine de Médicis le 8 août 1570 et mettant fin à cette troisième guerre : protestants amnistiés, avec liberté de conscience et du culte, accès à tous les emplois publics, quatre places de sûreté accordées (La Rochelle, Montauban, Cognac, La Charité).
C’était trop beau pour être vrai : la tolérance a cessé d’être la politique de la régente depuis le renvoi de Michel de L’Hospital et ses concessions ne sont plus que tactique pour gagner du temps – mais ces clauses seront reprises dans l’édit de Nantes, en 1598.
« Ce ne sont pas des choses qu’on négocie avec des femmes ni avec des clercs. »515
Amiral Gaspard de COLIGNY (1519-1572), au roi Charles IX. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Le roi veut prendre l’avis de Catherine de Médicis et du cardinal de Lorraine, avant d’entreprendre la guerre contre l’Espagne que Coligny lui conseille, en décembre 1571 – pour fonder en Flandre une république calviniste.
Coligny, modéré parmi les huguenots, pousse le roi à une politique de compromis en France et à un renversement d’alliances mettant la France aux côtés de l’Angleterre et des Pays-Bas (pays protestants).
Mais Catherine n’est plus si favorable à la conciliation : elle sait le mécontentement des catholiques après la paix de Saint-Germain trop indulgente envers les protestants et craint que les Guise prennent la tête d’une réaction pouvant ébranler le trône de son fils. Elle redoute aussi l’influence grandissante de Coligny… et l’amiral va le payer de sa vie.
« La fortune, qui ne laisse jamais une félicité entière aux humains, changea bientôt cet heureux état de triomphe et de noces en un tout contraire, par cette blessure de l’Amiral, qui offensa tellement tous ceux de la religion que cela les mit comme en un désespoir. »521
MARGUERITE de VALOIS (1553-1615), Mémoires
Son mariage devait sceller la réconciliation entre catholiques et protestants. Mais les chefs catholiques ne peuvent admettre qu’un protestant entre dans la famille royale. L’amiral de Coligny, artisan de ce mariage, est le premier visé – et touché par l’attentat.
Dans la nuit du 23 au 24 août, le tocsin de Saint-Germain-l’Auxerrois appelle les milices bourgeoises et ameute la populace parisienne. Le premier des protestants visés sera Coligny.
« Tuez-les, mais tuez-les tous, pour qu’il n’en reste pas un pour me le reprocher. »523
CHARLES IX (1550-1574), 23 août 1572. Nouvelle Histoire de France (1922), Albert Malet
L’amiral de Coligny échappa au matin du 22 août à un (premier) attentat, vraisemblablement organisé par les Guise. Le médecin Ambroise Paré assure que ce coup d’arquebuse au bras sera sans conséquence. Charles IX se rend au chevet de son conseiller qui le conjure de se « défier de sa mère ».
Rentré au Louvre, il répète pourtant ses propos à Catherine de Médicis qui se concerte avec les Guise : le massacre des huguenots est décidé. Les protestants se répandent déjà dans les rues, réclamant justice au nom de Coligny. Catherine persuade son fils. Et à contrecœur, il donne son accord : « Tuez-les, tuez-les tous… »
« Si c’était un homme du moins ! C’est un goujat ! »524
Amiral Gaspard de COLIGNY (1519-1572), dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Histoire de France au seizième siècle, Guerres de religion (1856), Jules Michelet
Coligny toise l’homme qui va le frapper, un certain Bême, sbire des Guise, même pas un seigneur digne de lui ! Cette exclamation de mépris peut être considérée comme son « mot de la fin ».
Ce grand militaire a servi tous les rois de France depuis François Ier, participé à toutes les guerres, quitté plusieurs fois la cour pour fuir ses intrigues, toujours rappelé pour ses qualités de courage, de diplomatie et même de tolérance, quand il se convertit à la religion réformée.
Sa fin à 53 ans est des plus humiliantes : surpris dans son lit, achevé à coups de dague, son corps jeté par la fenêtre, éventré, émasculé, décapité, puis porté au gibet de Montfaucon, exhibé, pendu par les pieds, exposé à d’autres sévices, pour finir à nouveau pendu place de Grève.
« Le corps d’un ennemi mort sent toujours bon. »525
CHARLES IX (1550-1574), le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy (du nom du saint, fêté sur le calendrier). Cité au XVIIIe siècle par Voltaire (Œuvres complètes, volume X), au XIXe siècle par Alexandre Dumas (La Reine Margot), entre autres sources
Les guerres de Religion, c’est l’une des pages d’Histoire les plus riches en mots. Ce mot (de l’empereur romain Vitellius) est attribué à Charles IX, devant le corps de Coligny. Cette nuit, cet assassinat et ses suites – les milliers de morts et le sacrifice de son conseiller – hanteront cependant les nuits du jeune roi jusqu’à sa mort prochaine.
Faible de caractère, manipulé par sa mère et ses proches (les Guise et son frère Henri, le duc d’Anjou), il semble qu’il ait donné son accord pour tuer tous les chefs… Oui, mais pas tous les protestants de Paris, de Navarre et de France !
Selon certaines sources (dont Agrippa d’Aubigné), il tirait à l’arquebuse sur les fuyards. Selon d’autres historiens, il a tenté d’arrêter la tuerie qui commence dans les rues, les ruelles. De toute manière, il est trop tard ! On a fermé les portes de Paris et la capitale est profondément anti-huguenote.
La haine se déchaîne et chaque protestant passe pour un Coligny en puissance : « Tuez-les tous ! » L’ordre royal du 23 août est répété à tous les échos, tous les carrefours.
4/ 1588 - Henri duc de Guise dit le Balafré (comme son père François de Guise)
Chef des ultras (Ligue catholique) et maître de Paris, finalement assassiné par la garde personnelle d’Henri III.
« Pour entretenir la guerre en France, il faut sept cent mille livres, tous les mois. »4
Henri duc de GUISE (1550-1588). Histoire de France, La Ligue et Henri IV (1860), Jules Michelet
On retrouvera ce billet manuscrit après son assassinat. Il s’exprime quasiment en roi et va se comporter comme tel – ce qui finira par lui coûter la vie.
La reine Catherine de Médicis l’a écrit dans une lettre à l’ambassadeur d’Espagne en août 1570 : « L’argent est le nerf de la guerre. » La « petite phrase » de Rabelais dans Gargantua (selon qui « les nerfs des batailles sont les pécunes ») fera fortune dans l’histoire. Mais au XVIe, tous les souverains d’Europe ont d’énormes besoins d’argent pour leurs guerres qu’il faut sans cesse faire ou préparer : record historique de 85 années de guerre en ce siècle ! Et elles coûtent de plus en plus cher, avec le développement des armes à feu, l’entretien d’armées permanentes, des effectifs croissants.
Henri de Guise qui a conduit la troupe chargée exécuter l’amiral de Coligny, chef protestant qu’il tenait pour responsable de la mort de son père, continue d’être le pilier du catholicisme ultra. Il accroît sa renommée en battant les protestants à la bataille de Dormans (10 octobre 1575). Blessé au visage, il en gardera la marque, d’où son surnom d’Henri le Balafré (selon certains auteurs, son père avait le même surnom). Chef de l’opposition aux protestants, il a secrètement soutenu les premières ligues populaires qui naissent en 1576.
La huitième et dernière guerre de Religion (1585-1593) sera la plus longue. Baptisée « la guerre des trois Henri », elle oppose le roi de France Henri III, Henri III de Navarre (bientôt Henri IV) et Henri de Guise, le Balafré, chef incontesté de la Ligue. Aucun des trois Henri ne mourra au combat, mais chacun sera victime d’un assassinat, dont deux relevant du régicide !
« Pour la religion dont tous les deux font parade, c’est un beau prétexte pour se faire suivre par ceux de leur parti ; mais la religion ne les touche ni l’un ni l’autre. »561
Michel de MONTAIGNE (1533-1592) en 1588. Dictionnaire universel des Sciences morale, économique, politique et diplomatique (1781), Jean B. Robinet
Catholique modéré, très hostile aux catholiques « zélés » de la Ligue et ayant plusieurs fois rencontré Henri de Navarre, il témoigne de cette évidence : les guerres de Religion ne sont plus religieuses, l’enjeu est avant tout politique ! Henri de Navarre n’a pas plus de conviction protestante que catholique et Henri de Guise ne pense qu’à devenir roi. La preuve : il s’est fait acclamer par Paris, au printemps 1588.
« Comment sont nées les barricades ? Pour lutter contre les cavaleries royales, le peuple n’ayant jamais de cavalerie. »562
André MALRAUX (1901-1976), L’Espoir (1937)
Le nom de « journée des Barricades » sera donné à plusieurs insurrections parisiennes de l’histoire de France. La première date du 12 mai 1588. Henri de Guise brave l’interdiction du roi et se rend à Paris, appelé par les Seize (comité formé par les ligueurs dans la capitale, composé de 16 membres représentant les 16 quartiers de la ville). Très populaire, on le surnomme « le Roi de Paris ».
Henri III veut riposter avec ses troupes, mais la population se soulève, barrant les rues avec des barriques de terre. Le roi doit s’enfuir et se réfugie à Chartres. Paris reste au duc de Guise et aux ligueurs.
« C’est grand’pitié quand le valet chasse le maître. »563
Achille de HARLAY (1536-1619), premier président du Parlement de Paris, mai 1588. Discours sur la vie et la mort du président de Harlay (1816), Jacques de la Vallée
Saluons le courage de ce magistrat : il s’adresse à Henri de Guise qui a contraint Henri III à s’enfuir de Paris. Ajoutant : « Au reste, mon âme est à Dieu, mon cœur est à mon roi et mon corps est entre les mains des méchants ; qu’on en fasse ce qu’on voudra. »
Inébranlablement fidèle au roi et membre influent du parti des Politiques (les modérés), Harlay sera jeté en prison par les Seize qui font régner la terreur dans la capitale. La situation est grave et le roi convoque les États généraux à Blois.
« Je le sais, messieurs, peccavi, j’ai offensé Dieu, je m’amenderai, je réduirai ma maison au petit pied. S’il y avait deux chapons, il n’y en aura plus qu’un. »564
HENRI III (1551-1589), aux États généraux de Blois, août à décembre 1588. La Ligue et Henri IV (1860), Jules Michelet
L’historien décrit l’attitude du roi dans une situation plus que difficile : « Henri III vivait sur un « grand pied », aimait les costumes raffinés, les fêtes extravagantes, les ballets somptueux. Il reconnaît la gravité de la situation financière, ayant convoqué les États pour obtenir des subsides, indispensable pour continuer cette guerre : « Comment voulez-vous que je vive ? Refuser l’argent, c’est me perdre, vous perdre, et l’État avec nous. » Mais l’on se moquait de lui : l’un disait « Alors, ne soyez donc point roi », et l’autre : « Ses paroles ne sont que vent. » Il faisait venir les députés, leur parlait avec respect, componction. Guise riait. Un autre disait : « La marmite du roi est renversée, messieurs ; allons, faites-la donc bouillir ! » »
Henri de Guise ne cesse d’humilier le roi et se conduit plus que jamais en véritable « maire du palais ». Henri III qui craint pour son trône aussi bien que pour sa vie feint de composer avec le duc de Guise. En fait, il ne l’a attiré là que pour mieux le piéger.
« Je bois à la santé du roi de France ! »
Louis de LORRAINE, cardinal de GUISE (1555-1588), 17 décembre 1588, portant un toast à son frère le duc de Guise
Représentant du clergé aux états généraux, il pousse très loin l’affront au roi et le paiera lui aussi de sa vie, assassiné quelques jours après en même temps que son frère.
Le 2 octobre 1588, les états généraux ont débuté au château de Blois. La nouvelle de l’échec de l›« Invincible Armada » en août 1588 conforte le roi de France. Mais la Ligue catholique reste majoritaire et le duc entame une nouvelle épreuve de force contre le roi. Grisé par ses victoires et poussé par les ligueurs catholiques, le duc de Guise se voit déjà roi de France. L’année dernière, la Sorbonne n’a-t-elle pas oser préciser qu’on peut déposer les « mauvais rois » ?
Quand ses partisans évoquaient les menaces sur sa vie venant du camp du roi :
« Il n’oserait. »565
Henri de GUISE (1550-1588), parlant du roi, fin 1588. Fière réplique, reprise par Alexandre Dumas, Henri III et sa cour (1829)
L’histoire récente donnait pourtant l’exemple de grands chefs de parti assassinés, catholiques comme protestants : François de Guise (1563), le prince de Condé (1569), l’amiral de Coligny (1572). Avant que vienne le tour des rois. Mais l’orgueil aveugle Henri de Guise qui méprise Henri III pour sa faiblesse de caractère, entre autres défauts.
« Mon Dieu qu’il est grand ! Il paraît encore plus grand mort que vivant. »566
HENRI III (1551-1589), face au corps du duc de Guise, château de Blois, 23 décembre 1588. Journal de Henri III (posthume), Pierre de l’Estoile
(Quoique apocryphe, célèbre mot historique prêté à Henri III, voyant étendu à ses pieds le corps de son ennemi qui mesurait presque deux mètres – un quasi géant, pour l’époque).
Il a osé : ordre donné aux Quarante-Cinq (garde personnelle du roi, immortalisée par le roman de Dumas) d’assassiner Henri le Balafré ainsi que son frère Louis, cardinal de Lorraine – arrêté, exécuté le lendemain dans sa prison.
« C’est bien taillé mon fils ; maintenant il faut recoudre. »567
CATHERINE DE MÉDICIS (1519-1589) à Henri III, château de Blois, 23 décembre 1588. Dictionnaire des citations françaises et étrangères (1982), Robert Carlier
Le roi courut annoncer à sa mère l’assassinat de son pire ennemi, le duc de Guise. Cette façon d’éliminer ceux qui font obstacle au pouvoir de ses fils est bien dans ses mœurs – et dans celles de l’époque. Mais à 70 ans, et à quelques jours de sa mort (5 janvier 1589), la reine mère se fait-elle beaucoup d’illusions sur l’avenir de son dernier fils ?
« À présent, je suis roi. »568
HENRI III (1551-1589) : billet adressé au légat du pape et écrit de sa main, qui commence par ces mots. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Il annonce à Sixte Quint (grand bâtisseur de Rome) l’assassinat du duc de Guise et de son frère. Le pape répond en excommuniant le roi de France !
Le corps d’Henri de Guise est confié au grand prévôt de France qui par commandement du roi le fait dépecer par le bourreau puis brûler à la chaux vive avant que ses cendres ne soient dispersées dans la Loire. Le même jour sont arrêtés sa mère Anne, son fils Charles. Son frère Louis est exécuté puis brûlé, ses cendres jetées à la rivière le lendemain.
À la nouvelle du drame de Blois, Paris se soulève. Un autre Guise, frère cadet d’Henri, Charles de Lorraine, duc de Mayenne, prend la tête de la Ligue et le pouvoir à Paris. Il s’autoproclame lieutenant général du royaume. Le roi tente de « recoudre ».
5/ 1589 - Henri III
Fervent catholique, mais finalement allié à Henri de Navarre (protestant et futur roi) : assassiné par un ligueur fanatique et régicide, Jacques Clément.
« Les autres ne sont rien où nous ne parlons point. »541
HENRI III (1551-1589). Lettres de Henri III de France, recueillies par Pierre Champion. Revue d’histoire de l’Église de France, année 1960, n° 143.
Affirmation de puissance de la Majesté royale.
Personnage diversement jugé : brave, intelligent, travailleur, cultivé, il veut faire l’unité de la France autour de lui. On lui doit d’importantes réformes qui lui valent le surnom de « Roi de la basoche ». La grande ordonnance de Blois (mai 1579) reprend et clarifie toutes les lois antérieures sur l’organisation de l’Église, la justice, l’enseignement, la fiscalité, le commerce, le gouvernement des provinces, etc. Le « code Henri III » (1587) se veut recueil « des ordonnances françaises réduites en sommaires à la forme et modèle du droit romain ».
Mais le roi est trop souvent indécis et son homosexualité lui fait accorder un crédit excessif à ses mignons, Épernon et Joyeuse (par ailleurs excellents guerriers). Les désordres du temps ne favorisent pas non plus l’autorité royale ! Il affrontera les quatre dernières guerres de Religion, chaque paix signée relance la suivante. Heureusement, le parti des « Politiques » vient à son secours : un de leur manifeste fait apparaître l’expression de « lois fondamentales du royaume » en 1575.
« Je me suis proposé pour unique fin le bien, salut et repos de mes sujets. En cette intention, j’ai finalement pris la voie de douceur et réconciliation, de laquelle l’on a déjà recueilli ce fruit qu’elle a éteint le feu de la guerre dont tout ce royaume était enflammé. »544
HENRI III (1551-1589), Discours aux États généraux de Blois, 6 décembre 1576. Henri III, les débuts de la Ligue, 1574-1578 (1887), Berthold Zellar
La volonté royale ne fait pas de doute, mais son pouvoir est insuffisant et le temps n’est pas encore venu de la modération et des Politiques.
Les princes protestants ont battu l’armée royale. Par la paix de Monsieur – ou paix de Beaulieu, en mai 1576 –, ils gagnent la liberté de culte (hors Paris) et de nombreuses places fortes dans le Midi. Les victimes de la Saint-Barthélemy sont réhabilitées, leurs biens restitués aux familles. D’autres mesures financières vident le Trésor, Catherine de Médicis met ses bijoux en gage, mais ça ne suffit pas ! D’où la convocation des États généraux.
Cette paix mécontente les ultra-catholiques. Des ligues de défense de la religion se créent en Picardie, puis un peu partout, bientôt unies en Ligue (Sainte Ligue ou Sainte Union) derrière le duc de Guise, avec l’appui du pape et du roi Philippe II d’Espagne. Et la sixième guerre de Religion commence.
« Je poursuis constamment mon dessein de la réunion de tous mes sujets à notre religion. »558
HENRI III (1551-1589), à Hurault de Maisse, ambassadeur à Venise, juillet 1586. Catherine de Médicis (1959), Jean Héritier
Mais le roi ne peut même pas s’allier les catholiques les plus ardents de la Ligue dont il a pris la tête ! Ce n’est point fanatisme religieux de sa part, mais la France est en majorité catholique et le moyen le plus évident de refaire l’unité du pays serait d’amener les protestants à se convertir. En attendant, il doit les combattre, à commencer par leur chef, Henri de Navarre.
« Souvenez-vous que je suis votre roi et que Dieu, le devoir et la raison veulent tous ensemble que vous me satisfassiez. »569
HENRI III (1551-1589), à Pierre d’Épinac, mai 1588. Henri III : roi shakespearien (1985), Pierre Chevallier
Le roi, fervent catholique, en appelle à Pierre d’Épinac, archevêque de Lyon et catholique ligueur. L’appel n’est pas entendu et l’excommunication en fait un ennemi, aux yeux des catholiques.
En désespoir de cause, Henri III va faire alliance contre les ligueurs avec le chef des protestants, le roi Henri III de Navarre (futur Henri IV).
« J’appelle avec moi tous ceux qui auront ce saint désir de paix. Je vous conjure tous, je vous appelle comme Français. Je vous somme que vous ayez pitié de cet État. »571
HENRI III DE NAVARRE (1553-1610), 4 mars 1589. Pensées choisies des rois de France (1920), recueillies et annotées par Gabriel Boissy
Le nouvel allié du roi en appelle à son tour à l’union des Français contre la Ligue. Au milieu de la tourmente religieuse et politique, il se montre déjà tel qu’il sera, soucieux du bien-être des paysans, cette partie essentielle du peuple qu’il désigne comme « le grenier du royaume, le champ fertile de cet État, de qui le travail nourrit les princes, la sueur les abreuve ». Longue et superbe adjuration. Qui ne sera pas entendue. Seule la force peut dénouer une telle situation.
L’armée d’Henri de Navarre rejoint celle du roi. La priorité est de s’emparer de Paris, livré aux fanatiques. Partout, des prêcheurs appellent au régicide – la nouvelle « religion ».
« Je suis tellement résolu en la religion catholique, je crois si fermement n’y avoir point de salut hors d’elle, que je prie Dieu me donner plutôt la mort que de permettre […] de varier jamais en cette créance. »572
HENRI III (1551-1589), Lettre à Jean de La Barrière, abbé de Notre-Dame des Feuillants, 6 avril 1589. Vie du vénérable Jean de La Barrière, abbé et réformateur de l’abbaye des Feuillants, fondateur de la Congrégation des Feuillants et des Feuillantines, et ses rapports avec Henri III, roi de France : avec pièces justificatives (1885), Annoncia Baxy
Avec les épreuves, la piété du roi devient extrême, sinon maladive. Persuadé que ses malheurs (dont l’absence d’héritiers) et ceux de son royaume sont causés par ses péchés, il participe aux processions de pénitents, s’impose des retraites spirituelles, se mortifie dans des monastères. Il a créé le couvent de Notre-Dame des Feuillants en 1587. Il se rapproche de ces moines blancs qui vont toujours tête et pieds nus, mangent à genoux, dorment sur des planches et s’imposent des privations surhumaines.
Le roi noue avec l’abbé une relation intime, ponctuée de lettres émouvantes. La Barrière lui reste fidèle, alors que certains de ses disciples participent à la Ligue – tel Bernard de Montgaillard, dit le Petit Feuillant, dont le roi déplore l’attitude.
Cette lettre écrite à Tours se termine ainsi : « Continuez vos bonnes prières et oraisons pour moi envers Sa divine Majesté, à ce qu’il lui plaise fortifier et assister de sa grâce ma juste cause et bonne intention, comme je le prie qu’il vous ait, monsieur de Feuillants, en sa sainte garde. »
Jean de La Barrière, bouleversé, prononcera l’oraison funèbre du roi, au Parlement de Bordeaux. Henri III se savait menacé, quasiment condamné, tant la haine et le fanatisme sont grands.
« Ah ! le méchant moine, il m’a tué, qu’on le tue ! »573
HENRI III (1551-1589), Saint-Cloud, 1er août 1589, « premier mot de la fin ». Mémoires relatifs à l’histoire de France, Journal de Henri III (posthume), Pierre de l’Estoile
Au château de Saint-Cloud, le roi prépare le siège de Paris avec Henri de Navarre : 30 000 hommes sont prêts à attaquer la capitale, défendue par la milice bourgeoise et la Ligue, armée par Philippe II d’Espagne.
Dominicain de 22 ans, ligueur fanatique, Jacques Clément préparait son geste : le complot est connu, approuvé de nombreux catholiques et béni par le pape Sixte Quint. Le moine réussit à approcher le roi – seul, sur sa chaise percée.
La garde personnelle (les Quarante-Cinq), alertée par les cris du roi poignardé, transperce l’assassin à coups d’épée : défenestré, le corps est sitôt tiré par quatre chevaux, écartelé, et brûlé sur le bûcher, pour régicide.
La scène se rejouera avec Ravaillac et Henri IV. Ces assassinats, comme tous les complots et attentats contre les rois de l’époque, s’inspirent de la théorie du tyrannicide, dont Jean Gerson fut l’un des prophètes : « Nulle victime n’est plus agréable à Dieu qu’un tyran. »
« Seul Henri de Navarre a droit au trône, et il est d’un caractère trop sincère et trop noble pour ne pas rentrer dans le sein de l’Église ; tôt ou tard, il reviendra à la vérité. »574
HENRI III (1551-1589), sur son lit de mort, « second mot de la fin », 1er août 1589. La Conversion et l’abjuration d’Henri IV, roi de France et de Navarre, Henri Gaubert
Le roi blessé à mort, transporté sur son lit, met en garde son allié contre le danger qui le menace à son tour et le conjure de se convertir.
Enfin et surtout, il trouve la force de désigner son successeur au trône et de le faire reconnaître face aux nobles présents. En même temps, il prophétise la conversion d’Henri de Navarre. De tous les mots de la fin qui ponctuent l’histoire de France, celui d’Henri III a une portée doublement remarquable.
Le roi meurt le lendemain : c’est la fin de la dynastie des Valois, au pouvoir depuis 1328. Place à la dynastie des Bourbons.
« Ce Roy étoit un bon prince, s’il eût rencontré un meilleur siècle. »575
Pierre de l’ESTOILE (1546-1611), Mémoires relatifs à l’histoire de France, Journal de Henri III (posthume)
Tel est le jugement du fidèle chroniqueur, à la mort du roi. Avec le recul de l’Histoire, il semble que ce soit bien vu. Le personnage est toujours discuté, mais son action finit par être reconnue.
Quant au siècle d’Henri III, son fanatisme étonne autant qu’il effraie. Paris honore le moine meurtrier comme un saint et un martyr. On célèbre des messes pour le repos de son âme, son portrait trône sur l’autel des églises. On le nomme libérateur de la religion, sauveur de Paris. L’ambassadeur d’Espagne annonce à Philippe Il l’assassinat d’Henri III en disant : « C’est à la main seule du Très-Haut qu’on est redevable de cet heureux événement. » On demande au pape la béatification de Jacques Clément, et, dans les processions, on porte son image sur une bannière, comme celle d’un saint et d’un héros.
Cependant que les princes ultra-catholiques jurent de ne jamais reconnaître Henri IV pour roi : « Plutôt mourir de mille morts ! »
6/ 1610 - Henri IV
Protestant converti au catholicisme, particulièrement exposé aux attentats, finalement assassiné par Ravaillac (adepte du tyrannicide) et devenu le plus populaire de nos rois.
« Le Diable est déchaîné. Je suis à plaindre et c’est merveille que je ne succombe pas sous le faix. Si je n’étais huguenot, je me ferais Turc ! »560
HENRI III DE NAVARRE (1553-1610), Lettre à Diane d’Andouins, dite la Belle Corisande, 8 mars 1588. Henri IV en Gascogne (1553-1589), Charles Henry Joseph de Batz-Trenquelléon
Le roi de Navarre se plaint à sa maîtresse de cette guerre de Religion dont il ne voit pas la fin - et qu’elle finance d’ailleurs par amour pour lui.
Grisé par ses victoires et poussé par les ligueurs catholiques (soutenus par les subsides du très catholique roi d’Espagne Philippe II), Henri de Guise se voit déjà roi de France et se comporte comme tel.
« Priez Dieu, Madame, que je vive longtemps, car mon fils vous maltraitera quand je n’y serai plus. »657
HENRI IV (1553-1610), à Marie de Médicis. Les Rois qui ont fait la France, Henri IV (1981), Georges Bordonove
Le roi sait-il que sa femme n’est pas étrangère à certains complots tramés autour de lui ? Cette phrase est en tout cas prémonitoire des relations entre la mère et le fils (Louis XIII) : une véritable guerre, au terme de laquelle Marie de Médicis perdra son pouvoir, ses amis, sa liberté, pour finir en exil.
« Ôtez tout cela de votre esprit. Dites des chapelets, mangez de bons potages et retournez en votre pays ! »660
Père d’AUBIGNY (fin XVIe-début XVIIe siècle) à Ravaillac, au matin du 14 mai 1610. La Politique des jésuites (1955), Pierre Dominique
Successivement valet de chambre, maître d’école, convers chez les Feuillants qui le chassèrent, François Ravaillac, comme Jacques Clément vingt ans avant, a la tête tournée par ceux qui prêchent la légitimité du tyrannicide et haussent le ton : Henri IV s’apprête à entrer en guerre contre les Habsbourg (Espagne et Pays-Bas) trop puissants en Europe et à s’allier aux princes protestants. L’idée d’un nouveau conflit avec la très catholique Espagne fait horreur aux extrémistes catholiques de France. Assassiner le roi paraît la solution « logique ».
Ravaillac, sûr de sa mission, exalté par ses visions, se dit l’homme du destin et va confesser son intention : ne pouvant approcher le roi pour lui parler, il veut le poignarder. Le père n’y croit pas – ou feint de ne pas le croire…
« Je mourrai un de ces jours et, quand vous m’aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais et la différence qu’il y a de moi aux autres hommes. »661
HENRI IV (1553-1610), à ses compagnons, au matin du 14 mai 1610. Mémoires (posthume, 1822), Maximilien de Béthune Sully
Ce jour-là, de très bonne heure, le roi est assailli de pressentiments. Il se sait menacé, après douze tentatives en dix ans – dix-huit selon d’autres calculs et vingt-cinq durant son règne !
Outre la théorie du tyrannicide qui causa la mort d’Henri III, d’autres motifs existent : la fiscalité qui s’alourdit pour préparer la guerre, le mécontentement croissant du peuple, les nobles jaloux des honneurs qu’ils n’ont pas, une affaire de cœur avec une très jeune maîtresse mariée au prince de Condé et qui se complique, une conspiration avec l’Espagne, née dans l’entourage de la reine et que le roi ne doit pas ignorer.
« Ce n’est rien. »662
HENRI IV (1553-1610), mot de la fin, 14 mai 1610. Histoire du règne de Henri IV (1862), Auguste Poirson
Il vient d’être poignardé par Ravaillac : l’homme a sauté dans le carrosse bloqué par un encombrement, rue de la Ferronnerie, alors que le roi se rendait à l’Arsenal, chez Sully son ministre et ami, souffrant. Le blessé a tressailli sous le coup et redit « Ce n’est rien », avant de mourir.
Le régicide sera écartelé, après avoir été torturé : il affirme avoir agi seul. Sully, dans ses Mémoires, n’y croit pas. Le mystère demeure sur la mort d’Henri IV le Grand. C’est l’une des grandes énigmes de l’Histoire de France.
« Je voudrais n’être point roi et que mon frère le fût plutôt : car j’ai peur qu’on me tue, comme on a fait du roi mon père. »663
LOUIS XIII (1601-1643), le soir du 14 mai 1610. Journal pour le règne de Henri IV et le début du règne de Louis XIII (posthume, 1960), Pierre de L’Estoile
L’enfant qui n’a pas neuf ans restera traumatisé à jamais par ce drame où sa mère est sans doute compromise.
« Votre Majesté m’excusera. Les rois ne meurent point en France. »664
Nicolas BRULART de SILLERY (1544-1624), 14 mai 1610. Le Mercure français (1611), Jean Richier
Ainsi parle le chancelier, devant le petit Louis XIII, cependant que la reine Marie de Médicis se lamente bien fort sur le corps du roi ramené au Louvre et que les conseillers la prient instamment d’agir « en homme et en roi ».
En juriste, Sillery rappelle un très ancien précepte de la monarchie française : « Le Roi de France ne meurt jamais » de sorte que le trône ne soit jamais vacant, d’où l’expression : « Le Roi est mort. Vive le roi ! »
« Il faut que je dise ici que la France, en le perdant, perdit un des plus grands rois qu’elle eût encore eus ; il n’était pas sans défauts, mais en récompense il avait de sublimes vertus. »665
Agrippa d’AUBIGNÉ (1552-1630). Histoire de France au dix-septième siècle, Henri IV et Richelieu (1857), Jules Michelet
Protestant ardent, mais resté fidèle au roi même après l’abjuration et l’édit de Nantes (qui ne le satisfaisait pas), d’Aubigné énonce une grande vérité à la mort d’Henri IV le Grand.
L’assassinat frappe la France de stupeur et fait du roi un martyr. Ce drame change aussitôt son image, fait taire toute critique et donne au personnage une immense popularité. La légende fera le reste. D’autant que la régente qui lui succède manque totalement de ces vertus politiques qui font les grands règnes.
7/ 1617 - Concino Concini
Protégé et conseiller de Marie de Médicis, ministre tout puissant, assassiné sur ordre de Louis XIII qui va enfin pouvoir régner, au terme de ce coup d’État royal.
« Quand je pense que mon père n’était que le secrétaire du grand-duc de Toscane et que je suis aujourd’hui le favori de la reine, et à ce titre, le Premier ministre du royaume le plus puissant d’Occident ! »7
Concino CONCINI (1569-1617), maréchal de France et marquis d’Ancre, baron de Lésigny, comte de Penna, Hélène Duccini, Concini, Grandeur et misère du favori de Marie de Médicis (1991)
Son ascension est liée au destin de Marie de Médicis, devenue régente après l’assassinat d’Henri IV. Il se méfiait de Concini et de sa femme Leonora Galigaï : « Je leur trouve des desseins au-dessus de leur condition et contraires à leur devoir. » Mais Concini est un bon partenaire de jeu de cartes… et le roi lui confie certaines missions diplomatiques, le nomme premier maître d’hôtel et premier écuyer, bien placé pour surveiller et influencer la reine.
La mort d’Henri IV permet l’irrésistible ascension des deux ambitieux. La reine a besoin d’un homme de confiance pour régner et Concini s’est arrangé pour épouser sa sœur de lait, Léonora Dori, surnommée la Galigaï, dame d’atours un peu sorcière, astrologue, devenue sa confidente et amie.
Depuis sa majorité en 1614, Louis XIII semble impatient de gouverner seul, sans s’encombrer de sa mère ni de son entourage. Il cherche surtout à se débarrasser de l’encombrant personnage qui contrôle tous les échelons du pouvoir, se permet de se couvrir en sa présence et de s’asseoir sur le trône à sa place ! Concini a tout fait pour se rendre détestable – c’est la « légende noire » de Concini, même si sa dernière biographe tend à réhabiliter l’homme d’État, entre Sully et Richelieu, dans la continuité des grands ministres qui ont bâti la monarchie absolue.
« L’homme le plus puissant du royaume, c’est moi. Ce jeune Louis XIII n’osera jamais porter atteinte à celui qui a tenu la France alors qu’il n’était encore qu’un enfant. »
Concino CONCINI (1569-1617), maréchal de France et marquis d’Ancre, baron de Lésigny, comte de Penna, Hélène Duccini, Concini, Grandeur et misère du favori de Marie de Médicis (1991)
Et pourtant… le jeune roi va se décider au coup d’État qui met fin à la Régence. Difficile de faire arrêter un homme qui dispose d’une armée personnelle de 7 000 soldats ! Après avoir longtemps hésité, il va le faire assassiner dans la cour du Louvre.
« Au nom du roi, je vous arrête ! »
Baron de VITRY (1581-1644), maréchal de France et capitaine des gardes du roi. Centre de recherche du château de Versailles, Nouvelle collections des Mémoires relatifs à l’histoire de France, tome V : Relation exacte de tout ce qui s’est passé à la mort du maréchal d’Ancre
« Que se passe-t-il donc ? » s’exclame Concino Concini, portant la main à son épée. Les soldats l’entourent et referment la porte d’accès au Louvre derrière lui, empêchant son escorte de venir le retrouver. Vitry sort son pistolet et tire cinq coups, trois atteignent Concini au visage et à la gorge. Il tombe à genoux, dos au parapet, tandis que les gardes l’achèvent à coups d’épée. Une fenêtre de l’appartement royal s’ouvre…
« Merci ! Grand merci à vous ! À cette heure, je suis roi ! »670
LOUIS XIII (1601-1643), au baron de Vitry, après l’assassinat de Concini au Louvre, 24 avril 1617. Louis XIII le Juste (1981), Georges Bordonove
Il n’en pouvait plus d’attendre, écarté par sa mère qui le traite en enfant et humilié par son conseiller nommé maréchal d’Ancre et promu maréchal de France alors qu’il n’a jamais combattu. Ministre tout-puissant à la cour, Concini était également devenu très impopulaire dans le pays.
« Qu’on m’aille quérir les vieux serviteurs du feu roi mon père et anciens conseillers de mon Conseil d’État. C’est par le conseil de ceux-là que je veux gouverner. »671
LOUIS XIII (1601-1643), après l’assassinat de Concini au Louvre, 24 avril 1617. Histoire générale de la France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours (1843), Abel Hugo
Premier acte d’autorité, le jeune roi de 15 ans roi fait le vide au Conseil, renvoyant par là même Richelieu, lié au clan Concini. Et il rappelle Brulart de Sillery et les « barbons » du temps de son père Henri IV.
« Si on ne veut pas lui dire la nouvelle, qu’on la lui chante ! »672
MARIE DE MÉDICIS (1575-1642), 24 avril 1617. Richelieu (1968), Philippe Erlanger
La reine mère a ce mot terrible, quand on lui demande d’annoncer la mort de Concini à sa femme Léonora Galigaï - confidente et sœur de lait de Marie de Médicis, c’est une amie de quarante ans !
Concini abattu dans la cour du Louvre, enterré discrètement dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, est exhumé par la populace parisienne et traîné dans les rues de Paris, puis profané. Après avoir été lapidé et bâtonné, il est pendu par les pieds à l’une des potences qu’il avait fait élever sur le pont Neuf, puis dépecé et ses restes brûlés.
Sa femme est jugée pour trahison, sorcellerie, juiverie, pratique de la magie réprouvée et de l’astrologie judiciaire. Condamnée pour crime de « lèse-majesté divine et humaine », elle est décapitée, mais la foule ne l’a pas conspuée. Elle a vu que cette femme a su faire preuve de courage, tandis que les juges ont semblé s’acharner contre elle. L’opinion publique s’était retournée en sa faveur.
« On m’a fait, six ans durant, fouetter les mulets aux Tuileries. Il est temps qu’enfin je fasse mon métier de roi. »674
LOUIS XIII (1601-1643), après la mort de Concini et le départ de Marie de Médicis. Louis XIII et Richelieu (1855), Alexandre Dumas
Pour une fois, le romancier est fidèle à l’histoire et le mot de Louis XIII est souvent repris. L’heure de sa revanche a sonné. Richelieu (introduit au Conseil du roi par Concini) est relégué à Luçon, mais il saura rendre cette disgrâce très provisoire. Marie de Médicis se retrouve en exil et en prison à Blois, mais s’en évadera en 1619 pour prendre la tête d’une révolte des Grands contre le roi.
Pour faire son métier de roi qu’il prend très au sérieux, Louis XIII aura toujours besoin d’un second. Luynes à ses côtés, promu duc, pair, connétable de France, gouverneur de Picardie, va diriger les affaires du royaume. Belle promotion pour le fauconnier royal – il est vrai que Louis XIII adore la chasse. Mais quand même, tant d’honneurs et de pouvoir ! On va jusqu’à comparer le favori à Concini.
8/ 1793 - Louis XVI
Victime de la Révolution, condamné et guillotiné au terme d’un procès perdu d’avance et très diversement jugé par les contemporains et les historiens.
« Dans les circonstances où se trouve la monarchie française, il faudra au jeune roi de la force et du génie. »1198
FREDERIC II de Prusse (1712-1786). Œuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse : Correspondance (1788), Frederick II
Admirateur de Richelieu, de Louis XIV et du Grand Siècle, il porte ce jugement qui vaut déjà condamnation de Louis XVI, après un an de règne. Ce grand politique qui mena la puissance prussienne à son apogée (avec tous les excès de l’autoritarisme et du centralisme) prévoit la course à l’abîme de la monarchie française.
« Il n’aura probablement jamais ni la force ni la volonté de régner par lui-même. » Parole de Mercy-Argenteau, ambassadeur d’Autriche à Paris de grande influence sur Marie-Antoinette. Il note l’inquiétante sujétion du roi vis-à-vis de sa femme : « Sa complaisance ressemble à de la soumission. »
Mirabeau tentant de sauver la royauté en juillet 1790 soupirera : « Le roi n’a qu’un homme : c’est sa femme. »
Choiseul se montre plus sévère, voyant en Louis XVI un « imbécile » au sens d’handicapé cérébral ; selon ses frères et ses cousins, cette imbécillité aurait justifié un Conseil de régence (comme jadis pour Charles VI le Fou). En fait, Louis XVI est surtout un timide maladif, myope de surcroît au point de ne pas reconnaître les gens.
« L’Assemblée nationale renferme dans son sein les dévastateurs de ma monarchie, mes dénonciateurs, mes juges et probablement mes bourreaux ! On n’éclaire pas de pareils hommes, on ne les rend pas justes, on peut encore moins les attendrir. »1461
LOUIS XVI (1754-1793), Lettre à Malesherbes écrite à la prison du Temple, décembre 1792. Lettre LXXI, non datée. Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (1822), Saint-Albin Berville, François Barrière
La Convention s’est érigée en tribunal : le procès du roi se tient dans la salle du Manège toujours ouverte au public, ce qui dramatise encore l’événement. Louis XVI, devenu Louis Capet (dynastie des Capétiens), choisit d’abord un avocat renommé, Target, qui se dérobe, pour ne pas être compromis. Un autre accepte, Tronchet, mais émet des réserves pour préserver sa responsabilité. Malesherbes (73 ans) propose ses services, par fidélité au maître qui l’honora de sa confiance en tant que ministre – le roi est fort touché par ce geste. Et Desèze viendra assister ses deux confrères. Le procès se déroule du 10 décembre 1792 au 20 janvier 1793.
« Foutre ! […] Il est bon que le peuple souverain s’accoutume à juger les rois. »1463
Jacques HÉBERT (1757-1794), Le Père Duchesne, décembre 1792. Histoire politique et littéraire de la presse en France (1860), Eugène Hatin
Le journal d’Hébert, dont le nom est peut-être inspiré par un marchand de fourneaux qui jurait et sacrait à chaque phrase, s’exaspère des lenteurs procédurales et craint que « le plus grand scélérat qui eût jamais existé reste impuni », entre jurons et injures contre les Conventionnels, les traîtres, l’« ivrogne Capet » et tous les « capons ».
« Louis, le peuple français vous accuse d’avoir commis une multitude de crimes pour établir la tyrannie en détruisant la liberté. »1464
Acte d’accusation de Louis XVI, Convention, 11 décembre 1792. Archives parlementaires de 1787 à 1860 (1899), Assemblée nationale
Chefs d’accusation les plus graves : haute trahison, double jeu politique avec les assemblées, complot avec l’ennemi autrichien, tentative de fuite à l’étranger (Varennes), responsabilité des morts aux journées d’octobre (1789) et à la fusillade du Champ de Mars (17 juillet 1791).
Le 12 décembre, la Convention accorde trois défenseurs au roi. Mais aucun témoin, ni à charge ni à décharge.
« Je subirai le sort de Charles Ier, et mon sang coulera pour me punir de n’en avoir jamais versé. »1465
LOUIS XVI (1754-1793), Lettre à Malesherbes, écrite au Temple, décembre 1792. Mémoires du marquis de Ferrières (1822)
Précédent historique maintes fois rappelé : Charles Ier, roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, victime de la révolution anglaise, jugé par le Parlement, décapité en 1649.
Louis XVI, ce roi si faible, incapable de régner quand il avait le pouvoir et les hommes (quelques grands ministres), cet homme de 38 ans prématurément vieilli, parfois comparé à un vieillard, va faire preuve de courage et de lucidité dans ces deux derniers mois. Toujours à son ami et avocat, Malesherbes, il écrit : « Je ne me fais pas d’illusion sur mon sort ; les ingrats qui m’ont détrôné ne s’arrêteront pas au milieu de leur carrière ; ils auraient trop à rougir de voir sans cesse sous leurs yeux leur victime. »
« Louis XVI hors de Versailles, hors du trône, seul et sans cour, dépouillé de tout l’appareil de la royauté, se croyait roi malgré tout, malgré le jugement de Dieu, malgré sa chute méritée, malgré ses fautes […] C’est là ce qu’on voulut tuer. C’est cette pensée impie. »1466
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de la Révolution française (1847-1853)
L’historien dit le paradoxe de cette tragédie à la fois personnelle et nationale. Louis XVI, profondément croyant, demeure en son âme et conscience « roi de droit divin » et non pas roi des Français dans une monarchie constitutionnelle. La France profonde, très catholique, partage cette « pensée impie », d’où le traumatisme causé par ce procès public à l’issue passionnément attendue.
« Le véritable patriote ne connaît point les personnes, il ne connaît que les principes. »1467
Camille DESMOULINS (1760-1794), 15 décembre 1792 au procès du roi. Œuvres de Camille Desmoulins (posthume, 1874), Camille Desmoulins, Jules Claretie
Montagnard, membre des Cordeliers et ami de Danton, il exprime la pensée devenue majoritaire dans le personnel politique. Et le roi qui n’est plus roi, mais seulement Louis Capet, est un justiciable comme les autres dans ce procès.
« Louis sera-t-il donc le seul Français pour lequel on ne suive nulle loi, nulle forme ? Louis ne jouit ni du droit de citoyen, ni de la prérogative des rois : il ne jouira ni de son ancienne condition, ni de la nouvelle ! Quelle étrange exception. »1468
Romain DESÈZE (1748-1828), Plaidoirie pour Louis XVI, 26 décembre 1792. Histoire de France depuis la Révolution de 1789 (1803), François-Emmanuel Toulongeon
L’avocat témoignera plus tard du grand œuvre de sa vie : « Trois jours et quatre nuits, j’ai lutté pied à pied avec les documents pour édifier avec Malesherbes et Tronchet, et surtout avec mon Roi, la défense de celui qui était déjà condamné par la Convention. J’ai voulu plaider avec la justice, le cœur, le talent que l’on me reconnaissait alors. Mon maître ne me laissa combattre que sur le terrain du droit : il se souciait de balayer les accusations dont il était l’objet, non d’apitoyer. Pendant plus d’une heure, je lui ai donné ma voix. En vain… »
« Il a bien travaillé. »1469
LOUIS XVI (1754-1793), après la plaidoirie de son avocat Romain Desèze, 26 décembre 1792. Histoire socialiste, 1789-1900, Volume 4, La Convention (1908), Jean Jaurès
Desèze s’est assis, épuisé après la plaidoirie. En sueur, il demande une chemise. « Donnez-la-lui, car il a bien travaillé » dit le roi. « Avec une familiarité touchante et un peu vulgaire », commente l’historien socialiste.
« La clémence qui compose avec la tyrannie est barbare. »1470
ROBESPIERRE (1758-1794), Discours du 28 décembre 1792 au procès de Louis XIV. Archives parlementaires de 1787 à 1860 (1899), Assemblée nationale
Quand le chef des Montagnards prend la parole en commençant par « Citoyens… », c’est naturellement contre l’accusé, mais au nom de grands principes. L’Incorruptible est avocat de profession et il n’est pas homme à « composer ». Quant à la clémence, elle n’est plus de mise, non plus que la simple déchéance du roi jadis envisagée. Robespierre votera donc pour la mort du roi.
« On ne peut point régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. »1471
SAINT-JUST (1767-1794), Question concernant le jugement de Louis XVI, 13 novembre 1792. Œuvres de Saint-Just, représentant du peuple à la Convention nationale (posthume, 1834), Saint-Just
Jeune théoricien de la Révolution, il s’est exprimé sur le procès du siècle avant le procès, et dans le même esprit, fond et forme, que son ami Robespierre. Il avait déjà écrit en 1791, dans L’Esprit de la Révolution et de la Constitution en France : « Tous les crimes sont venus de la tyrannie qui fut le premier de tous. » Saint-Just votera bien évidemment pour la mort du roi. D’autres Montagnards auront des arguments moins juridiques. Mais les Girondins vont tenter de sauver la vie du roi.
« Quand la justice a parlé, l’humanité doit avoir son tour. »1472
Pierre Victurnien VERGNIAUD (1753-1793), Discours du 17 janvier 1793. Les Grands Orateurs de la Révolution, Mirabeau, Vergniaud, Danton, Robespierre (1914), François-Alphonse Aulard
Girondin (du département de la Gironde), avocat au Parlement de Bordeaux, maintenant à la tête des Girondins de Paris, Vergniaud, président de séance, cherche à sauver Louis XVI. Les Girondins craignent d’en faire un martyr, d’autres redoutent que la Révolution se radicalise à l’extrême.
Première question posée le 15 janvier : Louis Capet est-il « coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d’attentats contre la sûreté générale de l’État ? » Oui, pour 707 députés sur 718 présents. C’est la quasi-unanimité pour une culpabilité évidente. La « justice a parlé ».
Deuxième question, même jour : le jugement de la Convention sera-t-il soumis à la ratification populaire ? Les Girondins sont pour cet appel au peuple, persuadés que la clémence l’emportera : l’« humanité » aurait son tour. Mais cela risque de diviser la France, de faire croire à une démission de la Convention. Les Montagnards sont massivement contre et le Non l’emporte : 424 voix contre 283, une dizaine d’abstentions et une trentaine d’absents.
Troisième question, posée dans la séance du 16 au 17 janvier : la peine encourue.
« Je vote pour la mort du tyran dans les vingt-quatre heures. Il faut se hâter de purger le sol de la patrie de ce monstre odieux. »1473
Nicolas RAFFRON de TROUILLET (1723-1801). Base de données des députés français depuis 1789 [en ligne], Assemblée nationale
Avocat et diplomate, il s’est rangé du côté de la Montagne durant le procès du roi. Il fait aussi partie de ceux qui ont refusé l’appel au peuple.
« Pour préserver les âmes pusillanimes de l’amour de la tyrannie, je vote pour la mort dans les vingt-quatre heures ! »1474
Claude JAVOGUES (1759-1796). Base de données des députés français depuis 1789 [en ligne], Assemblée nationale
366 députés votent pour la mort sans condition, 72 pour la mort sous diverses conditions et 288 pour d’autres peines (prison, bannissement). Cela trahit un embarras certain des députés. D’où la décision de voter à nouveau pour un éventuel sursis à l’exécution, quatrième question, posée les 19 et 20 janvier : sursis rejeté par 380 députés contre 310. Contrairement à la légende, Louis XVI n’a pas été condamné à mort à une voix de majorité ! Mais son cousin Philippe Égalité s’est totalement déconsidéré en votant pour la mort.
Les votes se sont déroulés sur quatre jours, nuits comprises, avec appel nominal, chaque député montant à la tribune pour justifier chaque fois son vote sur la peine à appliquer. Le jugement, l’appel au peuple et le sursis une fois rejetés, la sentence est exécutoire dans les 24 heures.
« L’arbre de la liberté ne saurait croître s’il n’était arrosé du sang des rois. »1475
Bertrand BARÈRE de VIEUZAC (1755-1841), à la tribune, 20 janvier 1793. Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’État : sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration (1829), Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne
Le président de la Convention, dans l’effervescence générale, justifie ainsi la condamnation à mort de Louis XVI contre la partie la plus modérée de l’assemblée qui souhaitait atténuer la peine. Lui-même s’est prononcé pour la mort sans appel au peuple, sans sursis à l’exécution. On retrouvera Barère en juillet 1793, membre du Comité de salut public et l’un des organisateurs les plus zélés de la Terreur, nommé l’Anacréon de la guillotine.
« Louis doit mourir pour que la patrie vive. »1476
ROBESPIERRE (1758-1794), « célèbre sentence ». Dictionnaire critique de la Révolution française (1992), François Furet, Mona Ozouf
Ces mots furent prononcés au début du procès, le 3 décembre. « Je n’ai pour Louis ni amour ni haine : je ne hais que ses forfaits… » En fait, le roi était jugé d’avance. La Révolution, c’est la souveraineté du peuple et elle ne peut composer avec la souveraineté du roi. Ce n’est pas l’homme Capet qui est en cause, aux yeux des théoriciens tels que Robespierre et Saint-Just, c’est l’extravagante condition du monarque.
Au terme de la procédure, l’exécution aura lieu le 21 janvier 1793.
« Fils de Saint Louis, montez au ciel. »1478
Abbé EDGEWORTH de FIRMONT (1745-1807), confesseur de Louis XVI, au roi montant à l’échafaud, 21 janvier 1793. Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (1822), Saint-Albin Berville, François Barrière
Le mot est rapporté par les nombreux journaux du temps. La piété de Louis XVI est notoire et en cela, il est fils de Saint Louis. C’est aussi le dernier roi de France appartenant à la dynastie des Capétiens, d’où le nom de Louis Capet sous lequel il fut accusé et jugé.
« Peuple, je meurs innocent ! »1479
LOUIS XVI (1754-1793), à la foule, place de la Révolution à Paris (aujourd’hui place de la Concorde), 21 janvier 1793. Mémoires d’outre-tombe (posthume), François René de Chateaubriand
L’importance de l’événement est telle que l’imagination populaire ou historienne se donne libre cours. Le roulement de tambours de la garde nationale interrompt la suite de sa proclamation, entendue seulement par le bourreau Sanson et ses aides. La scène sera maintes fois reproduite en gravures et tableaux, avec le bourreau qui brandit la tête du roi, face au peuple amassé.
Autres « mots de la fin » : « Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. » Et dans le même esprit : « Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Et encore : « Dieu veuille que ce sang ne retombe pas sur la France. » Cela relève de la « belle mort » comme pour alimenter la légende. Reste un fait avéré. Louis XVI, tout au long de sa vie, eut une obsession louable et rare chez un roi : ne pas faire couler le sang des Français.
« Le jour où la France coupa la tête de son roi, elle commit un suicide. »1483
Ernest RENAN (1823-1892), La Réforme intellectuelle et morale de la France (1871)
Historien chrétien, il fait référence au lien charnel entre le pays et le roi, allant jusqu’à l’identification à la fin du Moyen Âge, sous Louis XI qui affirme : « Je suis France ». Plus contemporain, on pense aussi au mot de Mauriac à propos du général de Gaulle, en 1940 : « Un fou a dit, moi la France, et personne n’a ri parce que c’était vrai. »
« On a tué des rois bien avant le 21 janvier 1793. Mais Ravaillac, Damiens et leurs émules voulaient atteindre la personne du roi, non le principe […] Ils n’imaginaient pas que le trône pût rester toujours vide. »1484
Albert CAMUS (1913-1960), L’Homme révolté (1951)
Il est vrai que l’histoire du monde est riche en régicides. Mais les assassins des rois qui tuent un homme ne font que renforcer le mythe de la royauté. Alors qu’un procès public, devant une Assemblée nationale devenue tribunal du peuple, devait mettre fin à la monarchie de droit divin. La mort du roi, chacun en juge selon son camp, des royalistes aux révolutionnaires, en passant par toutes les nuances d’opinion, de la droite réactionnaire à la gauche extrême. Cela vaut de manière plus générale pour la Révolution et aujourd’hui encore, on en discute.
« Vous savez l’affreuse nouvelle, ma bonne Rose. Votre cœur, comme mon cœur, en a tressailli d’indignation. Voilà donc notre pauvre France livrée aux misérables qui nous ont déjà fait tant de mal […] Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l’ont assassinée. »1486
Charlotte CORDAY (1768-1793), Lettre à une amie, 28 janvier 1793. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
C’est le cri du cœur d’une partie de la France, littéralement épouvantée d’avoir tué son roi. Autre conséquence directe, imprévue sinon imprévisible, et la plus dramatique de toutes, la guerre de Vendée, une guerre civile qui va déchirer, endeuiller, marquer profondément le pays.
9/ 1793 - Marat
« L’Ami du peuple », révolutionnaire le plus extrême et détesté par ses confrères, poignardé par Charlotte Corday, jeune héroïne aussitôt guillotinée.
« L’aigle marche toujours seul, le dindon fait troupe ! »1303
MARAT (1743-1793) en réponse à Fréron et Desmoulins, septembre 1789. Le Petit Livre de la Révolution française (1989), Jean Vincent
Marat est un solitaire, il ne supporte pas la moindre objection. Quand il crée son journal, l’Ami du peuple (à partir du 12 septembre 1789), il refuse en ces termes aux deux journalistes révolutionnaires de participer à la rédaction.
La phrase explique aussi pourquoi cet éternel aigri qui se pose en « ami du peuple » n’a pas d’ami. Marat est tout à la fois le grand malade, le grand persécuté, le grand visionnaire de son temps. Il se pose comme « le seul homme à avoir vu clair », l’éternel prophète de malheur.
« Au-delà de ce que propose Marat, il ne peut y avoir que délire et extravagance. »1305
Camille DESMOULINS (1760-1794). Le Vieux cordelier : journal politique (1825), Camille Desmoulins, Joachim Vlate
Et Lamartine écrira dans son Histoire des Girondins : « Marat personnifiait en lui ces rêves vagues et fiévreux de la multitude qui souffre […] Il introduisait sur la scène politique cette multitude jusque-là reléguée dans son impuissance. »
Marat joue le rôle du journaliste redresseur de torts et formateur de l’opinion publique, critiquant toujours tout et tous, voulant ouvrir les yeux, ne cessant de réclamer des têtes, inventant le langage même de la Terreur, cherchant à détruire tous ses adversaires. En cela, il incarne le révolutionnaire type jusqu’à la caricature.
« Il y a une année que cinq ou six cents têtes abattues vous auraient rendus libres et heureux. Aujourd’hui, il en faudrait abattre dix mille. Sous quelques mois peut-être en abattrez-vous cent mille, et vous ferez à merveille : car il n’y aura point de paix pour vous, si vous n’avez exterminé, jusqu’au dernier rejeton, les implacables ennemis de la patrie. »1380
MARAT (1743-1793), L’Ami du peuple, décembre 1790. Histoire politique et littéraire de la presse en France (1860), Eugène Hatin
Déjà populaire auprès du petit peuple parisien, mais détesté de toute la classe politique, Marat joue au « prophète de malheur » dans le journal quotidien qu’il publie et qui est pour l’heure sa seule tribune. Ici, c’est un véritable appel au meurtre, alors que la guillotine n’est pas encore entrée en scène et que la Terreur est une notion inconnue.
Ce genre de phrase et le personnage de Marat révoltent les modérés. On parlerait aujourd’hui et sans exagération de « paranoïa ». Hugo écrit, dans son roman Quatre-vingt-treize : « Les siècles finissent par avoir une poche de fiel. Cette poche crève. C’est Marat. »
« Les factions éclatent de toutes parts : la Montagne triomphe par le crime et par l’oppression ; quelques monstres abreuvés de notre sang conduisent ces détestables complots […] Si je ne réussis pas dans mon entreprise, Français, je vous ai montré le chemin : vous connaissez vos ennemis. Levez-vous, marchez et frappez. »1519
Charlotte CORDAY (1768-1793), Adresse aux Français, amis des lois et de la paix. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Cette jeune normande de 25 ans, montée à Paris pour tuer Marat, écrit le 12 juillet 1793 un long texte dans le style de l’époque – descendante de Corneille, elle a aussi beaucoup lu Plutarque, Tacite, et Rousseau. On le trouvera sur elle le lendemain, lors de son arrestation près de la baignoire où elle vient de poignarder Marat – un eczéma sur tout le corps l’oblige à passer des heures dans l’eau pour moins souffrir, et il a reçu la visiteuse, censée lui apporter une liste de traîtres à la patrie.
Six mois plus tôt, l’exécution du roi l’a épouvantée, comme tant de Français : « Voilà donc notre pauvre France livrée aux misérables qui nous ont déjà fait tant de mal […] Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l’ont assassinée. » Elle va en quelque sorte venger le roi, venger la France : en assassinant l’assassin, elle fait acte de justice. Le retentissement de ce « fait divers politique » est considérable.
« Ici repose Marat, l’Ami du Peuple, assassiné par les ennemis du peuple, le 13 juillet 1793. »1520
Épitaphe sur la tombe de Marat. Marat, l’ami du peuple (1865), Alfred Bougeart
Son journal s’intitulait L’Ami du peuple et l’homme haï (et redouté) de ses confrères était idolâtré des sans-culottes. Lamartine explique cette popularité dans son Histoire des Girondins : « Marat personnifiait en lui ces rêves vagues et fiévreux de la multitude qui souffre. Il introduisait sur la scène politique cette multitude jusque-là reléguée dans son impuissance. »
« Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais républicaine bien avant la Révolution. »1522
Charlotte CORDAY (1768-1793), à son procès devant le Tribunal révolutionnaire, 17 juillet 1793. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
En un jour, la jeune fille devient une héroïne et reste l’une des figures de la Révolution. Le poète André Chénier la salue par ces mots : « Seule, tu fus un homme », ce qui contribuera à le perdre. Le député de Mayence, Adam Lux, qui la vit dans la charrette l’emmenant à l’échafaud, s’écria : « Plus grande que Brutus » et ce mot lui coûta la vie.
Lamartine la baptise l’Ange de l’assassinat et Michelet retrouve les accents qu’il eut pour Jeanne d’Arc : « Dans le fil d’une vie, elle crut couper celui de nos mauvaises destinées, nettement, simplement, comme elle coupait, fille laborieuse, celui de son fuseau. »
10/ 1805 - duc d’Enghien
Dernier prince de Condé, innocent du complot dont on l’accuse, sitôt jugé, condamné, exécuté par ordre du futur Napoléon qui ne regrettera jamais cet acte politique.
« Les Bourbons croient qu’on peut verser mon sang comme celui des plus vils animaux. Mon sang cependant vaut bien le leur. Je vais leur rendre la terreur qu’ils veulent m’inspirer […] Je ferai impitoyablement fusiller le premier de ces princes qui me tombera sous la main. »1743
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), 9 mars 1804. Histoire du Consulat et de l’Empire (1847), Adolphe Thiers
« L’air est plein de poignards » a dit Fouché, ex-ministre de la Police en janvier 1804. Cadoudal, général chouan, conspirateur et organisateur de l’attentat manqué du 24 décembre 1800 contre le Premier Consul (la « machine infernale ») vient d’être arrêté au terme d’une course-poursuite meurtrière au Quartier latin. Il a parlé sans le nommer d’un prince français complice : de l’avis de tous, c’est le duc d’Enghien, émigré près de la frontière en Allemagne.
Le lendemain, en proie à une fureur extrême, le Premier Consul donne l’ordre de l’enlever, ce qui sera fait dans la nuit du 15 au 16 mars par une troupe d’un millier de gendarmes, au mépris du droit des gens (droit international).
« Le gouvernement arrête que le ci-devant duc d’Enghien, prévenu […] de faire partie des complots tramés […] contre la sûreté intérieure et extérieure de la République, sera traduit devant une commission militaire. »1744
Procès-verbal du 20 mars 1804. Mémoires historiques sur la catastrophe du duc d’Enghien (1824), Louis-Antoine Henri de Bourbon
Le prince qui préparait son mariage et ne comprend rien à ce qui lui arrive se retrouve enfermé au château de Vincennes. Le soir même, il est jugé, condamné à mort, exécuté.
« Qu’il est affreux de mourir ainsi de la main des Français ! »1745
Duc d’ENGHIEN (1772-1804), quelques instants avant son exécution, 21 mars 1804. Son mot de la fin. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
Bonaparte a maintenant la preuve que le prince de 32 ans, dernier rejeton de la prestigieuse lignée des Condé, n’est pour rien dans le complot Cadoudal – il est quand même le chef d’un réseau antirépublicain qui a fait le projet de l’assassiner.
De tous les condamnés à mort réellement impliqués, il ne regrettera que Cadoudal, 33 ans. Pichegru s’est suicidé dans sa cellule. Moreau, jugé, condamné à deux ans de prison, sera finalement exilé. Mais l’histoire retient surtout le drame du duc d’Enghien. Bonaparte l’a laissé condamner après un simulacre de jugement, puis fusiller la nuit même dans les fossés de Vincennes. Sans regret ni remords.
« La saignée entre dans les combinaisons de la médecine politique. »1746
NAPOLÉON Ier (1769-1821). Le Bonapartisme (1980), Frédéric Bluche
Empereur, il écrira ces mots, en repensant à l’exécution du duc d’Enghien. Et dans son testament à Sainte-Hélène, il revendique la responsabilité de cet acte que la postérité jugera comme un crime.
« C’est pire qu’un crime, c’est une faute. »1747
Antoine Claude Joseph BOULAY de la MEURTHE (1761-1840), apprenant l’exécution du duc d’Enghien, le 21 mars 1804. Mot parfois attribué, mais à tort, à FOUCHÉ (1759-1820) ou à TALLEYRAND (1754-1838). Les Citations françaises (1931), Othon Guerlac
Conseiller d’État et pourtant fidèle à Bonaparte du début (coup d’État de brumaire) à la fin (Cent-Jours compris), il a ce jugement sévère. Le mot est parfois attribué à Fouché (par Chateaubriand) ou à Talleyrand (par J.-P. Sartre). Mais les deux hommes ont poussé Bonaparte au crime et il n’est pas dans leur caractère de s’en repentir.
Cette exécution sommaire indigne l’Europe et toutes les têtes couronnées se ligueront contre l’empereur – là est « la faute ». Le drame émeut la France : détails sordides de l’exécution et douleur de la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort qui portera toute sa vie le deuil de cet amour. Mais les royalistes se rallieront majoritairement à Napoléon – et en cela, il a politiquement bien joué.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.