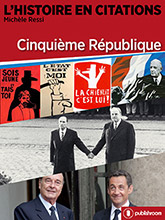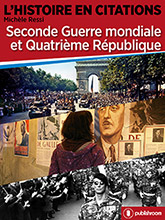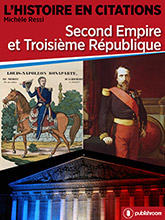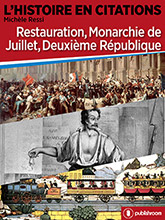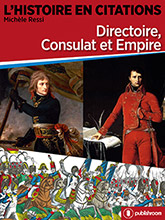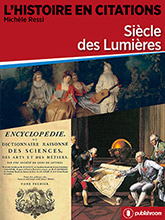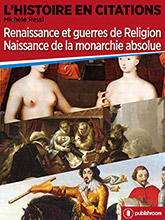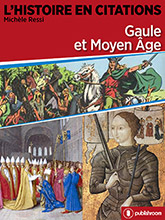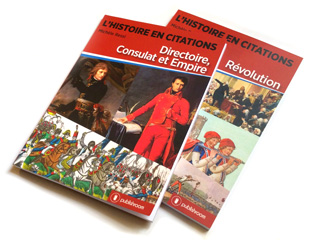« Il n’y a qu’un devoir, c’est d’être heureux. Puisque ma pente naturelle, invincible, inaliénable est d’être heureux, c’est la source unique de mes vrais devoirs, et la seule base de toute bonne législation. »
DIDEROT (1713-1784), Mémoires pour Catherine II (posthume)
Le bonheur n’est pas d’actualité ? Bonne raison pour lui consacrer un édito !
« Les peuples heureux n’ont pas d’histoire » (attribué à Hegel). C’est une contrevérité.
Le bonheur est présent du Moyen Âge à nos jours : logiquement au siècle des Lumières qui se veut heureux, fréquemment dans les périodes de crise, mais plus que tout sous la Révolution.
Ce paradoxe du bonheur s’impose clairement. Projet conforme à l’optimisme de Mirabeau le bon vivant, notre première grande voix révolutionnaire, le Bonheur (majuscule) devient quasi-religion en pleine Terreur avec Robespierre et sa Fête de l’Être suprême (8 juin 1974), tandis que son ami Saint-Just en fait « une idée neuve en Europe ».
Le bonheur sous toutes ses formes (joie, plaisir, gaieté…) s’impose volontiers en proverbes et en chansons, pouls de l’opinion publique avant les sondages.
Toutes les données sont empruntées à notre Histoire en citations, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
Moyen Âge
« Après la panse vient la danse. »138
Dicton populaire. Dictionnaire de l’Académie française (1694), au mot « panse »
Contrairement à l’idée qu’on se fait d’une période sombre, hors les temps de famine, de peste, de guerre, on mange, on boit, on s’amuse bien au Moyen Âge, au château comme au village.
« Nous, en France, nous n’avons rien sinon le pain, le vin et la gaieté. »183
LOUIS VII le Jeune (vers 1120-1180), à l’ambassadeur du roi d’Angleterre, vers 1150. Histoire de la chrétienté d’Orient et d’Occident (1995), Jacques Brosse
Ainsi le roi vante-t-il les vraies richesses des Français à l’archidiacre d’Oxford, Gautier Map qui l’entretenait de la richesse du royaume d’Angleterre.
Louis VII oppose fièrement son pays aux autres royaumes : « Le roi des Indes a des pierres précieuses, des lions, des léopards, des éléphants ; l’empereur de Byzance se glorifie de son or et de ses tissus de soie ; le Germanique a des hommes qui savent faire la guerre, et des chevaux de combat. Ton maître le roi d’Angleterre a hommes, chevaux, or, pierres précieuses, fruits. Nous, en France, nous n’avons rien sinon le pain, le vin et la gaieté. »
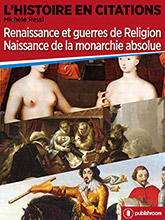 De la Renaissance au siècle de Louis XIV
De la Renaissance au siècle de Louis XIV
« Voyez, voyez tout à la ronde
Comment le monde rit au monde,
Ainsi est-il en sa jeunesse. »386Clément MAROT (1496-1544), Colloque de la Vierge méprisant le mariage (publication posthume)
C’est la Renaissance, l’aube des temps nouveaux, appelée par les historiens le « beau XVIe siècle » : de 1480 à 1560, opposé à la période suivante des guerres de Religion, série de tragédies inhérentes à toute guerre civile.
Cet heureux temps est salué par Marot, aimable poète et courtisan, comme par toute la Pléiade et nombre de contemporains : « Ô siècle ! les lettres fleurissent, les esprits se réveillent, c’est une joie de vivre ! » s’exclame l’humaniste Ulrich de Hutten. Rappelons la seule règle morale de l’abbaye de Thélème chère à Rabelais : « Fais ce que voudras. »
« En 1619, on avait à grand bruit imprimé dans Le Mercure, pour la joie de la France, que le roi commençait enfin à faire l’amour à la reine. »676
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de France au dix-septième siècle, Henri IV et Richelieu (1857)
La grande Histoire est faite aussi de ces petites histoires et le peuple se passionne pour les secrets d’alcôves royales. Anne d’Autriche « était arrivée à 13 ans. Et, pendant trois ans, son mari avait oublié qu’elle existât. » Il faudra encore vingt ans pour que naisse un enfant de cette union.
Précisons que le roi ne négligeait pas sa femme pour s’occuper de ses maîtresses, étant par nature, en cela comme en presque tout, bien différent de son père (Henri IV) et de son fils (Louis XIV) ! « À Dieu ne plaise que l’adultère entre jamais en ma maison ! » dit-il un jour. Son homosexualité n’est pas certaine, non plus que son impuissance, mais il préfère le commerce de ses favoris à celui des femmes.
« Nous avons un Dauphin,
Le bonheur de la France,
Rions, buvons sans fin
À l’heureuse naissance. »725SAINT-AMANT (1594-1661), La Naissance de Louis XIV (1638), chanson. Des chansons populaires chez les anciens et chez les Français (1867), Charles Nisard
Sous la monarchie (héréditaire), la naissance d’un enfant royal est toujours une occasion de fêtes pour le peuple. Quand c’est un fils attendu depuis plus de vingt ans, l’événement est salué par une explosion de joie ce 5 septembre 1638 : « Ce n’était rien que jeux, feux et lanternes / On couchait dans les tavernes […] On fit un si grand feu / Qu’on eut en grande peine / À sauver la Samaritaine / Et d’empêcher de brûler la Seine. »
Toujours chantant, le peuple prédit fièrement : « Lorsque ce Dieu-Donné / Aura pris sa croissance / Il sera couronné / Le plus grand roi de France. / L’Espagne, l’empereur et l’Italie, / Le Croate et le roi d’Hongrie / En mourront de peur et d’envie. » Le siècle de Louis XIV sera de fait une grande époque de notre histoire : outre les conquêtes, les arts et les lettres sont à leur apogée. Le Versailles du « Roi-Soleil » en est le plus éclatant symbole. La vie littéraire (La Fontaine, Boileau), musicale (Lully) et théâtrale (Molière, Racine), encouragée par le mécénat royal et influencée par les goûts personnels du souverain, engendre une série de chefs- d’œuvre. Le classicisme français renforce le prestige de la royauté, dans une Europe baroque, mais fascinée par ce rayonnement culturel.
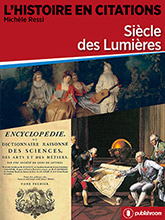 Siècle des Lumières
Siècle des Lumières
« Je suis bon citoyen parce que j’aime le gouvernement où je suis né […] parce que j’ai toujours été content de l’état où je suis […] mais dans quelque pays que je fusse né, je l’aurais été tout de même. »1002
MONTESQUIEU (1689-1755), Cahiers (posthume)
La philosophie du premier penseur des Lumières sera à l’image de l’homme et du citoyen, toute d’équilibre et de raison, en accord avec ce siècle où le bonheur est de règle - seul de la bande des quatre philosophes, Rousseau l’écorché vif fera exception.
« Voici le temps de l’aimable Régence,
Temps fortuné marqué par la licence. »1069VOLTAIRE (1694-1778), La Pucelle, chant XIII (posthume, 1859)
Le jeune libertin néglige ses études de droit et se fait une réputation de bel esprit dans les salons, au grand dam de son père. Il salue le nouveau régime en décasyllabes allègres : « Le bon Régent, de son Palais-Royal / Des voluptés donne à tous le signal… »
Le contexte historique s’y prête. L’arrivée de Philippe d’Orléans au pouvoir libère d’un coup les mœurs d’une société lasse du rigorisme imposé par Mme de Maintenon à la cour du (vieux) roi Louis XIV, laquelle donnait le ton au pays. Le même phénomène se reproduira sous le Directoire (après la Révolution) et les Années folles (après les horreurs de la Grande Guerre).
Cependant, la fête concerne les classes privilégiées plus que le peuple. Et la licence a des limites. Voltaire l’apprendra à ses dépens deux ans après, mis au cachot pour excès d’insolence.
« Oh ! le bon temps que ce siècle de fer ! »1019
VOLTAIRE (1694-1778), Le Mondain (1736). Satires
Contre Fénelon et bientôt Rousseau, en cousin de l’heureux Montesquieu et du fou de vie qu’est Diderot, Voltaire dit et répète son bonheur de vivre à son époque : « Le paradis terrestre est où je suis. » Il s’exprime ici en épicurien et provocateur, saluant « le superflu, chose très nécessaire […] tant décrié par nos tristes frondeurs : / Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. »
« La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend misérable. »1035
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), Dialogues : Rousseau juge de Jean-Jacques (1772-1776)
Ce postulat fonde toute son œuvre politique, pédagogique, morale, religieuse, romanesque. On le trouve dès 1750 dans le Discours sur les sciences et les arts : « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Il récidive avec sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758) qui dit les dangers du théâtre en général et de Molière en particulier, « école de mauvaises mœurs ».
Rousseau en fait aussi un roman par lettres, « best-seller » du temps (plus de 70 éditions en quarante ans), hymne à la nature, la vertu et la passion : Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761).
« Que les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes, ou quand les philosophes seront rois ! »1058
DIDEROT (1713-1784), Encyclopédie, article « Philosophe »
Diderot cite l’empereur Antonin. Affichant son humanisme, il cite aussi (en latin) : « Je suis homme, et rien d’humain ne me paraît étranger. » Sa morale n’est plus individuelle, mais sociale : c’est la seule qui importe et qui contribue au bonheur de l’espèce, de « la grande famille humaine ». Plus précisément encore, il affirme : « Il n’y a qu’un devoir, c’est d’être heureux. Puisque ma pente naturelle, invincible, inaliénable est d’être heureux, c’est la source unique de mes vrais devoirs, et la seule base de toute bonne législation. »
Sa philosophie est devenue humaniste et très moderne par son anarchie même. Diderot pose des antinomies : cœur et raison, individu et société. Il renonce à les résoudre et à forger des certitudes : la dignité de l’homme est dans la recherche plus que dans la découverte de la vérité. Sans jamais oublier l’essentiel, le bonheur…
« Qu’un peuple est heureux, lorsqu’il n’y a rien de fait chez lui ! Les mauvaises et surtout les vieilles institutions sont un obstacle presque invincible aux bonnes. »1065
DIDEROT (1713-1784), Entretiens avec Catherine II
C’est déjà en germe la philosophie de la table rase. Il est vrai qu’en France, la lourdeur des institutions et l’enracinement des privilèges sont tels que toutes les réformes entreprises durant le siècle se heurtent à des murs et qu’une révolution devient inévitable.
« Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre. »1231
TALLEYRAND (1754-1838), à Guizot. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps (1858-1867), François Guizot
Charles Maurice de Talleyrand Périgord ne peut entrer dans l’armée, par suite d’un accident qui le fait boiteux (on parle aussi d’une infimité de naissance). Sans vocation, il se destine à la carrière ecclésiastique. Ses origines aristocratiques lui permettent d’obtenir l’abbaye de Saint-Rémi (diocèse de Reims) et en 1780, à 25 ans, il est agent général du clergé. Il sera évêque d’Autun en 1788, député aux États généraux en 1789. Exemple d’une exceptionnelle longévité politique, « le diable boiteux » servira et trahira tous les régimes, finissant ambassadeur à Londres sous la Monarchie de Juillet. Il s’efforcera toujours de cultiver le bien-vivre qui culmine au Congrès de Vienne (1814) avec son célèbre cuisinier Carême et ses festins européens.
Son témoignage est certes celui d’un vieil homme, nostalgique de sa « belle époque ». Mais sa vérité correspond à la réalité : en 1780, la civilisation française est au zénith. Ensuite, ce sera le trouble dans les esprits, des calamités agricoles, le pays à bout de souffle après sa participation à la guerre d’Indépendance américaine, enfin la course à l’abîme du régime et la Révolution… où le bonheur va prendre d’autres formes.
 Révolution
Révolution
« La famille est complète. »1323
Jean-Sylvain BAILLY (1736-1793), à la tribune de l’Assemblée nationale, 27 juin 1789. Histoire de la Révolution française (1823-1827), Adolphe Thiers, Félix Bodin
Doyen du tiers état et premier à prêter le serment du Jeu de paume, le président de l’Assemblée peut être satisfait : le roi a ordonné aux députés de la noblesse et du clergé de se joindre au tiers. L’Assemblée nationale mérite enfin son nom et devient une notion juridique : « Nous pourrons maintenant nous occuper sans relâche et sans distraction de la régénération du royaume et du bonheur public » conclut Bailly – premier maire de Paris en juillet 1789, il mourra guillotiné, ayant refusé de témoigner à charge au procès de Marie-Antoinette. En attendant…
Paris et Versailles illuminent – c’est dire l’espoir populaire à la mesure de l’événement. Tout le pays est désormais représenté par ces 1 196 députés. Les votes se feront par tête et non par ordre – noblesse et clergé, unis contre le tiers, l’emportaient presque toujours. Mais le système représentatif pèche encore par inégalité numérique : avec ses 598 députés, le tiers représente 24 millions de Français, et les deux autres ordres, un demi-million de nobles et de prêtres avec le même nombre de députés, 308 du clergé, 290 de la noblesse.
« L’histoire n’a trop souvent raconté les actions que de bêtes féroces parmi lesquelles on distingue de loin en loin des héros. Il nous est permis d’espérer que nous commençons l’histoire des hommes, celle de frères nés pour se rendre mutuellement heureux. »1324
MIRABEAU (1749-1791), Assemblée nationale, 27 juin 1789. Discours et opinions de Mirabeau, précédés d’une notice sur sa vie (1820)
L’Orateur du peuple fait de la fraternité l’invention majeure de la Révolution – priorité sera plus souvent donnée à la liberté et l’égalité. Il a conscience de vivre un moment historique avec un formidable optimisme – le bonheur est à l’ordre du jour.
« C’est une conjuration pour l’unité de la France. Ces fédérations de province regardent toutes vers le centre, toutes invoquent l’Assemblée nationale, se rattachent à elle, c’est-à-dire à l’unité. Toutes remercient Paris de son appel fraternel. »1370
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de la Révolution française (1847-1853)
L’historien de la Révolution voit en cette fête du 14 juillet 1790 le point culminant de l’époque, son génie même. La plupart des contemporains pensent de même. C’est le jour heureux de tous les espoirs… et le peuple chante la plus gaie des carmagnoles.
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Le peuple en ce jour sans cesse répète,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira.
Malgré les mutins tout réussira […]
Pierre et Margot chantent à la guinguette :
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira.
Réjouissons-nous le bon temps viendra. »1371LADRÉ (XVIIIe siècle), paroles, et BÉCOURT (XVIIIe siècle), musique, Le Carillon national, chanson. Chansons nationales et populaires de France (1846), Théophile Marion Dumersan
Le chant est associé à la Fête de la Fédération, anniversaire de la prise de la Bastille. Il est plus connu sous le nom de son heureux refrain : « Ah ! ça ira ». Ladré, chanteur des rues, en a écrit les paroles sur Le Carillon national, musique de contredanse signée Bécourt, violoniste de l’orchestre au théâtre des Beaujolais. Marie-Antoinette la jouait volontiers sur son clavecin.
Le texte, innocent à l’origine, reprend l’expression de Benjamin Franklin, résolument optimiste et répétant au plus fort de la guerre d’Indépendance en Amérique, à qui lui demande des nouvelles : « Ça ira, ça ira. » Le mot est connu, le personnage populaire et dans l’enthousiasme des préparatifs de la fête, le peuple chante : « Ça ira, ça ira. » Cet optimisme va radicalement changer de ton avec l’« Ami du peuple ».
« Il y a une année que cinq ou six cents têtes abattues vous auraient rendus libres et heureux. Aujourd’hui, il en faudrait abattre dix mille. Sous quelques mois peut-être en abattrez-vous cent mille, et vous ferez à merveille : car il n’y aura point de paix pour vous, si vous n’avez exterminé, jusqu’au dernier rejeton, les implacables ennemis de la patrie. »1380
MARAT (1743-1793), L’Ami du peuple, décembre 1790. Histoire politique et littéraire de la presse en France (1860), Eugène Hatin
Populaire auprès du petit peuple parisien, mais détesté de toute la classe politique, Marat joue au « prophète de malheur » dans le journal quotidien qu’il publie et qui est pour l’heure sa seule tribune.
Ici, c’est un véritable appel au meurtre, alors que la guillotine n’est pas encore entrée en scène et que la Terreur est une notion inconnue ! Mais dès le début de l’année 1791, le populaire « ça ira » change de ton.
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates on les pendra. »1381Ah ! ça ira, couplet anonyme, sur une musique de BÉCOURT (XVIIIe siècle), chanson
Le plus célèbre « refrain de la Révolution française », né bon enfant, se durcit et se radicalise, quand une main anonyme ajoute ce couplet vengeur. Toujours sur le même air de contredanse populaire du Carillon national.
Prise au pied de la lettre, cette récupération chansonnière fait frémir, quand on sait la suite de l’Histoire.
« La bourgeoisie et le peuple réunis ont fait la Révolution. Leur réunion seule peut la conserver. Leur intérêt est indivisible, leur bonheur est commun. »1394
Jérôme PÉTION de VILLENEUVE (1756-1794). Encyclopédie nouvelle, ou dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel (1841), P. Leroux, J. Reynaud
Après la fuite à Varennes et l’évasion manquée des 20 et 21 juin 1791 de la famille royale, Bailly le maire de Paris veut contenir l’agitation républicaine qui vise à obtenir la déchéance du roi et, à la demande de l’Assemblée, il proclame la loi martiale. Le 17 juillet, la Garde nationale tire sur les pétitionnaires au Champ-de-Mars. La popularité de Baillly tombe au plus bas. Le 12 novembre, il démissionne de toutes ses fonctions politiques.
Pétion, avocat, député à la Constituante et membre du club des Jacobins, succède à Bailly à la suite du massacre du Champ de Mars comme maire de la Commune – gouvernement révolutionnaire de Paris qui s’est installé à l’Hôtel de Ville après la prise de la Bastille. Malgré la mise en garde de Pétion et sa très juste analyse de la situation, la scission entre la bourgeoisie et le peuple fut consommée sur le Champ de Mars, le 17 juillet 1791.
« Que la nation reprenne son heureux caractère. »1400
LOUIS XVI (1754-1793), à la Constituante, 30 septembre 1791. Histoire politique de la Révolution française (1913), François-Alphonse Aulard
Tel est le vœu royal et sans doute sincère, en cette dernière séance de l’Assemblée. Le roi présent est acclamé. Mais qui peut vraiment croire à ce mot et au bonheur qui lui tient malgré tout à cœur jusqu’à la fin de sa vie, dans une France plus que jamais révolutionnaire et désormais divisée ?
« Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. »1480
LOUIS XVI (1754-1793), au bourreau Sanson et à ses aides, 21 janvier 1793. « Second mot de la fin » du roi. Histoire de France depuis les temps les plus reculés (1867), Antonin Roche
Autre mot de la fin attribué au roi, toujours dans le même esprit : « Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Et encore : « Dieu veuille que ce sang ne retombe pas sur la France. » Cela relève de la « belle mort », comme pour alimenter la légende. Reste un fait avéré. Louis XVI, tout au long de sa vie, eut une obsession louable et rare chez un roi : ne pas faire couler le sang des Français.
« J’ons plus de roi dans la France […]
À présent tout ira bien
À Paris comme à la guerre.
Je n’craindrons plus le venin
Qui gâtait toute c’t’affaire,
J’aurons vraiment la liberté
En soutenant l’égalité ! »1485Citoyenne Veuve FERRAND (fin du XVIIIe siècle), Joie du peuple républicain (début 1793), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Chaque événement historique est ponctué de paroles et musique à l’époque. Mais cette Joie du peuple républicain est assurément une « chanson de circonstance » : tout ira bien après la mort du roi.
Au-delà de cette joie, le choc est immense et la Révolution prend un tour tragique. Le bonheur reste pourtant d’actualité !
« La plus grande joie du Père Duchesne après avoir vu de ses propres yeux la tête du Veto femelle séparée de son col de grue et sa grande colère contre les deux avocats du diable qui ont osé plaider la cause de cette guenon. »1543
Jacques HÉBERT (1757-1794), Le Père Duchesne, n° 299, titre du journal au lendemain du 16 octobre 1793. Les Derniers Jours de Marie-Antoinette (1933), Frantz Funck-Brentano
Voici l’oraison funèbre consacrée par le pamphlétaire jacobin à la reine sacrifiée. Le titre est un peu long. La chronique qui suit, ce n’est pas du Bossuet, mais la littérature révolutionnaire déploie volontiers cette démagogie populaire : « J’aurais désiré, f…! que tous les brigands couronnés eussent vu à travers la chatière l’interrogatoire et le jugement de la tigresse d’Autriche. Quelle leçon pour eux, f…! Comme ils auraient frémi en contemplant deux ou trois cent mille sans-culottes environnant le Palais et attendant en silence le moment où l’arrêt fatal allait être prononcé ! Comme ils auraient été petits ces prétendus souverains devant la majesté du peuple ! Non, f…! jamais on ne vit un spectacle pareil. Tendres mères dont les enfants sont morts pour la République ; vous, épouses chéries des braves bougres qui combattent en ce moment sur les frontières, vous avez un moment étouffé vos soupirs et suspendu vos larmes, quand vous avez vu paraître devant ses juges la garce infâme qui a causé tous vos chagrins ; et vous, vieillards, qui avez langui sous le despotisme, vous avez rajeuni de vingt ans en assistant à cette terrible scène : « Nous avons assez vécu, vous disiez-vous, puisque nous avons vu le dernier jour de nos tyrans. » »
« Le bonheur est une idée neuve en Europe. »1578
SAINT-JUST (1767-1794), Convention, Rapport du 3 mars 1794 (second décret de ventôse, le 13). Saint-Just et la force des choses (1954), Albert Ollivier
Devenu très jeune président de la Convention en février, il tente de donner au pouvoir révolutionnaire une base économique et sociale par deux décrets de ventôse : sur la confiscation des biens des émigrés (26 février) et sur leur redistribution aux patriotes indigents (3 mars) : « Que l’Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français ; que cet exemple fructifie sur la terre ; qu’il y propage l’amour des vertus et le bonheur ! »
« Le bonheur est une idée neuve en Europe » : cette citation restée célèbre a une portée générale et quasi institutionnelle. Le « bonheur de tous » est inscrit comme un but dans la Déclaration des droits de 1789. La Déclaration d’Indépendance des États-Unis de 1776, encore plus explicite, fait de la recherche du bonheur un droit inaliénable des hommes, au même titre que la vie et la liberté.
Reste un double paradoxe : datée de cette période tragique de la Terreur, la notion de bonheur est associée au personnage de Saint-Just qui n’en est pas le vivant symbole ! Pas plus que Robespierre qui instaure la Fête de l’Être suprême, couronnement spirituel de la démocratie fixé au 8 juin.
« Ayez des fêtes générales et plus solennelles pour toute la République ; ayez des fêtes particulières et pour chaque lieu qui soient des jours de repos […] Que toutes tendent à réveiller les sentiments généreux qui font le charme et l’ornement de la vie humaine, l’enthousiasme de la liberté, l’amour de la patrie, le respect des lois. »1593
ROBESPIERRE (1758-1794). Robespierre, écrits (1989), Claude Mazauric
Fête du 20 prairial an II, spectacle grandiose mis en scène par le peintre David. Bouquet d’épis, de fruits et de fleurs à la main, Robespierre marche en tête du cortège, des Tuileries au Champ de Mars, devant une foule estimée à 400 000 personnes (pour 600 000 Parisiens). Chiffre sans doute exagéré, mais tableaux et gravures témoignent de cette énorme masse humaine, comparable, quatre ans plus tôt, au rassemblement national à la Fête de la Fédération.
Comme à la Fédération, il y a quelques ricanements et quelques mots contre le tyran du jour, mais on sent surtout beaucoup d’émotion, d’admiration et d’espoir.
Robespierre est le premier à croire à cette utopie. Il est déiste à la manière de Rousseau et non athée (comme Fouché, Hébert ou Danton). Le culte de l’Être suprême, influencé par la pensée des philosophes du siècle des Lumières, est une « religion » qui se traduit par une série de fêtes civiques : le but est de réunir périodiquement les citoyens et de « refonder » spirituellement la Cité, mais surtout de promouvoir des valeurs sociales, abstraites et majuscules, comme l’Amitié, la Fraternité, le Genre humain, l’Enfance, la Jeunesse ou le Bonheur.
« Les Conventionnels […] faisaient couper le cou à leurs voisins avec une extrême sensibilité, pour le plus grand bonheur de l’espèce humaine. »1573
François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
Sous l’humour du plus grand mémorialiste de notre littérature, il existe une part de vérité propre à l’époque. Le vicomte, jeune témoin des événements, prit ses distances avec la Révolution : « La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique et je reculai. »
La tête « au bout d’une pique » est un classique de l’horreur révolutionnaire. La « première tête » peut être celle du gouverneur de la Bastille, de Launay, massacré par le peuple le 14 juillet, lors de la prise du fort. Chateaubriand, 21 ans, réformé de l’armée, hésitant sur sa vocation, s’est essayé à la vie politique en participant aux États de Bretagne (assemblée provinciale). Présent à Paris au début de la Révolution, il est très choqué par cette violence « cannibale ».
Représentatif de sa classe, il écrit aussi : « Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste. »
« Il faut raccourcir les géants
Et rendre les petits plus grands,
Tout à la même hauteur
Voilà le vrai bonheur. »1597Portrait du sans-culotte, chanson anonyme. Les Sans-culottes parisiens en l’an II (1968), Albert Soboul
C’est l’homme nouveau, vu par la sans-culotterie. C’est aussi le règne de l’égalité prise au pied de la lettre ! Et la négation du grand homme, du héros en tant qu’individu, au bénéfice du héros collectif, le peuple, incarné par le sans-culotte. Et toujours l’histoire de France, contée par les chansons.
« Un heureux événement a tout à coup ouvert une carrière immense aux espérances du genre humain ; un seul instant a mis un siècle de distance entre l’homme du jour et celui du lendemain. »1622
Marquis de CONDORCET (1743-1794), Œuvres complètes (posthume, 1804)
Parole de physiocrate, philosophe et mathématicien, autant que témoignage du député à la Législative et à la Convention. C’est la vision optimiste de la Révolution : l’homme nouveau naît de l’élan révolutionnaire, le peuple en est changé, « régénéré », la « régénération » allant de pair avec la Révolution et excluant tout retour en arrière.
Condorcet croit au développement indéfini des sciences, comme au progrès intellectuel et moral de l’humanité. Girondin, arrêté sous la Terreur, il s’est empoisonné pour ne pas monter à l’échafaud.
Directoire
« Notre Montagne enfante un Directoire
Applaudissons à son dernier succès !
Car sous ce nom inconnu dans l’histoire
Cinq rois nouveaux gouvernent les Français […]
En adoptant un luxe ridicule
Ils font gémir la sainte Égalité ;
À leur aspect la Liberté recule
Et dans leur cœur plus de Fraternité ! »1641Le Directoire (1795), chanson. Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires (1821), À la Librairie historique éd
La France vit une transition entre la Révolution et l’Empire. Phénomène récurrent : après le Moyen Âge vint la Renaissance où « le monde rit au monde » (Marot) ; après Louis XIV et une fin de règne très sombre, le temps de l’aimable Régence rimait bien avec licence ; après les horreurs de la Première Guerre mondiale, les Années folles se déchaîneront. Et en 1795, au lendemain de la Terreur, la jouissance est à l’ordre du jour pour la bonne société.
Le Directoire, en tant que nouveau régime né de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), présente deux inventions, une mauvaise et une bonne. Les « cinq rois » qui gouvernent, appelés Directeurs, ne vont cesser de se disputer, ce qui fragilise ou paralyse le pouvoir exécutif. Mais le bicamérisme cher à Montesquieu, avec le pouvoir législatif confié à deux Chambres sur le modèle anglais, instaure une formule toujours reprise (à l’exception de la brève Deuxième République) : la Chambre basse (élue au suffrage direct, par le peuple) est tempérée par la Chambre haute (élue au suffrage indirect, représentant les régions et les départements). En 1795, on aura le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens – sous la Cinquième République, la Chambre des députés et le Sénat.
« La goinfrerie est la base fondamentale de la société actuelle. »1642
Louis-Sébastien MERCIER (1740-1814), Nouveau Paris (1799-1800)
Auteur dramatique connu avant la Révolution, il juge ainsi la bonne société du Directoire. Selon un policier, « le débordement des mœurs dépasse toute idée ».
La danse fait fureur : 645 bals à Paris, dont le bal des Zéphirs au cimetière Saint-Sulpice et le bal des Victimes, réservés aux parents d’un guillotiné. C’est le temps des « Muscadins » (le mot désignait sous la Révolution les jeunes royalistes lyonnais usant de riches parfums au musc). Sur les boulevards parisiens, on voit se pavaner les « Merveilleuses » (élégantes aux perruques de toutes les couleurs) et les « Incroyables » (excentriques à l’extrême). Ils s’étourdissent dans des fêtes coûteuses. C’est une réaction normale, après les années d’austérité et de terreur, mais ce beau monde est frelaté et le reste du pays souffre.
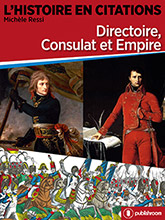 Empire
Empire
« Pour la gloire comme pour le bonheur de la République, il [le Sénat] proclame à l’instant même Napoléon empereur des Français. »1791
CAMBACÉRÈS (1753-1824), président du Sénat et du Conseil d’État, Déclaration du 18 mai 1804. Vie de Cambacérès, ex-archichancelier (1824), Antoine Aubriet, Tourneux
Une semaine avant, le Sénat (nom hérité du Consulat, précédent régime) a voté – à l’unanimité moins trois voix et deux abstentions – le projet de proclamation de l’Empire.
« Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République […] de respecter et de faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile […] de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »1797
NAPOLÉON Ier (1769-1821), cathédrale Notre-Dame de Paris, le jour de son sacre par Pie VII, 2 décembre 1804. Le Moniteur, phrase du journal officiel de l’époque, reprise dans toutes les bonnes biographies de l’empereur
La cérémonie dure cinq heures, entre la marche guerrière et le Te Deum, un premier serment religieux de Napoléon, la messe, l’Alléluia, les oraisons, les cris de « Vive l’empereur » et ce nouveau serment, sur les Évangiles. C’est l’instant le plus heureux des relations entre le pape et l’empereur.
La suite tournera au drame. L’histoire a voulu que se croisent ces deux hommes qui ont la même volonté de fer.
Napoléon a déjà imposé sa volonté durant le sacre, il a pris la couronne présentée, l’a posée lui-même sur sa tête, avant de couronner son épouse Joséphine. C’est sans doute à cet instant qu’il s’est adressé à son frère aîné, pour la seule « improvisation » (authentique) de cette spectaculaire cérémonie : « Joseph, si notre père nous voyait ! »
« On couronn’ Napoléon
Empereur de ce bel Empire.
Ça nous promet pour l’av’nir
Ben du bonheur et du plaisir. »1800Le Sacre de Napoléon, chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
On chante à la gloire du grand homme au front si couvert de lauriers que c’est à peine si on peut trouver « un petit coin pour y placer la couronne » ! Une certaine ironie commence à poindre…
Toutes ces « vieilles chansons françaises », la plupart anonymes, sont encore chantées, diffusées sur Internet, ce qui montre leur qualité, leur originalité, mais aussi le goût des Français pour l’histoire.
Deuxième République
« Vive la République ! Quel rêve ! […] On est fou, on est ivre, on est heureux de s’être endormi dans la fange et de se réveiller dans les cieux. »2150
George SAND (1804-1876), Lettre au poète ouvrier Charles Poncy, 9 mars 1848, Correspondance (posthume)
La bonne Dame de Nohant, très populaire par ses romans humanitaires et rustiques, se précipite à Paris et s’enthousiasme comme la plupart de ses confrères pour la République. Elle fonde La Cause du Peuple (hebdomadaire dont Sartre fera revivre le nom et qui deviendra Libération), elle ne pense plus qu’à la politique, le proclame et s’affiche aux côtés de Barbès (émeutier révolutionnaire libéré de prison grâce à la récente révolution), Louis Blanc et Ledru-Rollin (membres du gouvernement provisoire).
« Tout Français est électeur,
Quel bonheur ! moi, tailleur,
Toi, doreur, lui, paveur,
Nous v’là z’au rang d’homme […]
Faut savoir c’qu’on nomme.
Sachons bien, sachons bien
Élire un homme de bien,
Craignons bien, craignons bien
D’prendre un propre à rien. »2157Eugène POTTIER (1816-1888), Le Vote universel (1848), chanson. Chansons nationales et populaires de France (1866), Théophile Marion Dumersan, Noël Ségur
On reconnaît déjà la « fibre politique » de l’auteur rendu célèbre par L’Internationale.
Le peuple chante le rétablissement du suffrage universel, le 5 mars 1848. C’est la fin des abus du régime censitaire, d’où le bonheur populaire. Mais c’est aussi le début d’une course aux suffrages qui va paradoxalement défavoriser la gauche. Le principe définitivement acquis n’en reste pas moins très populaire. Sur les 9 millions d’électeurs, il y aura 86 % de votants – les femmes sont « naturellement » exclues de la vie publique. Leur droit de vote ne sera acquis que le 21 avril 1944.
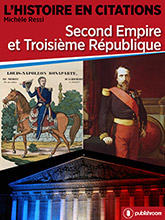 Troisième République
Troisième République
« Partout la joie est générale
Depuis qu’en vertu d’un décret
Notre fête nationale
Doit avoir lieu l’quatorze juillet ! »2463Aristide BRUANT (1851-1925), J’suis d’l’avis du gouvernement (1879), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Un couplet de la chanson de Bruant célèbre l’événement et chante le consensus du pays : « Quand je vois pour fêter la France / Choisir la date d’un événement / Qui lui rappelle sa délivrance / J’suis d’l’avis du gouvernement. »
La Marseillaise est proclamée hymne national en même temps que le 14 juillet devient fête nationale – mais l’on discute aujourd’hui encore pour savoir si l’on célèbre 1789 ou 1790, la prise de la Bastille ou la Fête de la Fédération.
La loi est promulguée le 6 juillet 1880. C’est le premier vote des Chambres revenues de Versailles à Paris. Huit ans après la Commune, Paris redevient capitale de la France.
« Gais et contents
Nous marchions triomphants
En allant à Longchamp
Le cœur à l’aise,
Sans hésiter,
Car nous allions fêter,
Voir et complimenter
L’armée française. »2482Lucien DELORMEL (1847-1899) et Léon GARNIER (1857-1905), paroles, et Louis-César DÉSORMES (1840-1898), musique, En r’venant d’la r’vue (1886), chanson
Cent ans de chanson française, 1880-1980 (1996), Chantal Brunschwig, Louis-Jean Calvet, Jean-Claude Klein.
Le nouveau couple d’auteur-compositeur à la mode écrit pour Paulus cette chanson créée le 14 juillet 1886 à l’Alcazar, l’un des grands music-halls parisiens. « Marseillaise des mitrons et des calicots » dit Anatole France, mais surtout « hymne boulangiste » et immense succès cocardier pour le « brave général » acclamé à Longchamp, barbe blonde et fière allure, rendant encore plus terne et vieillot le cortège du président de la République octogénaire, Jules Grévy, usé politiquement.
Paul Déroulède, propagandiste numéro un de Boulanger, lui invente le surnom de « général Revanche » et affirme qu’il est « le seul ministre qui fasse peur à l’Allemagne » … qui nous a pris l’Alsace et la Lorraine. La droite va exploiter Boulanger qui se prétend pourtant général d’« extrême gauche ». Le boulangisme, aux origines du populisme, sera la réunion de tous les contraires et le lieu de bien des paradoxes. Quant à Boulanger, il finira dans le ridicule, condamné à mort par contumace, exilé en Belgique et suicidé sur la tombe de sa maîtresse : « Il est mort comme il a vécu : en sous-lieutenant » dira l’impitoyable Clemenceau… qui avait cru en lui au départ.
« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre !
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ! »2588Charles PÉGUY (1873-1914), Ève (1914)
Deux derniers alexandrins d’un poème qui en compte quelque 8 000. Le poète appelle de tous ses vœux et de tous ses vers la « génération de la revanche ». Lieutenant, il tombe à la tête d’une compagnie d’infanterie, frappé d’une balle au front, à Villeroy, le 5 septembre, veille de la bataille de la Marne, aux premiers jours de la Grande Guerre de 1914-1918.
Rejeté de tous les groupes constitués parce que patriote et dreyfusard, socialiste et chrétien, suspect à l’Église comme au parti socialiste, isolé par son intransigeance et ignoré jusqu’à sa mort du grand public, c’est l’un des rares intellectuels de l’époque échappant aux étiquettes. Voyant d’abord pour seul « remède au mal universel l’établissement de la République socialiste universelle », il créa ses Cahiers de la Quinzaine pour y traiter tous les problèmes du temps, y publier ses œuvres et celles d’amis (Romain Rolland, Julien Benda, André Suarès et même Jean Jaurès).
« Il y eut quelque chose d’effréné, une fièvre de dépense, de jouissance et d’entreprise, une intolérance de toute règle, un besoin de nouveauté allant jusqu’à l’aberration, un besoin de liberté allant jusqu’à la dépravation. »2631
Léon BLUM (1872-1950), À l’échelle humaine (1945)
Entre-deux-guerres (1918-1939). Socialiste témoin de son temps, il évoque le bouleversement moral qui suit la Première Guerre mondiale durant dix ans. C’est le début des « Années folles ». Le jazz entre en scène. Le tango chavire les corps. Le charleston fait rage. Les dancings font fortune. Les artistes se doivent d’être anarchistes, dadaïstes, bientôt surréalistes. Les femmes ont l’air de garçons. « C’est bien parce que c’est mal ; c’est mal parce que c’est bien. »
« Tout va très bien, Madame la marquise. »
« Y’a d’la joie ! »2675Ray VENTURA (1908-1979) et Charles TRENET (1913-2001), titres et refrains des deux succès de l’année 1936, chansons
Ray Ventura et ses Collégiens (aidé de ses paroliers, Paul Misraki, Bach et Henri Laverne) promoteur de l’orchestre à sketchs en France, et sur un tout autre registre Charles Trenet le « fou chantant », auteur-compositeur-interprète parti pour une très longue carrière, tentent de faire oublier aux Français « la montée des périls ».
Trois dictateurs, trois fascismes sont à nos frontières : Hitler, Mussolini, bientôt Franco. Et le Japon d’Hiro-Hito, qui mène une politique impérialiste et expansionniste, s’allie à l’Allemagne et à l’Italie.
Cependant que la France va vivre quelques mois sous le signe du Front populaire : un mouvement qui fait se lever un immense espoir.
« Il est revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie. »2681
Léon BLUM (1872-1950), constat du chef du gouvernement, 31 décembre 1936. Histoire de la France : les temps nouveaux, de 1852 à nos jours (1971), Georges Duby
« … La France a une autre mine et un autre air. Le sang coule plus vite dans un corps rajeuni. Tout fait sentir qu’en France, la condition humaine s’est relevée. »
Georges Duby confirme, dans son Histoire de la France : « Le Front populaire, ce n’est pas seulement un catalogue de lois ou une coalition parlementaire. C’est avant tout l’intrusion des masses dans la vie politique et l’éclosion chez elle d’une immense espérance […] Il y a une exaltation de 1936 faite de foi dans l’homme, de croyance au progrès, de retour à la nature, de fraternité et qu’on retrouve aussi bien dans les films de Renoir que dans ce roman de Malraux qui relate son aventure espagnole et s’appelle justement L’Espoir. »
« Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence, d’oser enfin se redresser. Se tenir debout. Prendre la parole à son tour. Se sentir des hommes pendant quelques jours… Cette grève est en elle-même une joie. »2678
Simone WEIL (1909-1943), La Révolution prolétarienne, 10 juin 1936. Histoire de la Troisième République, volume VI (1963), Jacques Chastenet
Agrégée de philosophie, ouvrière chez Renault un an avant pour être au contact du réel, elle écrit son article sous le pseudonyme de Simone Galois.
Passionnée de justice, mystique d’inspiration chrétienne quoique née juive, toujours contre la force et du côté des faibles, des vaincus et des opprimés, la jeune femme vibre à cette aventure et – comme elle le fera jusqu’à sa mort, à 34 ans – participe pleinement : « Joie de vivre parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine. Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours. Mais on n’y pense pas, on est comme des soldats en permission pendant la guerre. Joie de pénétrer dans l’usine avec l’autorisation souriante d’un ouvrier. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d’accueil fraternel. Joie de parcourir ces ateliers où on était rivé sur sa machine. »
« Vous comprenez, c’est comme s’ils [les ouvriers] avaient été au tombeau jusqu’à aujourd’hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et ils voient enfin la lumière. »2679
Témoignage d’un dirigeant de la CGT. Histoire de la France : les temps nouveaux, de 1852 à nos jours (1971), Georges Duby
D’innombrables témoignages concordent sur ces « grèves de la joie » : mai 36, comme Mai 68, c’est une fête. En juin, plus de 12 000 grèves toucheront près de 2 millions d’ouvriers – le secteur public ne sera pas concerné.
« Les nations ont le sort qu’elles se font. Rien d’heureux ne leur vient du hasard. Ceux qui les servent sont ceux qui développent leur force profonde. »2628
Édouard HERRIOT (1872-1957), Jadis, tome II, D’une guerre à l’autre, 1914-1936 (1952)
Parole d’un radical, célèbre maire de Lyon (1905 à 1957), député (1919 à 1940), plusieurs fois ministre et président du Conseil dans l’entre-deux-guerres.
Le choix des chefs, pour le meilleur mais aussi le pire, va déterminer le sort des États et le destin du monde jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et son issue. Président de la Chambre des députés, Herriot lancera en 1940 un appel à l’union autour du maréchal Pétain, avant de se séparer du gouvernement de Vichy et de se retrouver en résidence surveillée, puis déporté en Allemagne en 1944.
Seconde guerre mondiale
« Je n’ai pas à proclamer la République. Elle n’a jamais cessé d’exister. »2814
Charles de GAULLE (1890-1970), à Georges Bidault, Hôtel de Ville de Paris, 26 août 1944. Mémoires de guerre, tome II, L’Unité, 1942-1944 (1956), Charles de Gaulle
Libération de Paris. Bidault est président du CNR (Conseil national de la Résistance) depuis la mort de Jean Moulin et de Gaulle est venu à Paris pour y installer le GPRF (Gouvernement provisoire de la République française).
La foule en délire l’a acclamé, la veille : « Devant moi, les Champs-Élysées. Ah ! c’est la mer ! » écrira-t-il dans ses Mémoires, évoquant ce qui est sans doute le plus beau jour de sa vie. Et il dit son émotion, devant Paris : « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! »
« Vieille France, accablée d’Histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, allant et venant sans relâche, mais redressée, de siècle en siècle, par le génie du renouveau ! »2830
Charles de GAULLE (1890-1970), Mémoires de guerre, tome III, Le Salut, 1944-1946 (1959)
Grand premier rôle et grand témoin de cette période, il évoque et invoque cette France « Vieille Terre, rongée par les âges, rabotée de pluies et de tempêtes, épuisée de végétation, mais prête, indéfiniment, à produire ce qu’il faut pour que se succèdent les vivants ! »
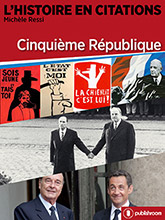 Cinquième République
Cinquième République
Prenez vos désirs pour des réalités.
Faites l’amour, pas la guerre.2952Slogans de Mai 68
Les sociologues ont commenté à l’infini ces mots qui restent dans la mémoire collective, bien au-delà de la génération spontanée qui les créa, entre barricades bon enfant, manifs en chaîne et grèves de la joie.
« Cas sans précédent de suicide en plein bonheur. »3087
François MAURIAC (1885-1970), à propos du référendum d’avril 1969. De Gaulle, volume III (1986), Jean Lacouture
Ayant triomphé tant bien que mal de Mai 68, alors que l’Assemblée lui assurait une fin de septennat sans histoire, le général a voulu un référendum annoncé en février sur deux sujets « ingrats » : réforme régionale et réforme du Sénat. C’est encore une question de confiance entre lui et le pays. Il met tout son poids politique dans la balance, menaçant de partir en cas de non. Tous les partis de gauche font naturellement campagne pour le non, Valéry Giscard d’Estaing aussi et Pompidou (son ex Premier ministre) appelle au oui, mais sans vraie conviction. Verdict du 27 avril : 48 % de oui et 52 % de non. Le lendemain, de Gaulle démissionne.
Il part en Irlande, pour ne pas être impliqué dans la campagne présidentielle – il votera par procuration. Il retourne ensuite à Colombey s’enfermer dans sa propriété de la Boisserie pour un dernier face à face avec l’histoire : la rédaction quelque peu désenchantée, quoique sereine, de ses Mémoires d’espoir.
« Il avait une très haute conception de la fonction présidentielle et l’assuma avec la plus grande conscience. Il était par-dessus tout soucieux de l’unité des Français et de leur bonheur […] Il veilla à ce que notre pays s’adaptât au nouvel état du monde et demeurât dans le peloton de tête des nations. Justice à cet égard lui sera rendue. »3092
Raymond BARRE (1924-2007), Questions de confiance. Entretiens avec Jean-Marie Colombani (1988)
Témoignage de son Premier ministre et parole de l’« un des meilleurs économistes de France », selon Giscard. À la décharge du président, Barre plaide la conjoncture défavorable, une crise qui met fin aux Trente glorieuses : « Il souffrait de ne pouvoir faire le bonheur des Français, alors que l’économie française était soumise à de grands bouleversements : disparition du système monétaire international, premier puis deuxième choc pétrolier. »
« Le 10 mai, les Français ont franchi la frontière qui sépare la nuit de la lumière. »3211
Jack LANG (né en 1939), ministre de la Culture, présentant son budget (en forte hausse) le 17 novembre 1981
Formule devenue célèbre et quelque peu moquée, signée d’un personnage toujours aussi lyrique que médiatique.
Dans le même esprit, le même élan, Pierre Mauroy, fervent Premier ministre de Mitterrand : « C’est une aube nouvelle qui se lève. Avec nous, la vérité voit le jour. » Et Chevènement, très sérieux ministre de la Recherche et de l’Industrie, fait chorus : « Si nous n’étions pas arrivés, la France était condamnée à disparaître en 1990. »
« Regarde : Quelque chose a changé.
L’air semble plus léger.
C’est indéfinissable.
Regarde : Sous ce ciel déchiré,
Tout s’est ensoleillé.
C’est indéfinissable.
Un homme, Une rose à la main,
A ouvert le chemin,
Vers un autre demain… »3209BARBARA (1930-1997), Regarde. Chanson dédiée à François Mitterrand et ovationnée en novembre 1981 à l’hippodrome de Pantin, emplacement actuel du Zénith de Paris
Beaucoup d’artistes (majoritairement de gauche) ont accompagné le président en campagne, puis au lendemain de sa victoire, mais les mots, la musique, la voix, l’émotion de Barbara étonnent toujours et résonnent encore (sur You Tube, Daily Motion) :
« Regarde : C’est fanfare et musique, / Tintamarre et magique, / Féerie féerique. / Regarde : Moins chagrins, moins voûtés, / Tous, ils semblent danser, / Leur vie recommencée. / Regarde : On pourrait encore y croire. / Il suffit de le vouloir, / Avant qu’il ne soit trop tard. / Regarde : On en a tellement rêvé, / Que sur les mur bétonnés, / Poussent des fleurs de papier […] / Regarde : On a envie de se parler, De s’aimer, de se toucher, / Et de tout recommencer. / Regarde : Plantée dans la grisaille, / Par-delà les murailles, / C’est la fête retrouvée. / Ce soir, Quelque chose a changé. / L’air semble plus léger. / C’est indéfinissable. / Regarde : Au ciel de notre histoire, / Une rose, à nos mémoires, / Dessine le mot espoir ! »
En mai 2012, la joie du peuple de gauche sera évidente avec l’élection de François Hollande, mais un tel délire heureux n’est plus de mise.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.