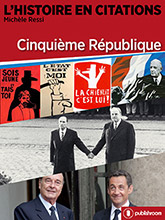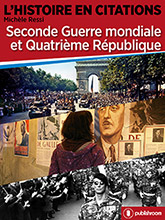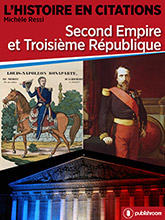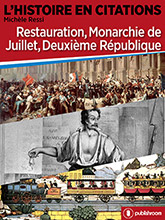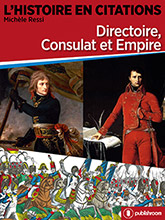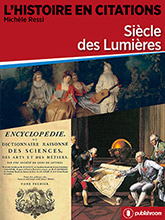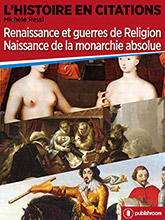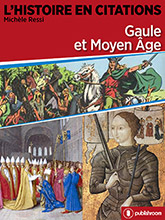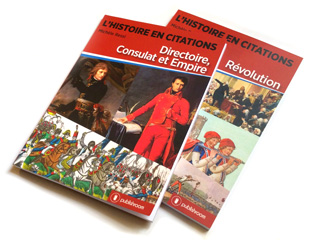Anonymat (du grec ἀνώνυμος / anṓnumos, « qui n’a pas reçu de nom, anonyme »), qualité de ce qui est sans nom (ou sans renommée).
« En France et sous nos rois, la chanson fut longtemps la seule opposition possible ; on définissait le gouvernement d’alors comme une monarchie absolue tempérée par des chansons. »815
FÉNELON (1651-1715), Dialogues des morts (1692-1696)
L’histoire de France par les chansons existe bel et bien. Souvent anonyme, la chanson fut l’une des rares formes d’opposition possible et de surcroît très populaire, sous l’Ancien Régime. À l’heure de la Révolution, c’est la voix du peuple qui s’exprime sur tous les tons, le joyeux « Ça ira » devenant un appel au meurtre des « aristocrates à la lanterne » sous la Terreur. Les réseaux sociaux n’ont rien inventé…
D’autres formes d’expression non signées existent. Les pamphlets sont souvent cruels, voire injurieux : quelque 6 500 mazarinades contre Mazarin Premier ministre haï, avant les poissonnades visant la Pompadour (maîtresse de Louis XV), née Jeanne Poisson. Les épigrammes raillent à plaisir et avec esprit, comme les épitaphes après la mort de leur victime. L’une des plus célèbres est quand même attribuée à Rousseau, écrite sur la tombe de Voltaire. Autres moyens d’opposition populaire : pancartes et affiches, cris du peuple associés aux manifestations, « basses Lumières » qui sapent les bases du régime aussi sûrement que les pensées philosophiques au XVIIIe siècle, cahiers de doléances à la veille de la Révolution… jusqu’aux slogans de Mai 68 encore et toujours cités. Tout fait Histoire !
Cas particuliers, des textes célèbres sont nés anonymes, à commencer par La Chanson de Roland au Moyen Âge. Le Discours de la méthode (1637) et les Lettres persanes (1721) n’ont été revendiqués par l’auteur qu’après publication et grand succès : Descartes et Montesquieu. On n’est jamais trop prudent, avec la censure royale.
Des auteurs se dissimulent sous l’anonymat d’un pseudonyme. Henri Beyle en avait une centaine, dont le plus connu, Stendhal signant Le Rouge et le noir (1830) et La Chartreuse de Parme (1839). Autres cas, les femmes écrivant sous un nom d’homme : George Sand ne se cache pas vraiment, contrairement aux quatre sœurs Brontë, dont Charlotte devenue Currer Bell pour signer un best-seller mondial, Jane Eyre (1847). Quelques cas extrêmes sont quasi-pathologiques – intéressants, mais anecdotiques.
À la fin du XXe siècle, l’anonymat total est de règle dans l’art urbain ou Street-art né aux États-Unis : acte de vandalisme ou expression contemporaine originale ? Banksy, star anonyme, s’expose au musée, se vend aux enchères. D’autres artistes restent masqués pour des raisons politiques ou personnelles. C’est un phénomène aussi ancien que l’expression humaine. Faut-il contrôler ou censurer ? C’est un vrai problème de société. Quelques-uns s’en amusent : « La célébrité n’est pas facile à assumer, je ne vois rien de pire, si peut-être, l’anonymat. » Guy Bedos.
Reste le problème de l’anonymat dans les réseaux sociaux. « Nouveaux réseaux, vieux débat. L’ordre contre la liberté ? Le piège est là. » À vous de juger.
 RÉVOLUTION
RÉVOLUTION
« De la première page à la dernière, elle [la Révolution] n’a qu’un héros : le peuple. »1273
Jules MICHELET (1798-1874), Le Peuple (1846)
Fils d’un imprimeur ruiné par le régime de la presse sous le Consulat et l’Empire, Michelet connaît la misère dans sa jeunesse et en garde un profond amour du peuple. Écrivain engagé dans les luttes de son temps riche en révolutions d’un autre style, manifestant contre la misère des ouvriers, il composera dans l’enthousiasme son Histoire de la Révolution française : dix ans et sept volumes pour une œuvre inspirée, remarquablement documentée. Les plus belles pages de son œuvre maintes fois rééditée, ici mentionnée sous le terme générique d’« Histoire de France ».
Le peuple en révolution s’exprime par les chansons souvent anonymes, comme la jeunesse en révolte lors des évènements de Mai 68.
« Le bourgeois et le marchand
Marchent à la Bastille
Et ran plan plan […]
Sortez de vos cachots funèbres
Victimes d’un joug détesté
Voyez à travers les ténèbres
Les rayons de la Liberté ! »1330La Prise de la Bastille (1790), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Chanson vaudeville, genre en vogue à la fin du XVIIIe siècle. L’événement se joue en deux actes : « Départ pour le siège », puis « Délivrance des captifs ». Le style est typique de l’époque. Les « victimes d’un joug détesté », ce sont les prisonniers libérés. L’inventaire est dérisoire. Ils sont sept : quatre escrocs ayant falsifié une lettre de change, deux malades mentaux et un jeune gentilhomme prodigue, le comte de Solanges, embastillé pour inceste. À quelques jours près, on trouvait le marquis de Sade – transféré à Charenton.
« Ennemis de la France,
Votre règne est passé ;
Le temps de la vengeance
Est enfin arrivé.
À de Launay, Flesselles,
À Berthier et Foullon,
On met une ficelle
Au-dessous du menton. »1338La Prise de la Bastille, refrain (1790), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La chanson qui se veut plus que jamais chronique de l’événement fait ici allusion à deux faits précis. D’abord la prise du fort le 14 juillet 1789, avec le massacre de son gouverneur, de Launay, et de Flesselles, prévôt des marchands de Paris, qui s’opposèrent aux émeutiers.
Ensuite, le 22 juillet, l’assassinat de Foullon, intendant des Finances (en remplacement de Necker), condamné par l’Assemblée des électeurs de l’Hôtel de Ville comme affameur du peuple et pendu, avec son gendre Berthier de Sauvigny, chargé de l’approvisionnement et accusé de spéculation sur les grains.
« Aristocrate, te voilà donc tondu,
Le Champ de Mars te fout la pelle au cul,
Aristocrate, te voilà confondu.
J’bais’rons vos femmes, et vous serez cocus,
Aristocrates, je vous vois tous cornus. »1373Le Tombeau des aristocrates (anonyme), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Chanté le 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars (avec « La Pelle au cul », version très voisine), le jour même de cette fête de la réconciliation nationale. C’est un tout autre ton que le « ça ira » – lequel va bientôt connaître nombre de parodies fort dures pour les aristos.
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates on les pendra. »1381Ah ! ça ira, couplet anonyme, sur une musique de BÉCOURT (XVIIIe siècle), chanson
Le plus célèbre « refrain de la Révolution française » est né bon enfant en 1790 : « Ah ! ça ira, ça ira, ça ira / Le peuple en ce jour sans cesse répète, / Ah ! ça ira, ça ira, ça ira./ Malgré les mutins tout réussira […] / Pierre et Margot chantent à la guinguette : / Ah ! ça ira, ça ira, ça ira. / Réjouissons-nous le bon temps viendra. »
Le chant est plus connu sous le nom de son refrain : « Ah ! ça ira ». Ladré, chanteur des rues, en a écrit les paroles sur Le Carillon national, musique de contredanse signée Bécourt, violoniste de l’orchestre au théâtre des Beaujolais. La reine Marie-Antoinette la jouait volontiers sur son clavecin.
Le texte, innocent à l’origine, reprend l’expression de Benjamin Franklin, résolument optimiste et répétant au plus fort de la guerre d’Indépendance en Amérique, à qui lui demande des nouvelles : « Ça ira, ça ira. » Le mot est connu, le personnage populaire et dans l’enthousiasme des préparatifs de la fête de la Fédération, le peuple chante : « Ça ira, ça ira. »
Mais le refrain se durcit et se radicalise, quand une main anonyme ajoute ce couplet vengeur. Toujours sur le même air de contredanse populaire du Carillon national. Cette version est désormais la plus célèbre.
« Couple perfide, réservez vos larmes
Pour arroser le prix de vos forfaits […]
Un peuple libre reconnaît les charmes
De n’être plus au rang de vos sujets. »1389Poursuite et retour de la famille ci-devant royale (juin 1791), chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Le peuple chante encore, mais il a perdu confiance en Louis XVI. Comme l’écrit Denis Richet dans le Dictionnaire critique de la Révolution française : « Un roi avait en fuyant abandonné sa souveraineté. Un autre roi, le peuple, assistait gravement au spectacle. »
« Que demande un Républicain ?
La liberté du genre humain,
Le pic dans les cachots,
La torche dans les châteaux
Et la paix aux chaumières ! »1430La Carmagnole (automne 1792), chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Cette nouvelle version de la Carmagnole résume la situation. Le « pic dans les cachots » va entraîner un nouveau massacre révolutionnaire, plus spectaculaire que les précédents. Ministre de la Justice et responsable des prisons, Danton, qui pouvait tout, ne va rien faire pour l’empêcher.
« Ô mon peuple,
Que vous ai-je donc fait ?
J’aimais la vertu, la justice.
Votre bonheur fut mon unique objet,
Et vous me traînez au supplice ! »1477Complainte de Louis XVI aux Français, quand le verdict fatal est connu à la fin du procès, chanson anonyme. Prières pour le roi, la France, etc. précédées du Testament de Louis XVI et de quelques notes historiques (1816)
« Glapie dans les guinguettes par des chanteurs à gages », sur l’air d’une romance célèbre composée par la marquise de Travanet et par Marie-Antoinette, cette complainte a tant de succès qu’elle éclipse un temps La Marseillaise.
« En toutes les provinces,
Vous entendrez parler
Qu’il y a un nouveau prince
Qu’on dit dans la Vendée,
Qui s’appelle Charette,
Vive son cœur !
Chantons à pleine tête
Gloire et honneur. »1488Chanson de l’armée de Charette (1793), anonyme. Orphée phrygien : les musiques de la Révolution (1989), Jean-Rémy Julien, Jean-Claude Klein
La guerre de Vendée fait naître d’innombrables chansons. C’est la plus authentique, sinon la seule. Elle reste populaire, chez les amateurs de chants royalistes, et jusque sur le site Internet YouTube.
« Il faut raccourcir les géants
Et rendre les petits plus grands,
Tout à la même hauteur
Voilà le vrai bonheur. »1597Portrait du sans-culotte, chanson anonyme. Les Sans-culottes parisiens en l’an II (1968), Albert Soboul
C’est l’homme nouveau, vu par la sans-culotterie. C’est le règne de l’égalité prise au pied de la lettre ! C’est aussi la négation du grand homme, du héros en tant qu’individu, au bénéfice du héros collectif, le peuple, incarné par le sans-culotte. Et c’est toujours l’histoire de France, contée par les chansons.
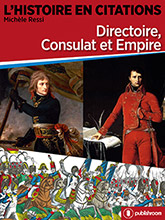 CONSULAT ET EMPIRE
CONSULAT ET EMPIRE
« J’aime l’oignon frit à l’huile,
J’aime l’oignon quand il est bon […]
Au pas camarade, au pas camarade,
Au pas, au pas, au pas [bis]
Et pas d’oignon aux Autrichiens,
Non ! pas d’oignon à tous ces chiens. »1705Chanson de l’oignon, 1800, anonyme et très populaire. Chants et chansons militaires de la France (1887), Eugène Hennebert
Scandée par les grenadiers montant à l’assaut, lors de la bataille de Marengo (14 juin 1800).
Masséna ayant capitulé à Gênes, Bonaparte a détourné ses divisions pour attaquer les Autrichiens à Marengo. Bataille indécise, qui serait perdue sans l’arrivée en renfort du général Desaix, retournant la situation, avant de tomber à la tête de ses hommes : « Allez dire au Premier Consul que je meurs avec le seul regret de n’avoir pas assez fait pour la postérité » dit-il au jeune Lebrun, son aide de camp. C’était un valeureux compagnon de route, Napoléon avait pu apprécier l’homme et le militaire, dans la campagne d’Égypte.
Après Marengo, les Autrichiens demandent un armistice. L’Italie, pour la seconde fois, est conquise par les Français. À Milan, capitale de la République cisalpine, on illumine. Paris accueille la nouvelle de cette victoire dans un délire d’enthousiasme. Il n’en fallait pas moins, pas plus, pour assurer la position de Bonaparte, Premier Consul.
« L’ogre corse sous qui nous sommes,
Cherchant toujours nouveaux exploits,
Mange par an deux cent mille hommes
Et va partout chiant des rois. »1765Pamphlet anonyme contre Napoléon. Encyclopædia Universalis, article « Premier Empire »
De nombreux pamphlets contribuent à diffuser la légende noire de l’Ogre de Corse, contre la légende dorée de la propagande impériale.
Les rois imposés par l’empereur sont nombreux, pris dans sa famille ou parmi ses généraux : rois de Naples, d’Espagne, de Suède, de Hollande, de Westphalie. Royautés parfois éphémères, souvent mal acceptées des populations libérées ou/et conquises.
Les historiens estimeront à un million les morts de la Grande Armée, « cette légendaire machine de guerre » commandée par Napoléon en personne.
« J’entendons ronfler l’canon,
Y g’na plus à s’en dédire :
On couronn’ Napoléon
Empereur de ce bel Empire.
Ça nous promet pour l’av’nir
Ben du bonheur et du plaisir. »1800Le Sacre de Napoléon, chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
On chante à la gloire du grand homme, au front si couvert de lauriers que c’est à peine si on peut trouver « un petit coin pour y placer la couronne » ! Une certaine ironie commence à poindre.
Toutes ces « vieilles chansons françaises », la plupart anonymes, sont encore chantées, diffusées sur Internet, ce qui montre, d’une certaine manière, leur qualité, leur originalité, mais aussi le goût des Français pour l’histoire.
« Je suis un pauvre conscrit
De l’an mille huit cent dix […]
Ils nous font tirer z’au sort
Pour nous conduire à la mort. »1850Le Départ du conscrit, vers 1810, chanson anonyme ayant plusieurs versions. L’Armée de Napoléon, 1800-1815 (2000), Alain Pigeard
La guerre d’Espagne se révèle désastreuse pour la Grande Armée, avant de devenir très coûteuse à l’économie du pays. Les coalitions qui se succèdent font quelque 200 000 morts par an. Il faut recruter : les conscrits partent sans enthousiasme, le nombre des réfractaires augmente, avec la complicité de la population paysanne.
« L’armée, c’est la nation » dans la doctrine impériale. Mais à partir de 1811, il faut intégrer des contingents étrangers et recourir massivement à la conscription (ou service militaire) : la Révolution française avait commencé avec la levée en masse des soldats de l’an II. Napoléon enchaîne.
L’historien Jules Michelet constate : « Qu’était la Grande Armée, sinon une France guerrière d’hommes qui, sans famille, ayant de plus perdu la République, cette patrie morale, promenait cette vie errante en Europe ? »
RESTAURATION ET MONARCHIE DE JUILLET
« Le matin, royaliste,
Je dis : « vive Louis ! »
Le soir, bonapartiste,
Pour l’Empereur j’écris,
Suivant la circonstance,
Toujours changeant d’avis,
Je mets en évidence
L’aigle ou la fleur de lys. »1894La Girouette (1814), chanson anonyme. Histoire secrète de Paris (1980), Georges Bordonove
Sous-titrée : « Couplet dédié à M. Benjamin Constant, ci-devant royaliste, puis conseiller d’État de Bonaparte, et en dernier résultat redevenu royaliste. »
Benjamin Constant n’est pas le seul à faire preuve d’opportunisme, en cette époque de changements de régime. Mais le personnage particulièrement intelligent, irrésolu, faible jusqu’à la lâcheté, romancier de sa propre vie, célèbre et brillant orateur, est particulièrement en vue. Sous la Restauration, il peut être rangé dans l’opposition de gauche, comme libéral et monarchiste parlementaire.
« La parole a été donnée à l’homme pour cacher sa pensée. »30
Henri BEYLE, dit STENDHAL (1783-1842), Le Rouge et le Noir (1830)
… Et le pseudonyme à l’auteur pour se dissimuler jusqu’à l’anonymat ! Il en utilise plus d’une centaine. « Tels de ces pseudonymes sont pour la parade, drôle, glorieuse ou tendre. Et d’autres sont des pseudonymes de fuite, pour se rendre invisible et se soustraire aux gêneurs. » (Jean Starobinski, L’Œil vivant, 1961, Stendhal Pseudonyme.)
Rien à voir avec le simple pseudonyme de Voltaire (né François-Marie Arouet et qui ne voulait pas gêner sa famille par ses propos libertins ou frondeurs), ni même George Sand (Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil devenue baronne Dudevant) qui prendra un nom d’homme pour semer le trouble quant à son identité… et augmenter ses chances d’être publiée dans un univers de l’édition résolument masculin.
Dans le cas de Stendhal, les pseudonymes servent à se cacher, mais aussi à se méfier du langage en tant que convention sociale ou désir d’être un autre.
« Je porterais un masque avec plaisir ; je changerais de nom avec délices (…) Mon souverain plaisir serait de me changer en un long Allemand blond, et de me promener ainsi dans Paris. »
Henri BEYLE, dit STENDHAL (1783-1842), Souvenirs d’égotisme, posthume, 1892
Jean Starobinski (1920-2019) consacre un chapitre aux pseudonymes de Stendhal dans L’Œil vivant : « Le désir de paraître et le désir de disparaître font partie en lui d’un même complexe. »
Pour cet historien des idées, théoricien de la littérature et médecin psychiatre suisse, le pseudonyme « n’est pas seulement une rupture avec les origines familiales ou sociales : c’est une rupture avec les autres… (il) permet à Stendhal la pluralité des ‘moi’, qui lui permet de se révolter contre une identité imposée du dehors. Et puisque le nom est situé symboliquement au confluent de l’existence pour soi et de l’existence pour autrui, le pseudonyme le rend à l’intime exclusivement, elle lui offre la possibilité de voir sans être vu, fantasme de Stendhal. »
Quoi qu’il en soit, Le Rouge et le Noir est un incontournable de la littérature française. Ce roman d’apprentissage offre une peinture critique de la société contemporaine, l’auteur se situant à la charnière de deux esthétiques littéraires : romantisme exacerbé et réalisme vu par tel ou tel personnage. Autre chef d’œuvre dans l’histoire de la littérature française et signé Stendhal, La Chartreuse de Parme (1839). Le cinéma a rendu un juste hommage à ces deux titres, avec le couple Gérard Philippe et Danielle Darrieux, puis le trio Gérard Philippe, Maria Casarès et Renée Faure.
« Fils de Saint Louis, montez en fiacre. »2134
Mot célèbre et anonyme. Dictionnaire des citations françaises et étrangères, Larousse
Devant le château des Tuileries, le roi s’apprête à monter en voiture. Un homme du peuple lui aurait ouvert la porte et lancé ce mot par dérision. Paraphrase du « Fils de Saint Louis, montez au ciel », derniers mots de l’abbé Edgeworth de Firmont, confesseur de Louis XVI, au roi montant sur l’échafaud en 1793.
Autre version (Revue des annales) : « Fils d’Égalité, montez en fiacre », par référence à son père, Louis Philippe d’Orléans qui prit le nom de Philippe Égalité en 1792, devenant député à la Convention, vota la mort du roi Louis XVI (son cousin)… et finit lui-même guillotiné en 1793.
Louis-Philippe ne part que pour l’exil, en Angleterre où il mourra deux ans plus tard. Un règne de dix-huit ans s’achève, celui d’un roi bourgeois dans une France bourgeoise, « Roi des barricades » entre deux révolutions, l’une de trois jours qui l’a fait roi-citoyen d’une monarchie constitutionnelle, et l’autre beaucoup plus chaotique et sanglante, pour accoucher d’une république, qui aboutira au Second Empire de Napoléon III. La France aura vraiment testé tous les régimes, déclinés en différentes versions.
DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
« Au clair de la lune,
Brave citoyen,
Thiers cherche fortune,
Tu le connais bien.
Il est sans-culotte,
Il en fait l’aveu.
Refrain
Donne-lui ton vote
Pour l’amour de Dieu. »2167La Candidature du citoyen Thiers en 1848, chanson nouvelle en 9 couplets, signée « Le Révélateur impartial ». Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La campagne électorale bat son plein et la chanson (anonyme) dénonce ce politicien arriviste (mais bientôt dans l’opposition jusqu’à la Troisième République) : le voilà élu aux élections complémentaires de juin 1848 qui accentuent le conservatisme de l’Assemblée.
« Bonjour, aimable République,
Je m’appelle Napoléon […]
Pour votre époux, me voulez-vous ? […]
Je vous mettrai tout sens dessus dessous,
Avec moi vous aurez l’Empire,
République, marions-nous ! »2180Le Prétendu de la République (1848), chanson anonyme. La Nouvelle critique : revue du marxisme militant (1962)
Le peuple se moque déjà de Louis-Napoléon Bonaparte, avec un humour prophétique.
Mais les professionnels de la politique et la presse vont sous-estimer l’homme – ou le pouvoir du nom. D’où le Second Empire de Napoléon III (Napoléon II dit l’Aiglon, fils de l’Aigle, étant le duc de Reichstadt).
« Je suis Corse d’origine,
Je suis Anglais pour le ton,
Suisse d’éducation
Et Cosaque pour la mine […]
J’ai la redingote grise,
Et j’ai le petit chapeau ;
Ce costume est assez beau,
On admire cette mise.
Seul le génie est absent
Pour faire un bon président. »2188Complainte de Louis-Napoléon pour compléter sa profession de foi (1848), chanson anonyme. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Il dut souffrir de toutes ces chansons qui le brocardèrent, déjà en « Ratapoil », bientôt en « Badinguet » et autres surnoms. Selon Hugo : « Peu lui importe d’être méprisé, il se contente de la figure du respect » (Napoléon le Petit).
Bien que chansonné et ridiculisé, sous-estimé, malmené, le candidat à la présidence de la République a toutes ses chances : porté par la légende napoléonienne qui enchante le peuple et l’a déjà fait député, il rassure les bourgeois qui ont vu de près le « péril rouge », lors des dernières émeutes de juin 1848.
D’où son élection à la présidence de la République … et la réussite de son coup d’État relativement bien accepté par le peuple, avant l’accès au trône impérial : « On craint une folie impériale. Le peuple la verrait tranquillement » avait dit l’épouse de Thiers, ayant vu Louis-Napoléon Bonaparte passer en revue les troupes, le 4 novembre 1849.
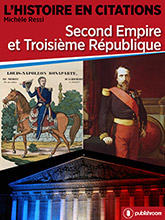 SECOND EMPIRE
SECOND EMPIRE
« Nos cœurs ont suivi le cours de nos rivières. »2280
Parole des Savoyards, devenu proverbe, printemps 1860. Napoléon III et le Second Empire : le zénith impérial, 1853-1860 (1976), André Castelot
Selon les sources, la forme peut varier : « Nos cœurs vont là où vont nos rivières », « Notre cœur va du côté où coulent nos rivières », etc.
Pour dire que les Savoyards votent leur rattachement à la France, par plébiscite des 22 et 23 avril 1860, en vertu du traité de Turin du 24 mars 1860 (épilogue de la campagne d’Italie de 1859). Avec 250 000 oui, contre seulement 230 non ! Le plébiscite de 1860 peut être présenté comme l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, naturellement très populaire.
Les Savoyards ont en fait ratifié une cession de territoire, décidée en 1858 par accord secret, lors de l’entrevue de Plombières du 20 juillet – Cavour, au nom du roi Victor-Emmanuel II, se rend dans cette petite station thermale des Vosges où Napoléon III est en cure. Ils conviennent d’un troc, dans le cadre des négociations diplomatiques relatives à l’unification de l’Italie : en échange de l’aide diplomatique et militaire pour libérer la péninsule de l’occupation autrichienne, le comté de Nice et le duché de Savoie reviennent à la France.
Les Niçois feront le même choix, le 15 avril 1860. Ces conquêtes pacifiques sont à porter au crédit du Second Empire.
GUERRE FRANCO-ALLEMANDE ET SIÈGE DE PARIS (1870-1871)
« D’vant l’boucher, d’vant l’boulanger,
On grelotte dans la rue :
Ni pain ni viand’ pour changer,
Mais quelqu’fois y’a d’la morue.
C’est dans l’plan de Trochu.
Refrain
Savez-vous l’plan de Trochu ?
Grâce à lui rien n’est fichu. »2348Le Plan de Trochu, chanson (1871) - « œuvre collective des journalistes du Grelot ». Les Communards (1964), Michel Winock, Jean-Pierre Azéma
Paris trouve encore la force de rire et de chanter. Trochu, gouverneur de la capitale, est sa tête de Turc favorite, lui qui répète encore et toujours : « J’ai un plan, j’ai un plan. »
Rien moins que 30 couplets détaillent avec un humour parfois noir les misères quotidiennes des Parisiens. On voit aussi venir la défaite. « Le jour où Paris n’aura / Plus d’quoi nourrir une puce / S’disait chacun, l’on fera / Semblant d’se rendre à la Prusse / Ça doit être l’plan de Trochu. »
« Trochu : participe passé du verbe trop choir. » Victor Hugo ne va pas rater le mot quand le général Trochu démissionne, après une résistance bien passive. Le gouverneur de Paris disposait sans doute des forces suffisantes pour résister, mais plus que la peur des Prussiens, il a la hantise des émeutes populaires – comme bien des bourgeois et des paysans de l’époque. Les cris de « Vive la Commune » poussés à chaque émeute terrorisent Trochu, ce conservateur timoré qui se définit comme « Breton, catholique et soldat ».
Le 20 janvier, les Parisiens, affamés, désespérés, ont tenté une « sortie torrentielle » à l’Ouest. Ils sont arrêtés à Buzenval. L’opération s’achève par une piteuse retraite, et 4 000 morts. Trochu se refuse à de nouveaux combats qui « ne seraient qu’une suite de tueries sans but. » Il démissionne donc de son poste de gouverneur militaire de Paris en faveur du général Vinoy, le 22 janvier 1871 – nouveau jour d’émeute, 50 morts – avant de renoncer aussi à la présidence du gouvernement de la Défense nationale.
TROISIÈME REPUBLIQUE
À bas la calotte […] Vive la sociale !2404
Slogans célèbres vers 1900. Institutions politiques de l’Europe contemporaine (1907), Étienne Flandin
La République est devenue radicale : elle mène une politique de laïcisation dont l’anticléricalisme est maladroit, et le peuple lance des cris d’injure contre les prêtres.
Dans cette France aux institutions encore archaïques, on réclame également une République plus sociale, avec des lois pour améliorer la condition ouvrière rendue plus dure par la croissance économique et le développement de la grande industrie.
« La monture a l’air intelligent, ma foi. »2454
Légende d’un portrait de Mac-Mahon à cheval, été 1877. Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919 (1921), Ernest Lavisse, Philippe Sagnac
Le journal qui publie cette belle image tirée d’une brochure de propagande et l’assortit de ce commentaire est poursuivi pour offense au président de la République et condamné à 500 francs d’amende.
On ne compte plus les condamnations pour délits de presse et cris séditieux. Fourtou veille, à l’Intérieur : « Le chef-d’œuvre du cabinet Broglie-Fourtou, c’est d’avoir concentré en cinq mois tout ce que le despotisme impérial avait fait d’arbitraire en dix-huit années », selon Edmond About.
« Néron, Dioclétien, Attila, préfigurateur de l’antéchrist ! »2466
Les catholiques insultant Jules Ferry. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Surnommé hier Ferry-la-Famine – sous la Commune – et demain Ferry-Tonkin – pour sa politique coloniale. Cette fois, il est attaqué en tant que ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts : son projet de réforme de l’enseignement public primaire (laïc, gratuit et obligatoire) réduit l’importance de l’enseignement privé. Débats déjà animés, le 15 mars 1879.
Le 16 juin, la loi Ferry enflammera la Chambre. Gambetta défend son ami Ferry et tape si fort du poing sur la table qu’il perd son œil de verre. Les députés en viennent aux mains. Et volent manchettes et faux cols ! Il faudra encore trois ans avant que passe le train des lois Ferry.
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
« Ceux qu’ont l’pognon, ceux-là r’viendront,
Car c’est pour eux qu’on crève.
Mais c’est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève.
Ce s’ra votre tour, messieurs les gros,
De monter sur l’plateau,
Car si vous voulez la guerre,
Payez-la de votre peau ! »2599La Chanson de Craonne, printemps 1917. La Chanson en son temps : de Béranger au juke-box (1969), Georges Coulonges
Naturellement anonyme, interdite pour son antimilitarisme, cette chanson dit les souffrances des soldats révoltés contre les attaques inutiles et meurtrières lancées par des chefs comme Nivelle.
Clemenceau appelé au gouvernement de la France viendra enfin jouer son rôle de « Père la Victoire », aidé par l’entrée en guerre des Américains reconnaissant le rôle de la France lors de leur Guerre d’Indépendance : « La Fayette, nous voilà ! »
ENTRE-DEUX-GUERRES
Nous ferons la paix […] avec le diable s’il le faut.2695
Slogan des pacifistes. Notre Front populaire (1977), Claude Jamet
On trouve des pacifistes dans les partis de gauche comme de droite, et les responsabilités sont aussi bien dans l’état-major qu’au gouvernement, avant, pendant et après le Front populaire.
Un tel slogan est le reflet d’un pacifisme viscéral qui est avant tout celui du pays, de l’opinion publique : sentiment né de la dernière guerre, des hécatombes qui ont touché la plupart des familles. C’est l’une des raisons de l’effondrement de la diplomatie française dans l’entre-deux-guerres : « Jusqu’en 1939, la politique extérieure de la France ne fut plus […] qu’une suite d’abandons : évacuation de la Ruhr, suppression du contrôle militaire, abandon des réparations, évacuation anticipée de la Rhénanie […] L’Allemagne libérée devint menaçante » (Pierre Gaxotte, Histoire des Français).
« La France et l’Angleterre doivent désormais résister à toute nouvelle exigence de Hitler. »2702
Avis de 70 % des Français, selon un sondage de décembre 1938. Histoire de la France au XXe siècle, volume II (2003), Serge Berstein, Pierre Milza
Premier fait, de nature politique : le revirement de l’opinion publique. En septembre, 57 % des Français étaient encore favorables aux accords de Munich. Mais la montée de l’hitlérisme est mieux saisie, et la bourgeoisie a moins peur de la révolution, après l’échec syndical de la CGT (mot d’ordre de grève générale non suivi, en novembre).
Autre fait, de société : l’apparition des sondages d’opinion publique en France – nés aux USA, fin 1936, à l’initiative d’un journaliste et statisticien, George Horace Gallup, fondateur de l’institut portant son nom. D’août 1938 à juillet 1939, il y a près de trente sondages sur l’opinion face aux problèmes extérieurs : une source d’information devenue indispensable.
« Le souci le plus urgent du gouvernement doit être de renforcer la puissance militaire. »2703
Avis de 79 % des Français, selon un sondage de février 1939. La Vie politique sous la IIIe République : 1870-1940 (1984), Jean-Marie Mayeur
Les sondages indiquent la même tendance en Grande-Bretagne. En mars, Hitler rompt les accords de Munich et occupe pour la première fois un territoire non peuplé d’Allemands, la Bohême-Moravie.
La fiction du droit des peuples invoquée pour les Sudètes tombe. Voilà bientôt l’ensemble de la Tchécoslovaquie annexé. Mussolini de son côté occupe l’Albanie.
En avril, les Français, dûment sondés, ne seront plus que 17 % à nier le risque d’une guerre.
QUATRIEME REPUBLIQUE
« L’Armée au pouvoir ! Tous au GG ! »2920
Cris de la foule, Alger, manifestation du 13 mai 1958. L’Appel au père : de Clemenceau à de Gaulle (1992), Jean-Pierre Guichard
Le GG, c’est le palais du gouverneur général, devenu, depuis 1956, celui du ministre résident. Il est le symbole du pouvoir et, en tant que tel, pris d’assaut, pillé. Un Comité de salut public se constitue, mêlant Français et musulmans, civils et militaires, en une coalition très hétéroclite, présidée par le général Massu : c’est le putsch d’Alger, ou coup d’État du 13 mai.
« Deux pouvoirs s’instaurent : le pouvoir légal à Paris et le pouvoir militaire à Alger. Un troisième, le pouvoir moral, celui du général de Gaulle, est encore à Colombey. » Jacques Fauvet, La Quatrième République (1959).
De Gaulle, retiré de la scène politique peu après la guerre (20 janvier 1946), très hostile au régime des partis de la Quatrième, se tient en réserve de la République et sent son heure enfin revenue : oui, la France a besoin de lui ! Il va faire l’un des come-back les plus réussi de notre histoire et créer la Cinquième République en commençant par mettre fin à la guerre d’Algérie.
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE SOUS DE GAULLE ET MAI 68
« L’OAS frappe où elle veut, quand elle veut, comme elle veut. »2998
Slogan de la nouvelle « Organisation Armée secrète ». L’OAS et la fin de la guerre d’Algérie (1985), M’Hamed Yousfi
Premiers tracts anonymes, mais signés OAS, lancés début février 1961.
L’armée fait son métier en Algérie, avec 400 000 hommes qui se battent sur le terrain. La pacification progresse (excepté dans les Aurès), mais le terrorisme fait rage et le FLN multiplie les attentats.
Les Européens d’Algérie vivent aussi dans la terreur de la négociation qui conduira inévitablement à l’indépendance. L’OAS, choisissant la politique du désespoir, recourt également aux attentats. Ainsi, le maire d’Évian, Camille Blanc, tué par une charge de plastic le 31 mars, assassiné uniquement parce que sa ville est choisie pour accueillir les négociations. Cela n’infléchit en rien la politique du président.
La valise ou le cercueil.3006
FLN, écrit sur des petits cercueils postés aux pieds-noirs. De Gaulle ou l’éternel défi : 56 témoignages (1988), Jean Lacouture, Roland Mehl, Jean Labib
Au printemps 1946, le PPA (Parti du peuple algérien luttant pour l’indépendance) diffusait déjà le slogan à Constantine, sur des tracts glissés dans les boîtes aux lettres.
Mais c’est au printemps 1962, à Alger, à Oran, que les attentats sont les plus nombreux, une charge de plastic pouvant faire plus de cent morts et blessés ! Le FLN déclenche également à la mi-avril une série d’enlèvements, pour lutter contre l’OAS toujours active dans le maquis. Mais ses membres sont protégés, en centre-ville, et les victimes sont surtout les colons isolés dans les bleds, les harkis, les habitants des banlieues. La découverte de charniers augmente la peur des petits blancs. L’exode s’accélère : il y aura beaucoup de valises, et de cercueils aussi, à l’issue de cette guerre de huit ans.
« Aujourd’hui ou demain, envers et contre tous, le traître de Gaulle sera abattu comme un chien enragé. »3010
Tract CNR (nouveau Conseil national de la résistance, créé par l’OAS) reçu par tous les députés, après l’attentat du Petit-Clamart, août 1962. Chronique des années soixante (1990), Michel Winock
Même procédé. C’est encore une retombée de la guerre d’Algérie, aux conséquences importantes et surtout inattendues.
De Gaulle échappe par miracle à l’attentat, le soir du 22 août, au carrefour du Petit-Clamart, près de l’aéroport militaire de Villacoublay. Sa DS 19 est criblée de 150 balles, et seul le sang-froid du chauffeur, accélérant malgré les pneus crevés, a sauvé la vie au général et à Mme de Gaulle.
Dès le lendemain de l’attentat, de Gaulle profite de l’émotion des Français pour faire passer une réforme qui lui tient à cœur : l’élection du président au suffrage universel. S’il devait mourir, cela donnerait plus de poids à son successeur et plus de légitimité. La Cinquième République vit désormais sous ce « nouveau régime » présidentiel.
Métro-boulot-dodo.2949
Pierre BÉARN (1902-2004), Couleurs d’usine, poèmes (1951)
Tous les slogans de Mai 68 seront anonymes. Mais pas cette expression, empruntée au poème publié chez Seghers. Une strophe décrit ainsi la monotonie quotidienne du travail en usine : « Au déboulé garçon pointe ton numéro / Pour gagner ainsi le salaire / D’un énorme jour utilitaire / Métro, boulot, bistrot, mégots, dodo, zéro. »
Le texte, tiré à deux mille exemplaires au théâtre de l’Odéon, sera distribué à la foule des étudiants. Quelques meneurs d’opinion vont expurger le dernier vers de trois mots pouvant être mal interprétés : bistrot, mégots, zéro. Reste la trilogie qui va enrichir les graffiti peints sur les murs de Paris, résumant le cercle infernal propre à des millions de travailleurs : « Métro, boulot, dodo ». On rêve forcément d’une autre vie. C’est l’une des raisons de l’explosion sociale de Mai 68.
Professeurs, vous êtes vieux, votre culture aussi.
Slogan, murs de Nanterre, 22 mars 1968. Génération, tome I, Les Années de rêve (1987), Hervé Hamon, Patrick Rotman
Ce roman vrai est l’un des meilleurs récits de Mai 68 et donne tous les slogans qui en sont nés. Ce sera notre source. Et Mai 68 commence en mars dans la banlieue ouest, Quartier de l’Université.
Le Mouvement du 22 mars est créé : mouvance sans programme, sans hiérarchie, mais avec beaucoup de leaders tenant leur autorité de leur force de persuasion, de leur imagination. Première vedette, Daniel Cohn-Bendit, étudiant en sociologie, de nationalité allemande (par choix), né en France de parents juifs réfugiés pendant la guerre. Dany le Rouge (surnom qu’il doit à ses cheveux roux, comme à son gauchisme militant) est doué à 23 ans d’un charisme qui le rend très populaire auprès des étudiants, et redouté, voire détesté dans l’autre camp – avant de devenir Dany le Vert, dans la liste Europe Écologie, avec une belle cote de popularité auprès des Français. Pour l’heure, à Nanterre, il fédère les groupuscules depuis quelques mois et figure sur la liste noire des étudiants.
Le doyen Grappin, devant l’agitation, ferme l’université jusqu’au 1er avril.
Avril à Paris : la Sorbonne ronronne, les étudiants étudient, les professeurs professent, l’agitation est retombée à l’approche des examens. Mais le 2 mai, nouvelle fermeture de Nanterre, sine die.
On ne tombe pas amoureux d’un taux de croissance.
Slogan de Mai 68
Une bonne raison de refuser la société (de consommation). D’ailleurs, ce sera écrit en toutes lettres sur les murs… Il y aura bien d’autres raisons de révolte, remarquablement formulées.
Tous les slogans de Mai 68 sont anonymes – non signés, mais créés dans l’agitation collective qui va inspirer les étudiants de l’école des Beaux-Arts.
J’emmerde la société, mais elle me le rend bien.
Slogan de Mai 68
On a pu lire bien d’autres revendications, tout et le contraire de tout et vice versa. C’est de bonne guerre, dans ce genre de situation explosive.
Défense de ne pas afficher.
L’imagination au pouvoir.
Exagérer, c’est commencer d’inventer.
Prenez vos désirs pour des réalités.
Faites l’amour, pas la guerre.Slogans de Mai 68.
Les sociologues ont commenté à l’infini ces mots qui restent dans la mémoire collective, bien au-delà de la génération spontanée qui les créa, entre barricades bon enfant, manifs en chaîne et grèves de la joie.
Le 15 mai 1968, un atelier d’affiches est créé au sein de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement. Quelques jours plus tard, les occupants de l’école des Arts décoratifs fondent à leur tour un « atelier populaire ».
Pendant plus d’un mois, des assemblées générales réunissent quotidiennement artistes, étudiants et travailleurs pour discuter des thèmes et des slogans sur les affiches réalisées le jour même. Quelque deux cents créations démontrent à quel point elles ont su traduire « les Événements ». Une production exceptionnelle qui brise certains mythes, tel celui de la « création spontanée » des étudiants. L’anonymat de règle et soigneusement préservé constitue un patrimoine esthétique et culturel majeur du XXe siècle, qui n’a cessé jusqu’à aujourd’hui d’inspirer de nombreux designers graphiques.
Sous les pavés, la plage.
L’aboutissement de toute pensée, c’est le pavé.Slogans de la nuit du 10 au 11 mai 1968
Première nuit d’émeute, dite nuit des Barricades : des dizaines se dressent, barrant petites rues et grandes artères du Quartier latin (boulevard Saint-Michel, rue Gay-Lussac), entassements de voitures et pavés, arbres et palissades, matériaux volés aux chantiers voisins.
Interdit d’interdire.
Celui qui peut attribuer un chiffre à un texte est un con.
Quand le dernier des sociologues aura été étranglé avec les tripes du dernier bureaucrate, aurons-nous encore des problèmes ?Slogans du 13 mai 1968
Lundi 13 mai, la Sorbonne rouverte est immédiatement occupée par les étudiants, comme toutes les autres facultés parisiennes. On multiplie les assemblées générales (AG) en forme de parlements informels. Premier communiqué : « L’Assemblée générale du lundi 13 mai décide que l’université de Paris est déclarée université autonome, populaire et ouverte en permanence, jour et nuit, à tous les travailleurs. L’université de Paris sera désormais gérée par les comités d’occupation et de gestion, constituée par les travailleurs, les étudiants et les enseignants. »
Ouvriers, enseignants, étudiants solidaires.
Inscription sur les bannières, 13 mai 1968
Manifestation digne, imposante, historique, mais sage : 200 000 personnes défilent de la République à Denfert-Rochereau en lançant ce nouveau slogan solidaire. Les dirigeants étudiants prennent parfois le pas sur les leaders syndicaux, d’où la réflexion de Cohn-Bendit qui est leur bête noire : « Ce qui m’a fait plaisir, cet après-midi, c’est d’être en tête du défilé où les crapules staliniennes étaient dans le fourgon de queue. »
Tout pouvoir abuse, le pouvoir absolu abuse absolument.
Ne me libère pas, je m’en charge.
L’alcool tue, prenez du LSD.Slogans à Nanterre, 14 mai 1968
Cependant que le général de Gaulle s’envole pour la Roumanie : il ne veut pas que des querelles internes passent avant ses engagements internationaux. Mais c’est sous-estimer l’importance des événements.
Soyez réalistes, demandez l’impossible.
Aux examens, répondez par des questions.Slogans à Censier (annexe de la Sorbonne), 14 mai 1968
Le premier slogan est inspiré d’Ernesto Che Guevara, révolutionnaire marxiste-léniniste et homme politique d’Amérique latine, dirigeant la guérilla internationaliste cubaine qu’il a théorisée et tenté d’exporter, sans succès, vers le Congo puis la Bolivie où il meurt un an plus tôt : « Soyons réalistes, demandons l’impossible. »
Quant au second slogan… Que répondre à cette logique !? Les professeurs, les politiques, les commentateurs sont dépassés, mais les acteurs et les auteurs de Mai 68 ne le sont pas moins.
Quand l’assemblée nationale devient un théâtre bourgeois, tous les théâtres bourgeois doivent devenir des assemblées nationales.
Slogan, soir du 15 mai 1968 à l’Odéon-Théâtre de France
La prise de l’Odéon, mise aux voix le 13 mai, fit l’unanimité à Censier. Lieu symbolique, et si près du Quartier latin ! Ce mercredi soir, l’idée jaillit dans un cri : « Occupons l’Odéon. »
Jean-Louis Barrault, le directeur, prévenu, a interrogé le ministère : Que faire ? Ouvrir les portes et entamer le dialogue. 3 000 personnes occupent une salle de 1 000 places et un gigantesque happening commence, le 15 mai. Il va durer un mois.
Tout est dada.
L’art, c’est de la merde.
Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi.Slogans, nuit du 15 mai 1968 à l’Odéon
Dans la nuit, la création s’en donne à cœur joie. Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, codirectrice, voient leur rideau de fer se couvrir de ces graffitis. Et Jean-Louis déchaîne une ovation qui fait trembler les lustres en déclarant : « Barrault n’est plus le directeur de ce théâtre, mais un comédien comme les autres. Barrault est mort, mais il reste un homme vivant. Alors que faire ? »
Malraux, ministre de la Culture, lui retirera la direction du théâtre : ni l’Odéon ni Barrault ne s’en remettront. Le monde du spectacle est tout entier gagné par la contestation. Et les ouvriers enchaînent, entre grèves sauvages et grèves officielles, organisées par les syndicats plus ou moins dépassés.
Samedi 18 mai, débarquant d’avion, de retour de Roumanie avec douze heures d’avance, de Gaulle déclare à Orly : « La récréation est finie. ». Il dit aussi : « Ces jeunes gens sont pleins de vitalité. Envoyez-les donc construire des routes. » Et le lendemain dans son bureau de l’Élysée : « La réforme, oui, la chienlit, non. »
La chienlit, c’est lui.
Slogan sous une marionnette en habit de général aux Beaux-Arts, 20 mai 1968
La chienlit ? Ce sont surtout 6 à 10 millions de grévistes. Et tout ce qui s’ensuit : usines occupées, essence rationnée, centres postaux bloqués, banques fermées. Les ménagères stockent. Les cafés sont pleins. La parole se déchaîne jusque dans les églises. La moindre petite ville a son mini-Odéon et sa micro-Sorbonne.
Ce n’est pas une révolution, sire, c’est une mutation.
Slogan sur les murs de Nanterre, mai 1968
Cohn-Bendit, Dany le Rouge, l’« enragé de Nanterre », sait être aussi lucide et raisonnable à 23 ans, quand il affirme le 20 mai : « Je ne crois pas que la révolution soit possible du jour au lendemain. Je crois que nous allons plutôt vers un changement perpétuel de la société, provoqué à chaque étape par des actions révolutionnaires […] Au mieux, on peut espérer faire tomber le gouvernement. Mais il ne faut pas songer à faire éclater la société bourgeoise. »
Nous sommes tous des juifs allemands
Slogan, 23 mai 1968
En réponse à l’interdiction de séjour de Cohn-Bendit. Et « ça repart ». Le 23, jeudi de l’Ascension, manifs et bagarres, notamment au Quartier latin.
La Ve au clou, la Ve c’est nous !
Ouvriers, paysans, étudiants, tous unis.Slogans lors de la manifestation du 24 mai 1968
Le 24 mai, la manifestation prévue prend un tour imprévu. Malgré l’hostilité de la CGT, des ouvriers se sont joints aux étudiants et scandent en chœur : trahison – ni Mitterrand, ni de Gaulle – les usines aux travailleurs. Et en faveur de Cohn-Bendit : Les frontières, on s’en fout, répétant le slogan : Nous sommes tous des juifs allemands.
Mais « le 30 mai, en l’espace de cinq minutes que dura l’allocution du général, la France changea de maître, de régime et de siècle. Avant 16 h 30, on était à Cuba. Après 16 h 35, c’était presque la Restauration. » Jean Lacouture, De Gaulle, volume III. Le souverain (1986). Le biographe exprime le ressaisissement du pouvoir, le revirement de l’opinion, l’incroyable rapidité du retour à l’ordre des choses. Jusqu’à la fin, Mai 68 sera le plus surprenant des happenings.
Le travail reprend progressivement, après les fêtes de la Pentecôte. Le gouvernement Pompidou est remanié pour écarter momentanément les ministres trop exposés dans les événements (Éducation nationale, Jeunesse, Information, Intérieur, Affaires sociales). Et on prépare les élections.
Élections, trahison.
Élections-piège à con.Slogans des gauchistes, juin 1968
Les deux slogans resserviront, comme beaucoup de mots anonymes nés de Mai 68.
« L’euro, c’est l’Europe dans la poche du citoyen. »3366
Citation anonyme
Elle vaut d’entrer dans l’Histoire, au même titre que la monnaie européenne. C’est la plus simple définition de cette monnaie qui commence à circuler le 1er janvier 2002 – la devise était entrée en vigueur pour les transactions financières, dès le 1er janvier 1999.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.