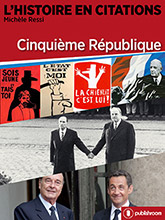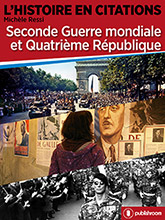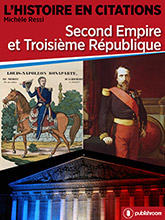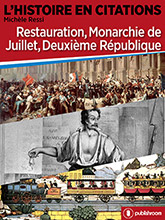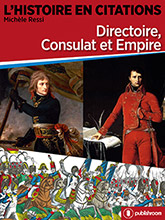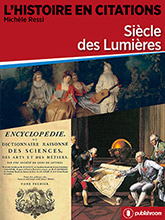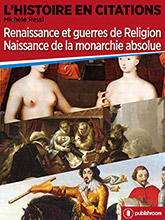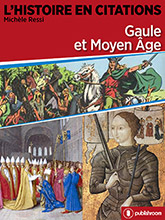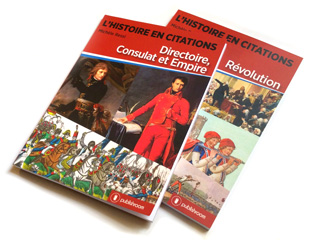« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »
Albert CAMUS (1913-1960), Sur une philosophie de l’expression, revue Poésie 44
Et en d’autres mots : « Sans savoir ou sans dire encore comment cela est possible, la grande tâche de l’homme est de ne pas servir le mensonge. »
L’Histoire nous donne des repères – encore faut-il qu’ils soient clairs… et historiquement exacts.
À l’époque de toutes les confusions, approximations, exagérations et autres fake-news, voici donc 55 repères historiques : points fondamentaux ou détails anecdotiques, amusants ou tragiques… à méditer et partager à l’occasion.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
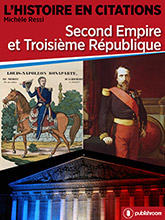 TROISIÈME RÉPUBLIQUE
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
50. Notre fête nationale votée sous la Troisième République : le 14 juillet 1790, Fête de la Fédération, plutôt que la prise de la Bastille en 1789.
« Par devant l’Europe, la France, sachez-le, n’aura jamais qu’un seul nom, inexpiable, qui est son vrai nom éternel : la Révolution. »1632
Jules MICHELET (1798-1874), Le Peuple (1846)
Jugement à nuancer : pour cet historien de gauche, la Révolution de 1789 devrait finir en 1790, sur le Champ de Mars, en son point culminant, le jour de la Fête de la Fédération.
« Partout la joie est générale
Depuis qu’en vertu d’un décret
Notre fête nationale
Doit avoir lieu l’quatorze juillet ! »2463Aristide Bruant (1851-1925), J’suis d’l’avis du gouvernement (1879), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Un couplet de la chanson de Bruant célèbre l’événement et chante le consensus du pays : « Quand je vois pour fêter la France / Choisir la date d’un événement / Qui lui rappelle sa délivrance / J’suis d’l’avis du gouvernement. »
La Marseillaise est proclamée hymne national en même temps que le 14 juillet devient fête nationale. La loi est promulguée le 6 juillet 1880. C’est le premier vote des Chambres revenues de Versailles à Paris. Huit ans après la Commune, Paris redevient capitale de la France.
Mais on discute encore pour savoir si l’on célèbre 1789 ou 1790, la prise de la Bastille ou la Fête de la Fédération. La seconde hypothèse est la plus vraisemblable. Évoquons les deux évènements tels que jugés par deux historiens dont un témoin…
« La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique et je reculai. »1329
François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
La tête « au bout d’une pique » est un classique de l’horreur révolutionnaire. La « première tête » peut être celle du gouverneur de la Bastille, de Launay, massacré par le peuple le 14 juillet, lors de la prise du fort. Chateaubriand, 21 ans, réformé de l’armée, hésitant sur sa vocation, s’est essayé à la vie politique au début de l’année, en participant aux États de Bretagne (assemblée provinciale). Présent à Paris au début de la Révolution, il est très choqué par cette violence « cannibale ».
Représentatif de sa classe, il écrit aussi : « Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste. »
« C’est une conjuration pour l’unité de la France. Ces fédérations de province regardent toutes vers le centre, toutes invoquent l’Assemblée nationale, se rattachent à elle, c’est-à-dire à l’unité. Toutes remercient Paris de son appel fraternel. »1370
Jules MICHELET (1798-1874), Histoire de la Révolution française (1847-1853)
L’historien de la Révolution voit en cette fête du 14 juillet 1790 le point culminant de l’époque, son génie même. C’est le jour de tous les espoirs. Et le peuple chante la plus gaie des carmagnoles. « Ah ! ça ira, ça ira, ça ira / Le peuple en ce jour sans cesse répète, / Ah ! ça ira, ça ira, ça ira. … Réjouissons-nous le bon temps viendra. »
51.« Madelon, ah ! verse à boire » : confusion (officielle) entre les deux chants très populaires.
« Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. »2615
Maréchal FOCH (1851-1929), Ordre du jour aux armées alliées, 12 novembre 1918. Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919, volume IX (1922), Ernest Lavisse, Philippe Sagnac
Fin de la Grande Guerre.
Foch, généralissime, est promu maréchal, en août 1918. Son ordre du jour est rédigé le 11 novembre à Senlis, à l’heure même où Clemenceau parle à la Chambre des députés, et publié le 12 novembre : « Officiers, sous-officiers, soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l’ennemi, vous l’avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit […] Soyez fiers ! D’une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. »
« Madelon, ah ! verse à boire,
Et surtout, n’y mets pas d’eau,
C’est pour fêter la victoire,
Joffre, Foch et Clemenceau. »2616La Madelon de la victoire (1918), chanson de Lucien Boyer (1876-1942), paroles, et Charles Borel-Clerc (1879-1959), musique, Chansons de la revanche et de la Grande Guerre (1985), Madeleine Schmid
Cette chanson à boire, créée en 1919, éclipse presque la première Madelon.
« Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon… »Quand Madelon ou La Madelon, célèbre chanson militaire (1914) de Louis BOUSQUET (1871-1941) paroles et Camille ROBERT ( 1872-1957), musique
Chanson rapidement populaire parmi les soldats français, devenue un symbole de l’effort de guerre et du courage des soldats pendant le conflit.
Clemenceau (ou plutôt l’administration) confond d’ailleurs les deux chansons, quand il décore par erreur Lucien Boyer de la Légion d’honneur, le prenant pour l’auteur de Quand Madelon.
Créée par Rose Amy et reprise par Chevalier, La Madelon de la victoire va devenir mondialement célèbre : « Après quatre ans d’espérance / Tous les peuples alliés / Avec les poilus de France / Font des moissons de lauriers […] / Madelon, emplis mon verre / Et chante avec les poilus / Nous avons gagné la guerre / Hein, crois-tu qu’on les a eus ! »
52. La mythomanie avérée de Malraux : source de quelques malentendus historiques.
« Tout aventurier est né d’un mythomane. »
André MALRAUX (1901-1976), La Voix royale (1930)
Autodidacte et tenté par l’aventure, le jeune aventurier part avec son épouse Clara Malraux en Indochine. Il sera emprisonné en 1923-1924 pour vol et recel d’antiquités sacrées khmères.
De retour en France, il transpose cette aventure dans son deuxième roman La Voie royale (1930) et gagne la célébrité dans la francophonie avec La Condition humaine (1933), roman d’aventures et d’engagement qui s’inspire des soubresauts révolutionnaires de la Chine et obtient le prix Goncourt. Son premier roman, Les Conquérants (1928) mettait aussi en scène des héros révolutionnaires en Chine, luttant contre la présence européenne.
Militant antifasciste, il relate ensuite le début de la guerre d’Espagne, du putsch militaire franquiste du 18 juillet 1936 à la bataille de Guadalajara en mars 1937, où les républicains ont été victorieux. Il en tire son quatrième roman, L’Espoir (décembre 1937), et en tourner une adaptation filmée en 1938.
« Les grandes manœuvres sanglantes du monde étaient commencées. »2684
André MALRAUX (1901-1976), L’Espoir (1937)
L’écrivain aventurier s’est engagé aux côtés des républicains qui combattent au cri de « Viva la muerte », dans cette guerre civile qui va durer trois ans, et servir de banc d’essai aux armées fascistes et nazies.
Contrairement à tous ses confrères qui ont cru à la paix du monde, Malraux, des Conquérants (1928) à L’Espoir (1937), en passant par La Condition humaine (prix Goncourt 1933), se fait l’écho fidèle et prémonitoire de ce temps d’apocalypse. Lui-même devient un héros révolutionnaire, à l’image des héros de ses livres, avec un très grand talent, dans l’aventure comme dans la littérature.
« Pour moi, André Malraux a eu deux très beaux romans : « L’Espoir », et sa propre vie. »
Olivier TODD (1929-2024) France-Culture, 4 octobre 2014
« On peut même parler de résistance mensongère. La mythomanie existe. Malraux de son vivant disait volontiers : ‘On raconte que je fabule. Mais il se trouve que mes fables viennent petit à petit à coïncider avec la réalité.’
La résistance de Malraux est le cœur de sa mythomanie. Malraux a refusé pendant des années de participer à la résistance en disant : ‘Vous n’avez pas d’armes et vous n’avez pas de chars.’ Il est arrivé en soi-disant résistance en décembre 1942 à Saint-Chamant (en Auvergne). Il s’y est installé et a vécu une vie tout à fait normale. Le courrier arrivait à son nom, les cartes d’alimentation étaient à son nom. Il se comportait comme un citoyen français de Vichy. Il était très occupé à écrire les 2 600 pages de son ouvrage sur Lawrence d’Arabie. À chacun son occupation. Sartre n’était pas dans un char pour prendre la place de la Concorde ; Malraux n’était pas à Saint-Chamant pour faire de la résistance…
« De Gaulle n’était sans doute pas dupe, mais la raison d’État voulait en 1950 que Malraux soit un héros parfait. Il avait fait la brigade Alsace-Lorraine, il était Compagnon de la Libération et on lui a donné la Résistance en plus. »
Olivier TODD (1929-2024), Malraux : épidémiologie d’une légende, Séance du lundi 3 novembre 2003, Académie des Sciences morales et politiques
« Qui sont les responsables de la diffusion de la légende Malraux ? En premier lieu, Malraux lui-même, par ce qu’il a dit et surtout par ce qu’il a écrit, non seulement dans ses romans, mais également dans les papiers administratifs. Il n’y a aucun doute qu’il a trafiqué ses papiers.
Est également responsable de la légende Malraux le général Jacquot, qui a mis Malraux en piste pour la brigade Alsace-Lorraine. Les deux hommes se sont défendus l’un l’autre et se sont donné des certificats de résistance l’un à l’autre. Les Anglais également ont aidé Malraux en lui conférant le Distinguished Service Order. Dans la citation anglaise, Malraux devient l’homme qui a organisé toute la résistance dans le sud-ouest !
Georges Pompidou fait également partie des responsables. Il a avalé toutes les couleuvres que Malraux servait, à commencer par son diplôme des langues orientales, qu’il n’a jamais eu. Il y a aussi le général De Gaulle qui a établi une liste de tous les chefs de région en France et fait la part belle à Malraux…
Des journalistes aussi, tel mon confrère Jean Lacouture, ont renforcé la légende en ne vérifiant pas leurs sources. D’autres, tel André Brincourt, ont encensé Malraux et caché certaines choses, par exemple que Malraux était un très grand dépressif et un alcoolique.
Malraux a bénéficié de la complicité d’une partie de la presse et de la critique. Les journalistes ne se croient pas habilités à émettre des jugements littéraires et parallèlement les critiques littéraires ne veulent pas juger de l’histoire. Cela a contribué à l’émergence d’une double légende : la légende journalistique et la légende littéraire. »
« Une des raisons profondes, je crois, qui a motivé son attitude, c’est ce qu’il écrit au début de ces Anti-mémoires : ‘Il n’y a pas de grandes personnes.’ Malraux lui-même n’est pas une grande personne. Il est resté toute sa vie un perpétuel adolescent confondant allègrement réalité et fiction. »
Olivier TODD (1929-2024), Malraux : épidémiologie d’une légende, Séance du lundi 3 novembre 2003, Académie des Sciences morales et politiques.
« Les Antimémoires sont pleines de bonne littérature qui n’est pas nécessairement de la bonne histoire… Même sa fille a toujours pensé qu’il s’agissait d’embellissements, comme aurait dit Chateaubriand. »
Oliver Todd recense une foule de détails inexacts, d’exagérations, de pures inventions… « Il y a aussi son arrivée à la prison Saint-Michel, qui est un formidable morceau d’anthologie. Proclamant qu’il est le colonel Berger, il refuse d’être soigné, après que les Allemands l’ont mis au lit, avec une bouteille de Bordeaux et des draps blancs, ce qui n’était pas le sort réservé à la plupart des résistants… »
« Un autre document est particulièrement intéressant, il s’agit du dernier roman de Malraux, un fragment qui s’appelle Non. [A. Malraux, Non. Fragments d’un roman sur la résistance (inédit)] Dans ce roman, Malraux se remet en scène, mais très mal parce qu’il n’a absolument jamais connu la résistance. Malraux, héros du roman, arrive à Paris et on apprend que Max, c’est-à-dire Jean Moulin, vient de disparaître. Qui va prendre automatiquement la succession de Jean Moulin ? Bien sûr le colonel Berger ! »
« Malraux était mythomane, il n’y a pas de doute là-dessus. Mais ça ne me gêne pas outre mesure. Chateaubriand aussi était mythomane, il a inventé dans les « Mémoires d’outre-tombe » des choses - et des choses considérables - qui n’ont pas eu lieu. »
François de SAINT-CHERON (né en 1958), auteur de plusieurs livres sur André Malraux.
53. Citation dite apocryphe (de Malraux) la plus connue et la moins bien entendue à propos du XXIe siècle.
« Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. »2970
André MALRAUX (1901-1976), La Légende du siècle (1972), série télévisée de Claude Santelli et Françoise Verny
Taper « spirituel » ou « spiritualité » sur un clavier d’ordinateur et le moteur de recherche affiche des millions de résultats en une fraction de seconde. Dans la masse des informations, la phrase de Malraux est mentionnée, avec nombre d’erreurs et de contresens.
Malraux tenait au mot « spirituel » – et non pas « spiritualiste » (fiche Wikipédia, « ébauche » sur les Antimémoires en juillet 2021), « religieux », voire « mystique », autant de qualificatifs trahissant sa pensée, pour augmenter encore le malentendu !
Tadao Takemoto fait précisément allusion à cette spiritualité dans son essai : André Malraux et la Cascade de Nashi (1989). Si cette phrase ne figure dans aucune de ses œuvres publiées, il l’a vraisemblablement prononcée dans la série télévisée La Légende du siècle. Claude Santelli (1923-2001), président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), nous l’avait confirmé. Mais deux des neuf épisodes ne sont plus disponibles.
Reste à savoir de quelle spiritualité il s’agira. Entre le retour du religieux, la vogue des sectes, l’attrait pour la philosophie, la quête de sens et d’éternité, l’aspiration à un ailleurs ou autrement, toutes les voies, individuelles ou collectives, sont possibles comme antidote au matérialisme sous toutes ses formes.
54. « Je vous ai compris ! » : mots très diversement commentés, avec la version de l’auteur (de Gaulle).
« Je vous ai compris ! »2930
Charles de GAULLE (1890-1970), Discours au balcon du gouvernement général à Alger, 4 juin 1958. Mémoires d’espoir, tome I, Le Renouveau, 1958-1962 (1970), Charles de Gaulle
Que n’a-t-on dit sur ces quatre mots ! Dans ses Mémoires, le Général explique : « Mots apparemment spontanés dans la forme, mais au fond bien calculés, dont je veux qu’elle [la foule] s’enthousiasme, sans qu’ils m’emportent plus loin que je n’ai résolu d’aller. »
Et il poursuit, face à la foule : « Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c’est celle de la rénovation et de la fraternité […] Jamais plus qu’ici et jamais plus que ce soir, je n’ai compris combien c’est beau, combien c’est grand, combien c’est généreux, la France. »
« J’ai toujours su et décidé qu’il faudrait donner à l’Algérie son indépendance. Mais imaginez, qu’en 1958, quand je suis revenu au pouvoir, je disais sur le Forum d’Alger qu’il fallait que les Algériens prennent eux-mêmes leur gouvernement, il n’y aurait plus eu de De Gaulle immédiatement ! »
Charles de GAULLE (1890-1970), au journaliste du Monde André Passeron, le 6 mai 1966
Deux jours plus tard, il va confirmer le fameux discours d’Alger.
« Il n’y a plus ici, je le proclame en son nom [la France] et je vous en donne ma parole, que des Français à part entière, des compatriotes, des concitoyens, des frères qui marcheront désormais dans la vie en se tenant la main […] Vive l’Algérie française. »2931
Charles de GAULLE (1890-1970), Discours de Mostaganem, 6 juin 1958. De Gaulle, 1958-1969 (1972), André Passeron
De Gaulle fera cinq fois le voyage Paris-Algérie, en 1958. Il joue de son charisme qui est immense. Il veut montrer qu’il prend l’affaire algérienne en main, qu’il y a un pouvoir et qu’il l’incarne. Bref, que c’en est fini des mœurs de la Quatrième République.
La Cinquième en naîtra, régime véritablement présidentiel, et de Gaulle, président de la République, mettra fin à la guerre d’Algérie.
« La décolonisation est notre intérêt et par conséquent notre politique. Pourquoi resterions-nous accrochés à des dominations coûteuses, sanglantes et sans issue, alors que notre pays est à renouveler de fond en comble ? »2939
Charles de GAULLE (1890-1970), Conférence de presse, 11 avril 1961. Paroles de chefs, 1940-1962 (1963), Claude Cy, Charles de Gaulle
Il a reconnu auparavant que la France a réalisé outre-mer une grande œuvre humaine qui, malgré des abus ou des erreurs, lui fait pour toujours honneur. La IVe République, qui a commencé la décolonisation (Indochine, Maroc, Tunisie, Afrique noire en cours), a rappelé de Gaulle au pouvoir pour résoudre l’« affaire algérienne ». Ce qu’il a fait, en lui donnant l’indépendance inscrite dans le cours de l’histoire.
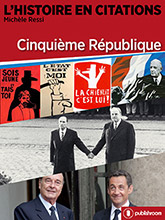 CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
55. L’Europe des États clairement opposée à l’Europe fédérale par de Gaulle en 1962… mais que de mots et de malentendus à suivre !
« Il faut que la défense de la France soit française […] Un pays comme la France, s’il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort. »
Charles de GAULLE (1890-1970), Discours au Centre des hautes études militaires, 3 novembre 1959. Discours et messages : avec le renouveau, mai 1958-juillet 1962 (1970), Charles de Gaulle
C’est aussi un militaire qui parle. Et pendant sa guerre de Résistance, il a dû se battre aussi pour être reconnu du grand allié américain. Un peu plus tard, face aux USA, il affirmera : « Il est intolérable à un grand État que son destin soit laissé aux décisions et à l’action d’un autre État quelque amical qu’il puisse être. »
La force de frappe atomique française, clé de voûte du système de défense, combattue du vivant du général de Gaulle, populaire dans l’opinion, sera développée par tous ses successeurs. Au XXIe siècle, hors tout contexte de guerre froide, la force de dissuasion nationale n’est pas vraiment remise en question. En 2025, quand l’allié américain se désengage par la voix de Donald Trump, la stratégie du général de Gaulle prend un nouveau sens.
Mais la défense européenne reste une question en suspense…
« Il ne peut pas y avoir d’autre Europe que celle des États. »3009
Charles de GAULLE (1890-1970), Conférence de presse, 15 mai 1962. Discours et messages, volume III (1970), Charles de Gaulle
Et pour preuve : « Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l’Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italien, Allemand et Français. Ils n’auraient pas beaucoup servi l’Europe s’ils avaient été des apatrides et s’ils avaient pensé, écrit en quelque esperanto ou volapük intégré ».
Du coup, les membres du gouvernement appartenant au MRP, parti très européen, démissionnent, Pierre Pflimlin en tête, Robert Buron à sa suite. Remplacés par des Indépendants.
En 2025, l’avenir géopolitique de l’Europe est en suspense et toutes les hypothèses sont possibles, dans ce tournant réellement historique où le sujet refait débat comme jamais. Voir le dernier malentendu européen de cet édito.
56. « Les Juifs… un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur » : très commenté dans le contexte de la guerre des six jours, opinion publique déchirée.
« Les Juifs […] étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur. »3037
Charles de GAULLE (1890-1970), conférence de presse, 27 novembre 1967. De Gaulle, volume III (1986), Jean Lacouture
La guerre des Six Jours a commencé à l’aube du 5 juin 1967 : attaque des Israéliens, fulgurante ; défaite des Arabes, humiliante.
L’opinion publique est divisée en France, au-delà des traditionnels clivages gauche-droite. La majorité gaulliste renâcle. Tandis que les intellectuels de gauche sont crucifiés : militants de la cause arabe et de l’anticolonialisme, ils ne peuvent trahir la solidarité sacrée avec le peuple juif victime du génocide et avec le petit État d’Israël.
En préface au numéro spécial des Temps modernes préparé sur le conflit israélo-arabe depuis plus d’un an et qui sort en juillet 1967, Jean-Paul Sartre, qui est encore le maître à penser d’une génération et prend position tranchée sur presque tout, avoue : « Déchirés, nous n’osons rien faire et rien dire. »
Depuis le 7 octobre 2023, la guerre Israël-Hamas, également appelée guerre Israël-Gaza, oppose l’État d’Israël au Hamas, organisation politico-militaire islamiste palestinienne, et à d’autres groupes armés palestiniens. Elle a commencé avec l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et se poursuit avec des bombardements de la bande de Gaza entrepris par Israël, puis avec l’invasion de ce territoire palestinien. Cinquième conflit direct entre Israël et Gaza, la guerre s’inscrit plus largement dans le cadre du conflit israélo-palestinien ou même du conflit israélo-arabe.
L’Histoire s’écrit au jour le jour, cette actualité est naturellement commentée, l’opinion de nouveau divisée, d’autant plus que le conflit ranime un antisémitisme toujours latent. Une réflexion s’impose, entre mille, empruntée à notre Histoire en citations.
« L’Histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. »2660
Paul VALÉRY (1871-1945), Discours de l’histoire (1932)
« Espèce de poète d’État » (dit-il de lui-même), croulant sous les honneurs, il demeure plus que jamais lucide au monde. Cette leçon d’histoire est paradoxalement signée d’un intellectuel qui refuse à l’histoire le nom de vraie science et lui dénie toute vertu d’enseignement, car « elle contient tout, et donne des exemples de tout ». Donc, se méfier des prétendues leçons du passé, d’autant que « nous entrons dans l’avenir à reculons ».
57. « Une « dépression » ? une « pause » à Baden ? » : en Mai 68, toutes les hypothèses pendant quelques heures, l’explication du général… et la clé du mystère en 1969.
« Depuis quelque chose comme trente ans que j’ai affaire à l’histoire, il m’est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. »3072
Charles de GAULLE (1890-1970). De Gaulle, 1958-1969 (1972), André Passeron
Folle journée du 29 mai 1968 : le général a disparu. Conseil des ministres de 10 heures décommandé à la dernière minute. De Gaulle a quitté l’Élysée, mais il n’est pas à Colombey : « Oui ! le 29 mai, j’ai eu la tentation de me retirer. Et puis, en même temps, j’ai pensé que, si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu » (Entretien télévisé avec Michel Droit, 7 juin).
« Une « dépression » ? une « pause » à Baden ? une « manœuvre » difficile à comprendre ? un « chef-d’œuvre tactique » ? Qui, témoin, chroniqueur, analyste, partisan ou adversaire, peut dire le dernier mot sur cet étrange détour vers la Forêt-Noire ? »3073
Jean LACOUTURE (1921- 2015), De Gaulle, volume III. Le souverain (1986)
On l’a su plus tard, le président est allé voir le général Massu en Allemagne. Oui, mais pourquoi ? Dans sa biographie sur de Gaulle, Jean Lacouture confronte les interprétations qui opposent deux écoles : celle du désarroi et celle de la tactique, pour conclure que le mystère demeure.
« Je ne me retirerai pas […] Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l’hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd’hui l’Assemblée nationale. »3074
Charles de GAULLE (1890-1970), Discours radiodiffusé, jeudi 30 mai 1968, 16 h 30. Année politique (1969)
Le transistor est toujours le « cordon ombilical qui relie la France à sa révolution » (Danielle Heymann). De Gaulle ajoute que « partout et tout de suite, il faut que s’organise l’action civique ».
Les élections des 23 et 30 juin 1968 donneront 293 sièges sur 487 à l’UDR (Union pour la défense de la République, c’est-à-dire la majorité gouvernementale) : majorité absolue, triomphe du pouvoir. De Gaulle parle des « élections de la trouille ». Et Viansson-Ponté (Le Monde) du « groupe le plus nombreux qui ait jamais forcé la porte d’une Assemblée française ».
« De la réponse que fera le pays à ce que je lui demande va dépendre évidemment soit la continuation de mon mandat, soit aussitôt mon départ. »3086
Charles de GAULLE (1890-1970), entretien télévisé avec Michel Droit, 10 avril 1969. De Gaulle, volume III (1986), Jean Lacouture
Contre vents et marées, avis et prédictions, alors que l’Assemblée lui assurait une fin de septennat sans histoire, le général a voulu un référendum, annoncé en février : sur la réforme régionale et la réforme du Sénat.
C’est encore une question de confiance entre lui et le pays. Il met tout son poids politique dans la balance, menaçant de partir en cas de non. Tous les partis de gauche font naturellement campagne pour le non, et Valéry Giscard d’Estaing aussi. Pompidou appelle au oui, mais sans vraie conviction. Verdict du 27 avril : 48 % de oui et 52 % de non. Le lendemain, de Gaulle démissionne.
« Cas sans précédent de suicide en plein bonheur. »3087
François Mauriac (1885-1970), à propos du référendum d’avril 1969. De Gaulle, volume III (1986), Jean Lacouture
De Gaulle part en Irlande, pour ne pas être impliqué dans la campagne présidentielle – il votera par procuration. Il retourne ensuite à Colombey, s’enfermer dans sa propriété de la Boisserie pour un dernier face à face avec l’histoire : la rédaction quelque peu désenchantée, quoique sereine, de ses Mémoires d’espoir.
58.« Responsable, mais pas coupable » dans l’« affaire du sang contaminé » : distinction juridique capitale.
« Je suis responsable, mais pas coupable. »3296
Georgina DUFOIX (née en 1943), résumant sa position de ministre des Affaires sociales dans l’affaire du sang contaminé, TF1, 4 novembre 1991
Plus de 6 000 hémophiles ont été contaminés par le virus du sida, entre 1982 et 1985. Le scandale éclate en avril 1991 : un article dans L’Événement du jeudi incrimine le CNTS (Centre national de transfusion sanguine) qui savait le danger, dès 1984. Le dernier procès des trois anciens ministres impliqués date de 1999. Affaire complexe et tragique. L’opinion publique, sensible aux problèmes de santé, est choquée par ce long feuilleton.
La « petite phrase » résumant le système de défense de la ministre a suscité beaucoup de réactions : incompréhension, indignation, injures et diffamation. Pourtant, en droit, il peut y avoir responsabilité sans culpabilité, droit civil et droit pénal ne devant pas être confondus.
59.« Nous ne pouvons pas héberger en France toute la misère du monde » : citation à charge contre son auteur, contraint de contextualiser…
« Nous ne pouvons pas héberger en France toute la misère du monde. »3286
Michel ROCARD (1930-2016), émission « 7 sur 7 », TF1, 3 décembre 1989
Cette phrase le poursuit depuis ce jour, injustement. Vérité d’évidence, dite dans un contexte précis, chiffres à l’appui : le Premier ministre dénonce un détournement du droit d’asile, passant de 18 000 demandes en 1980 à 60 000 en 1989 (doublement en 1988). Il expliquera plus tard : la France, toujours terre d’asile pour les réfugiés politiques, ne peut plus être comme jadis une terre d’immigration pour la main-d’œuvre étrangère. La phrase est reprise sous diverses formes, dans d’autres contextes et par d’autres acteurs politiques, cependant que les socialistes accusent l’un des leurs d’abandonner les valeurs de la gauche.
Rocard va donc préciser, dans la même émission de TF1, le 4 juillet 1993 : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part. » Suite à d’autres dérives et détournements, regrettant le « destin imprévisible » de sa phrase, il en donne une version provisoirement définitive, le 26 septembre 2009, pour le 70e anniversaire de la Cimade (Comité inter mouvements auprès des évacués) : « La France et l’Europe peuvent et doivent accueillir toute la part qui leur revient de la misère du monde. »
60. « La mort cérébrale de l’OTAN » : ce mot mal entendu du président Macron en 2019 prend tout son sens en 2005 avec Trump au pouvoir, le Conseil européen évoquant un « défi existentiel pour l’UE » dans le nouveau désordre mondial.
« Ce qu’on est en train de vivre, c’est la mort cérébrale de l’OTAN. »112
Emmanuel MACRON (né en 1977) à l’hebdomadaire The Economist, cité dans Le Figaro, 7 novembre 2019
Il faut toujours replacer une citation dans son contexte – ici géopolitique. Cette déclaration faisait suite à l’intervention de la Turquie dans le nord de la Syrie, lancée contre l’avis des autres membres de l’OTAN. Elle contredit la doxa officielle faisant de l’Alliance « l’une des plus grandes réussites de l’histoire ».
Avant Macron, le président de Gaulle avait pris ses distances avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), alliance militaire fondée en 1949 et composée de 32 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, créée pour protéger la population et le territoire de ses pays membres – différente de l’ONU qui rassemble tous les pays du monde, visant à améliorer la coopération internationale et à maintenir la paix.
« Vigilia Pretium Libertatis »
« La vigilance est le prix de la liberté »113Devise latine inscrite sur le drapeau de l’OTAN (1951) et précisant la mission de l’Organisation : liberté et sécurité des citoyens de ses pays membres
La France, l’un des membres fondateurs de l’OTAN, a joué un rôle actif dans sa création en 1949, défendant son appartenance à l’Organisation, sur le plan politique et militaire. Mais elle a fréquemment critiqué ses méthodes opérationnelles, notamment le rôle dominant des États-Unis. D’où sa rupture avec l’OTAN sous la présidence du général de Gaulle.
« Il est intolérable à un grand État que son destin soit laissé aux décisions et à l’action d’un autre État quelque amical qu’il puisse être. »2938
Charles de GAULLE (1890-1970), « Une politique sans cesse réaffirmée de 1958 à 1966 », Le Monde, 11 mars 1966
Dans le même esprit : « Il faut que la défense de la France soit française… Un pays comme la France, s’il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort. » Rappelons que c’est aussi un militaire qui parle. Pendant sa guerre de Résistance, il a dû se battre pour être reconnu du grand allié américain.
Sous sa présidence, la France affirme une volonté d’indépendance et une vision de ce que doit être l’Europe incompatibles avec l’hégémonie américaine au sein de l’OTAN, pour tout ce qui touche au nucléaire et à l’intégration des forces armées des pays membres au sein d’un commandement unifié. La France quittera donc l’organisation militaire intégrée de l’OTAN en 1966.
Des accords de coopération entre les forces armées françaises et les forces de l’OTAN sont rapidement signés, ce qui atténue la portée pratique de notre sortie de l’OTAN. Cette coopération renforce le Traité de Paris des présidents Mitterrand et Chirac, jusqu’en 2009, date à laquelle le président Sarkozy réintègre la France au sein du commandement unifié de l’OTAN.
La force de frappe atomique française, clé de voûte du système de défense, combattue du vivant du général de Gaulle, mais populaire dans l’opinion, sera développée par tous ses successeurs. Au XXIe siècle, hors tout contexte de guerre froide avec l’Est communiste, la force de dissuasion nationale n’est pas vraiment remise en question. Elle prend surtout un nouveau sens avec la présidence de Donald Trump.
« Eh bien monsieur, si on ne paie pas et que l’on est attaqués par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?
- Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu’ils veulent. Vous devez payer vos factures. »Donald TRUMP (né en 1946), meeting électoral, 10 février 2024, relatant son dialogue avec le dirigeant d’un État membre de l’OTAN. France-Info, 16 février 2024. L’Europe serait-elle capable d’assurer sa défense seule, sans le soutien des Etats-Unis ?
Certes, un candidat peut toujours se vanter lors d’un meeting électoral. Mais depuis son élection, le président « ne déçoit pas » et confirme au contraire, pour ceux qui douteraient encore. « Make America Great Again » (slogan emprunté à Ronald Reagan), avec une obsession financière.
« S’ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre » a-t-il indiqué à des journalistes depuis la Maison-Blanche, jeudi 6 mars 2025. Les pays membres de l’OTAN « devraient payer plus » pour leurs dépenses militaires, a-t-il martelé, selon l’Agence France-Presse (AFP). « Mon plus gros problème avec l’Otan […] c’est que si les États-Unis avaient un problème et qu’on appelait la France ou d’autres pays que je ne nommerais pas en disant : “On a un problème”, vous pensez qu’ils viendraient nous aider, comme ils sont censés le faire ? Je n’en suis pas sûr… » a également lancé le président républicain.
« Nous sommes des alliés loyaux et fidèles » a répliqué Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet extraordinaire à Bruxelles. Le président français a souligné que la France éprouvait « respect et amitié » pour les États-Unis et leurs dirigeants, et était elle-même « en droit de réclamer la même chose » des Américains. Il a rappelé notamment la contribution du marquis de Lafayette à l’indépendance des États-Unis : « Nous avons toujours été là l’un pour l’autre », évoquant aussi le débarquement des forces américaines en Normandie en 1944. Mais Donald Trump ignore l’Histoire – il veut « simplement » la faire telle qu’il l’entend.
« Un défi existentiel pour l’Union européenne ? »
Conseil européen de l’UE, 6 mars 2025
Cette fois, c’est l’Union européenne qui s’exprime et déplore l’attitude américaine face à la guerre d’Ukraine, après le tumultueux échange à la Maison Blanche entre Donald Trump et le président Volodymyr Zelensky : humiliation en direct et revendication d’un « bon moment de télé » par Trump très à l’aise dans son rôle de showman.
« L’Union européenne est économique, monétaire, politique… Elle n’était pas censée réfléchir en matière de stratégie militaire. Ces responsabilités étaient dévolues à l’Otan. »
Tara VARM (née en 1986), chercheuse invitée à la Brookings Institution, France info, 16 février 2024
Rappel d’une chercheuse invitée qui travaille sur la politique étrangère de la France et de l’Europe, directrice du bureau de Paris du think tank European Council on Foreign Relations (ECFR). Elle est diplômée de Sciences Po Lille et de la SOAS (Londres, Royaume-Uni) en relations internationales et politiques asiatiques.
Mais Trump ne doit pas se sentir concerné par ce genre de recherche et l’Union européenne a réagi dans l’urgence, comme elle pouvait et devait.
« Accélérer la mobilisation des instruments et des financements nécessaires afin de renforcer sa sécurité et la protection des citoyens. »
Conseil européen extraordinaire, 6 mars 2025
Cette mobilisation doit se traduire par une « préparation globale en matière de défense » tant industrielle que technologique et par une augmentation considérable des dépenses de sécurité et de défense. En ce sens, le Conseil attend des propositions de financement de la défense au niveau de l’UE … et prend note de la proposition de la Commission européenne de la constitution d’un budget de 150 milliards d’euros à cette fin.
Le Conseil invite également à avancer sur les travaux de simplification dans différents domaines – au besoin en passant par une législation « omnibus » – afin de supprimer les entraves à « une montée en puissance rapide de l’industrie de la défense ».
« Il faut être capable de dépenser ensemble (…) en parlant d’une seule voix. »
Pierre HAROCHE, spécialiste des questions de sécurité en Europe, Le Monde, 19 janvier 2025
« L’enjeu, c’est la mutualisation et les économies d’échelle. Il sera beaucoup plus efficace de dépenser collectivement de l’argent. (…) On structure alors une industrie de défense, qui sait qu’elle a une visibilité à long terme. »
Ce chercheur note aussi qu’avec la victoire de Donald Trump aux élections américaines en 2024, le monde passe de plus en plus d’une logique géopolitique à une logique géoéconomique. Une fois encore, « Make America Great Again ». À l’Europe de saisir cette occasion pour consolider son recentrage stratégique.
« Le nouveau désordre mondial. »
Titre de la Journée spéciale sur France Inter, 13 mars 2025
Nul doute que l’expression sera sujet de réflexions et prétexte à citations dans cette Histoire qui s’écrit au jour le jour. L’avenir seul pourra dire si nous vivons une forme de Révolution (majuscule) au niveau mondial, et la leçon que nous pourrons en tirer dans quelques années. En évoquant ces mots d’un témoin du passé…
« Il faut avoir le courage de l’avouer, madame, longtemps nous n’avons point compris la révolution dont nous sommes les témoins, longtemps nous l’avons prise pour un événement. Nous étions dans l’erreur : c’est une époque ; et malheur aux générations qui assistent aux époques du monde ! »1626
Joseph de MAISTRE (1753-1821), Lettre à la marquise de Costa, 1794. Joseph de Maistre (1963), Claude-Joseph Gignoux
Lettre écrite après un an d’exil en Suisse, terre d’asile pour beaucoup d’émigrés. Ce philosophe, magistrat et historien, fut d’abord acquis aux idées nouvelles – le roi lui-même n’y était pas hostile. Mais les excès et les dérives le poussent dans le camp des contre-révolutionnaires.
Bien des nobles de cette époque ont dû penser ainsi. Les peuples heureux n’ont pas d’histoire, et la Révolution est et reste l’époque la plus mémorable de l’histoire de France, pour le meilleur et pour le pire, avec un inventaire toujours à suivre.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.