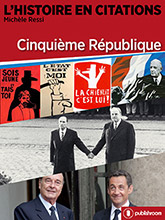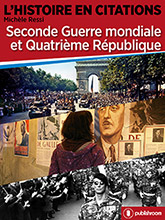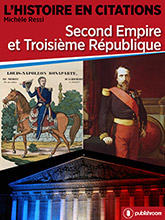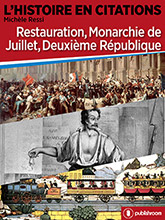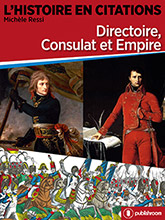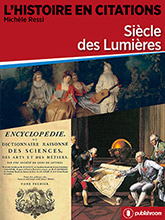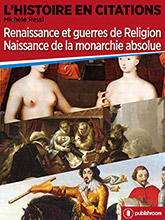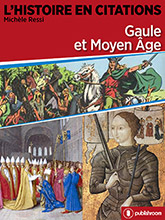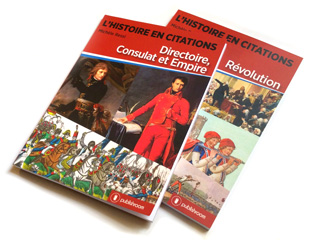« France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? »
JEAN-PAUL II (1920-2005). 1980, une date mémorable
La religion en France, c’est une très longue histoire qui commence avec le baptême de Clovis, premier roi des Francs. Elle passe aussitôt par des luttes de pouvoir et des conflits d’egos qui marquent les mille ans du Moyen Âge, temps des croisades et des cathédrales. Elle déchire la France sous les guerres de Religion et le massacre de la St-Barthélemy (1572), jusqu’à l’édit de pacification de Nantes (1598) qui définit les droits des protestants, mais « crucifie » le pape et nourrit la théorie du régicide, fatal à Henri IV.
L’histoire rebondit sous la monarchie absolue de Louis XIV entre gallicanisme et jansénisme, se précise au Siècle des Lumières et divise les consciences sous la Révolution, pour s’apaiser avec le Concordat de 1801 et le Sacre de Napoléon, mais rebondit pour atteindre un paroxysme de violence entre l’empereur et Pie VII, prisonnier près de cinq ans ! Elle voit naître le catholicisme social au XIXe avec Lamennais, bouleverse l’opinion publique sous la Troisième République et multiplie les manifestations publiques… jusqu’à la séparation des Églises et de l’État dans une France républicaine et laïque depuis 1905. Mais le pape reste une autorité morale et ses prises de position politiques ou sociétales font toujours débat.
Dans l’ensemble sur monde, le pape s’adresse aujourd’hui encore à 1,4 milliard de catholiques. Ses paroles et son charisme personnel constituent sa première arme et font l’essentiel de son pouvoir. Le pape prouve à lui seul la force de la citation dans l’Histoire.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
MOYEN ÂGE
« Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. »77
RÉMI (vers 437-vers 533), à Clovis, baptisé le 25 décembre 496. Histoire des Francs (première impression française au xvie siècle), Grégoire de Tours.
Clovis, comme promis lors de la bataille, va se faire chrétien après la victoire de Tolbiac et 3 000 de ses hommes vont se convertir avec lui. Il est baptisé à Reims, comme tous les rois de France à sa suite. Après qu’il a déposé ses armes et sa cuirasse, Rémi, archevêque de Reims, apôtre des Francs et futur saint, procède à la cérémonie.
Le mot très souvent cité est peut-être apocryphe – Sicambre étant le nom donné à une ethnie des Francs. Il n’en exprime pas moins l’autorité religieuse sur le pouvoir royal, et ce rapport de force moral de l’évêque sur le roi.
La religion va désormais marquer l’histoire de France en maints épisodes, jusqu’à nos jours.
« C’est peu d’être roi quand d’autres le sont ; mais c’est beaucoup d’être catholique quand les autres ne participent pas à cet honneur. »83
GRÉGOIRE Ier, dit le Grand (vers 540-604), Lettre à Childebert II, vers 595. Histoire des Francs (première impression française au XVIe siècle), Grégoire de Tours.
Ces mots du pape à Childebert, fils de Brunehaut et roi d’Austrasie, témoignent de l’ingérence grandissante de la papauté dans les affaires des royaumes barbares.
Né à Rome dans une famille aristocratique profondément chrétienne, ce pape est resté une figure emblématique du christianisme ancien. Avant d’embrasser la vie religieuse, Grégoire a occupé le poste prestigieux de préfet de Rome - la plus haute fonction administrative de la ville. Premier pape à se qualifier lui-même de « serviteur des serviteurs de Dieu » (Servus Servorum Dei), atteint d’arthrite à la fin de sa vie, il meurt à Rome et fut enterré dans la basilique Saint-Pierre. Après 13 ans et 6 mois de bons et loyaux services, Grégoire fut immédiatement reconnu comme un saint.
« Lequel mérite d’être roi, de celui qui demeure sans inquiétude et sans péril en son logis, ou de celui qui supporte le poids de tout le royaume ? »88
PÉPIN le Bref (vers 715-768), Lettre au pape Zacharie, 751. Nouvelle histoire de France (1922), Albert Malet
Le pape Zacharie régna plus de 13 ans sur l’Église. Homme de grande culture, dernier pape d’origine grecque, mais né en Italie (Calabre) et sanctifié comme nombre de papes, il a une grande importance politique, notamment dans le royaume des Francs.
Pépin le Bref (ainsi nommé pour sa petite taille) est maire du palais de Childéric III. Fils cadet de Charles Martel (vainqueur des musulmans à Poitiers), il va s’assurer de l’appui du pape. Il dépose ensuite le dernier roi mérovingien, se fait élire roi au « champ de mai » de Soissons. Il sera sacré en 752 par les évêques, et une seconde fois en 754 (avec ses fils Charles et Carloman) à Saint-Denis par le pape : Étienne II ne régna que deux ans (même pas le temps d’être sacré), mais il interdit aux Grands de se choisir à l’avenir un roi d’une autre lignée. C’est dire l’importance de son rôle pour la future France du Moyen Âge.
En recevant l’onction d’huile sainte (saint chrême) qui fait de lui l’Élu du Seigneur, le Carolingien cesse d’être un laïc et devient à la fois un roi et un prêtre, dont la fonction sera de conduire, par la justice, le peuple de Dieu vers la paix et la concorde. Son fils le futur Charlemagne va faire l’une des plus grandes carrières de l’Histoire, toujours avec l’appui de la religion et du pape.
« À Charles Auguste couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire ! »101
Acclamations en l’honneur de Charlemagne, 25 décembre 800. Encyclopædia Universalis, article « Charlemagne »
La cérémonie est relatée dans les Annales royales, équivalent sous les Francs de nos Archives nationales. Au sommet de sa gloire et de sa puissance, Charlemagne est couronné empereur auguste dans la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape Léon III – l’un des pontificats les plus longs de l’histoire, 20 ans et 5 mois, élu le jour même où son prédécesseur Adrien Ier est enterré.
Ce jour sacré de décembre 800 marque la renaissance de l’Empire romain, d’où naîtra la notion de Saint Empire romain germanique. Alcuin, savant théologien, conseiller de Charlemagne et l’un de ses plus proches collaborateurs, salue en lui « un chef à l’ombre duquel le peuple chrétien repose dans la paix et qui, de toute part, inspire la terreur aux nations païennes, un guide dont la dévotion ne cesse, par sa fermeté évangélique, de fortifier la foi catholique contre les sectateurs de l’hérésie ».
Apothéose personnelle de Charlemagne, cet empire unifié par la langue (le latin), la religion, la justice et l’impôt sera éphémère. En 814, son fils Louis le Pieux lui succède et maintient le prestige et l’unité de l’empire carolingien. Mais à la mort de Louis, ses trois fils vont se partager l’Empire et bientôt se le disputer. D’où guerre, anarchie, misère.
« La foi toujours pure des rois de France […] leur a mérité l’honneur d’être appelés Très Chrétiens et fils aînés de l’Église, par la commune voix de toute la chrétienté. »134
BOSSUET (1627-1704), Abrégé de l’histoire de France
Connu surtout pour ses Sermons et ses Oraisons funèbres, l’évêque de Meaux est également un grand théologien, et quasiment l’oracle de l’Église au xviie siècle. C’est aussi un historien qui montre l’importance de la religion dans l’Histoire.
À ses débuts, la royauté en France s’appuya sur l’Église pour asseoir son autorité. En échange, elle aida l’Église à acquérir un pouvoir temporel, en créant les États pontificaux (pris aux Lombards par Pépin le Bref, donation confirmée par Charlemagne). Les relations entre deux pouvoirs de plus en plus forts et jaloux de leur autorité ne pouvaient se poursuivre sans accrocs, sinon sans drames. Le gallicanisme sera la manifestation la plus policée de ces tensions. La tentative d’enlèvement du pape à Agnani sous Philippe le Bel en sera l’expression la plus violente. Mais les occasions de conflit entre les deux pouvoirs temporels et spirituels sont innombrables. Exemple…
« Le roi de France qui, malgré l’interdiction apostolique, a épousé sa parente, doit se rendre auprès de nous pour nous donner satisfaction, de même que les évêques qui ont autorisé ces noces incestueuses ; s’ils refusent de venir, qu’ils soient privés de la communion. »157
GRÉGOIRE V (973-999), synode à Pavie, 998. Histoires d’amour de l’histoire de France, tome I (1954), Guy Breton.
Nommé pape par son cousin l’empereur Othon III, premier pape germanique et d’origine extérieure à l’Empire romain, chassé de Rome par Crescentius le Jeune qui nomme l’antipape Jean XVI, il revient grâce à l’aide de l’empereur. C’est dire à quel point religion et politique se mêlent.
Le pape qui ne règnera que deux ans fulmine ici contre Robert II le Pieux. Malgré son surnom et sa piété, le roi de France l’a bravé en répudiant sa première femme Rosala qui a vingt-deux ans de plus que lui : un mariage politique et malheureux. Dès la mort de son père, le jeune prince, passionnément épris, épouse sa cousine, la trop belle comtesse de Blois, Berthe de Bourgogne.
C’est l’excommunication, dont les conséquences, à cette époque, peuvent être graves. Le pape ajoute l’anathème, autrement dit la damnation éternelle… Mais il meurt en 999. Son successeur, le moine Gerber, ancien maître du roi, devient pape sous le nom de Sylvestre II : il supprime l’anathème, mais maintient l’excommunication. Le roi devra renvoyer Berthe, en 1001. Il épouse une troisième femme, Constance d’Arles, qui fait de sa vie un enfer ! Berthe, exilée, garde son titre de reine, et les deux amants continuent de se voir. Ils mourront trente ans après, elle d’abord, et lui quelques mois après, inconsolable.
« Dieu a mis au ciel deux grands luminaires : le soleil, et la lune qui emprunte sa lumière au soleil ; sur la terre, il y a le pape, et l’empereur qui est le reflet du pape. »133
GRÉGOIRE VII (vers 1020-1085). Histoire de France, tome II (1833), Jules Michelet.
Ce pape est resté dans l’histoire pour deux raisons qui se tiennent.
Il est le principal artisan de la réforme dire « grégorienne », d’abord en tant que conseiller du pape Léon IX et de ses successeurs, puis sous son propre pontificat. Il veut purifier les mœurs ecclésiastiques (interdiction du mariage des prêtres) et émanciper l’Église du pouvoir temporel. Il lutte contre la « simonie », le trafic des bénéfices et notamment des évêchés, d’où un conflit majeur avec l’empereur du Saint-Empire : Henri IV considère comme relevant de son pouvoir de donner l’investiture aux évêques. Au cours de la « querelle des Investitures », Grégoire VII oblige l’empereur d’Allemagne excommunié à faire une humiliante démarche de pénitence à Canossa (janvier 1077).
Mais cet épisode célèbre ne suffit pas à régler le conflit et Henri reprend l’avantage en assiégeant le pape réfugié au château Saint-Ange. Libéré par les Normands, le pape est chassé de Rome par la population, excédée par les excès de ses alliés. Grégoire VII mourra en exil à Salerne (en Campanie).
« Ils deviendront des soldats, ceux qui, jusqu’à ce jour, furent des brigands ; ils combattront légitimement contre les barbares, ceux qui se battaient contre leurs frères et leurs cousins ; et ils mériteront la récompense éternelle, ceux qui se louaient comme mercenaires pour un peu d’argent. »167
URBAIN II (vers 1042-1099), Concile de Clermont, 1095. Les Croisades (1934), Frantz Funck-Bretano
Pape français, il reste connu pour cet « appel de Clermont » du 27 novembre 1095. Grand orateur, il commence à prêcher la première croisade. Il s’agit d’abord de la « délivrance des Lieux saints » – notamment Jérusalem et le tombeau du Christ – occupés par les musulmans. Le pape encourage cette entreprise militaire, en promettant aux croisés le paradis (indulgence plénière).
Guibert de Nogent, dans son Histoire des croisades, dit l’effervescence qui suivit : « Dès qu’on eut terminé le concile de Clermont, il s’éleva une grande rumeur dans toutes les provinces de France et aussitôt que la renommée portait à quelqu’un la nouvelle des ordres publiés par le pontife, il allait solliciter ses parents et ses voisins de s’engager dans la voie de Dieu. »
« Dieu le veut ! »168
Cri de guerre et de ralliement des croisés, lancé dès la première croisade. Dictionnaire historique, géographique et biographique des croisades (1852), Édouard d’Ault-Dumesnil
Deux expéditions se succèdent, de nature bien différente.
La « croisade populaire » part en 1096, conduite par Pierre L’Hermite et Gautier sans Avoir. Foule de pèlerins à peine armés, indisciplinés, bientôt malades et affamés, ils traversent l’Europe en massacrant les juifs et en pillant pour vivre. Ils seront anéantis en Anatolie.
La croisade des barons part en 1097, forte de 30 000 hommes et de quatre armées qui convergent sur Constantinople, chacune par son chemin. Ces chefs ont pour nom Godefroy de Bouillon, Baudoin de Flandre, Hugues de Vermandois, frère du roi de France, Robert Courteheuse, duc de Normandie, Raymond de Toulouse et Bohémond de Tarente. Une campagne de deux ans les mènera à la prise d’Antioche, d’Édesse et de Jérusalem (1099).
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à soi-même et qu’il prenne sa croix et me suive. »169
JÉSUS (vers 4 av. J.-C.-vers 28). Bible, Nouveau Testament, Évangile de Matthieu
Ces paroles deviennent symbole de ralliement pour les croisés. Elles sont citées par un chevalier croisé, chroniqueur anonyme de la Gesta Francorum.
L’un des grands absents de la première croisade est le roi de France Philippe Ier, excommunié par Urbain II pour avoir répudié Berthe, sa première femme et s’être remarié. Donc, interdit de croisade… Au lieu d’aller guerroyer au loin, il continue d’agrandir le domaine royal par intrigue, donation et achat (Gâtinais, Vexin, Berry).
« La folie des croisades est ce qui a le plus honoré la raison humaine. »170
Léon BLOY (1846-1917), La Femme pauvre (1897)
Catholique ardent, visionnaire et mystique, il encense les croisades que, de son côté, Nietzsche qualifie d’« entreprises de haute piraterie ». Certains témoignages le confirment…
« Si vous désirez savoir ce qu’on a fait des ennemis trouvés à Jérusalem, sachez que dans le portique de Salomon et dans le temple, les nôtres chevauchaient dans le sang immonde des Sarrasins et que leurs montures en avaient jusqu’aux genoux. »177
Lettre au pape Urbain II, après la prise de Jérusalem, 15 juillet 1099. Signée par Godefroy de Bouillon (1061-1100), Raymond de Saint-Gilles (1042-1105), comte de Toulouse, et Adhémar de Monteil (??-1098), légat du pape. Recueil des cours, volume LX (1937), Hague Academy of International Law
La population de Jérusalem fut massacrée par les croisés. Le « temple » (esplanade de l’ancien temple d’Hérode) et les rues de la ville ruisselèrent de sang, selon l’auteur de l’Histoire anonyme de la première croisade.
Les chroniqueurs chrétiens donnent le chiffre de 80 000 morts musulmans.
« Vous avez commandé, et j’ai obéi, et votre autorité a fait que mon obéissance a produit de bons effets ; car j’ai annoncé, j’ai parlé, et il s’est assemblé un nombre infini de gens. Les villes et les villages ne sont plus que des déserts ; et à peine sept femmes y trouvent-elles un seul homme, tant il y a partout de veuves, dont les maris vivent. »180
Bernard de Clairvaux (1090-1153), au pape Eugène III, 1146. Lettres, volume I (1702), Saint Bernard (de Clairvaux), Joseph François Bourgoing de Villefore
Le célèbre cistercien, fondateur de l’abbaye de Clairvaux (1115), prêche la deuxième croisade à Vézelay, à la demande du pape Eugène III (qui n’était pas cardinal – et sera béatifié par Pie IX en 1872).
Immense sera le succès : plus de 100 000 hommes prennent la croix.
Mais l’expédition est une suite de dissensions entre chefs et de défaites militaires. Au cours de cette croisade va éclater la mésentente entre Louis VII et sa jeune épouse Aliénor d’Aquitaine. Le mariage sera finalement annulé et Aliénor épousera en 1152 Henri Plantagenêt (futur roi d’Angleterre), lui apportant son fief d’Aquitaine.
« Les basiliques sont sans fidèles, les fidèles sans prêtres, les prêtres sans honneur, il n’y a plus que des chrétiens sans Christ. »181
Bernard de Clairvaux (1090-1153), pendant sa tournée en Languedoc, 1147. L’Albigéisme aux XIIe et XIIIe siècles (1907), Bibliothèque historique du Languedoc
Moine au monastère de Cîteaux, strict dans sa foi et futur saint, Bernard est surtout préoccupé par la situation de l’Église en France. Il dénonce ses dérives et son luxe, et s’inquiète de l’hérésie cathare, forme de manichéisme venu de l’Europe orientale, qui se développe en Provence et Languedoc dès le milieu du XIIe siècle. Cette (nouvelle) réaction contre la corruption du clergé menace l’Église en tant qu’institution.
« Comment peut-on nettoyer les ordures, si on a soi-même les mains sales. »182
Adage des Parfaits. Histoire de l’Inquisition au Moyen âge : origines de l’Inquisition dans le midi de la France, Cathares et Vaudois (1935), Jean Guiraud
Les « prêtres » cathares dénoncent ainsi « l’indignité » des prêtres catholiques.
L’Église va devoir combattre l’hérésie la plus grave de son histoire, en commençant par la prédication : « La pitié prime la loi. » Le moine Bernard de Clairvaux prêche avec passion, comme d’autres religieux, mais sans succès. La répression suivra : la terrible croisade contre les Albigeois suivra quelques années plus tard - à partir de 1208.
« La dignité royale ne peut être au-dessus des devoirs d’un chrétien. »186
INNOCENT III (1160-1216). Innocent III (1908), Achille Luchaire
C’est le dernier pape élu le jour même de la mort de son prédécesseur.
Le pape charge son légat, Pierre de Capoue, de jeter l’interdit sur le royaume de France et de prononcer l’excommunication personnelle de Philippe II Auguste, en raison de son troisième mariage avec Agnès de Méran.
L’interdit, jeté sur le royaume de France le 13 janvier 1200, suspend toute la vie religieuse du royaume, y compris les baptêmes et les messes ! Il sera levé en septembre, le roi acceptant d’éloigner Agnès et de reprendre sa deuxième femme.
Les papes du Moyen Âge interfèrent beaucoup dans la vie privée des rois de France et cela ne va pas sans conséquences politiques.
« Seigneurs, je vous défends de par le pape de Rome que vous n’attaquiez cette cité ; car elle est cité de chrétiens, et vous êtes pèlerins. »188
Abbé de Vaux (fin XII-début XIIIe s.) aux croisés, 1204. Histoire de la conquête de Constantinople (1870), Geoffroi de Villehardouin, Natalis de Wailly
Ce cistercien veut empêcher les croisés d’enlever la ville de Jadres, pour le compte des Vénitiens. En vain, et la ville est prise, en 1204.
La quatrième croisade (1202-1204) se termine avec la prise de Constantinople par les croisés, sous la conduite de Boniface de Montferrat, Baudoin de Flandre et Geoffroi de Villehardouin.
« Vous n’avez pas réussi comme vous vouliez, mais ce n’est pas le succès que Dieu récompense, c’est le travail […] Insistez, argumentez, implorez, et à force de patience et d’éloquence, ramenez les dévoyés. »189
INNOCENT III (1160-1216), à son légat Pierre de Castelnau, 1204. Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, Jean Guiraud (Bibliothèque historique du Languedoc)
Le pape a envoyé ce moine cistercien en Languedoc, pour ramener les cathares dans la foi catholique. Il a échoué dans sa mission et, découragé, prie le pape de le renvoyer à son monastère, d’où la réponse d’Innocent III, assurant par ailleurs que « l’action vaut mieux que la contemplation ».
« De même que la loi civile punit de mort et de spoliation les criminels coupables de lèse-majesté […] de même l’Église retranche du Christ et dépouille ceux qui, errant dans la foi, attaquent Dieu ou son Fils au détriment plus grave de la majesté divine. »190
INNOCENT III (1160-1216), 1209. Annales du Midi, volume LXXIX (1967), Antoine Thomas, Alfred Jeanroy, Université de Toulouse, Paul Dognon
Le pape dont le pontificat va durer plus de 18 ans justifie ainsi les mesures prises contre les hérétiques cathares. Il n’est plus temps de combattre l’hérésie par la prédication et les voies ecclésiastiques normales ni d’affirmer que « la pitié prime la loi ». D’autant que Pierre de Castelnau, légat du pape, a été assassiné en janvier 1208.
La répression commence : Innocent III appelle à la croisade contre les Albigeois (cathares). Le roi Philippe Auguste, réticent devant cette « croisade de l’intérieur », se contente d’autoriser ses vassaux à y participer.
« Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens ! »191
Arnaud AMAURY (1135-1225), avant le sac de Béziers, 22 juillet 1209. Dialogi miraculorum (posthume), Césaire d’Heisterbach, savant et religieux allemand du XIIIe siècle
Digne des plus sanglantes guerres de Religion, l’ordre est attribué à Amaury (ou Amalric), abbé de Cîteaux et légat du pape, chargé de ramener les dévoyés à la foi catholique. C’est sans doute une invention de Césaire d’Heisterbach, moine qui conta la prise miraculeuse de Béziers par les croisés de Simon de Montfort, dans ses Dialogi miraculorum.
Chef spirituel de la croisade contre les Albigeois, et même s’il n’a pas donné l’ordre, Amaury écrit dans une lettre à Innocent III : « Sans égard pour le sexe et pour l’âge, vingt mille de ces gens furent passés au fil de l’épée. » Catholiques et cathares confondus, et Dieu reconnaîtra les siens…
« Je me suis déjà rendu au Christ. À Dieu ne plaise que je [me] rende maintenant à ses ennemis. »193
Un chevalier croisé, vers 1212. Histoire albigeoise : l’Église et l’État au Moyen Âge (posthume), Pierre des Vaux-de-Cernay, moine et historien contemporain
Surpris par les hommes du comte de Foix (définitivement acquis aux cathares) et assailli de toute part, le chevalier répond par ces mots et meurt, percé de coups.
La croisade contre les Albigeois continue, menée par Simon de Montfort, guerrier hors pair. Venu comme la plupart du nord de la France (famille de barons de Montfort-l’Amaury), il s’est engagé autant par conviction religieuse que par esprit de conquête, un fief étant toujours bon à prendre.
« De deux maux, on doit toujours choisir le moindre. »194
GUILLAUME de Tudèle (fin XIIe-début XIIIe siècle), Chanson de la croisade albigeoise. La Chanson de la croisade contre les Albigeois (posthume, 1879), commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète anonyme.
Le goût du combat et du martyre n’est pas donné à tous. Ainsi, les gens de Castelsarrasin se rendirent aux croisés venus les assiéger (août 1212), empruntant aux bourgeois d’Agen ce précepte devenu proverbe : « Dels dos mals, le mens mal deu om tots temps trier. »
De nombreux seigneurs locaux, privés de leurs biens, font mine de se soumettre. On les appelle « faydits » – fuyards ou dépossédés, en langue d’oc. D’autres se joignent aux hérétiques, et c’est aussi une manière de se rebeller contre Philippe Auguste, ce roi capétien dont l’autorité n’est pas encore reconnue.
La politique se mêle plus que jamais à la religion, la confusion est immense, la situation s’aggrave. Les bûchers succèdent aux massacres, pour le plus grand malheur du Midi de la France qui en garde aujourd’hui encore la mémoire.
« Par égard pour vous, pendant ces huit jours, je cesserai, non pas de faire du mal, mais de faire du bien, car j’estime qu’en combattant les ennemis du Christ, je fais du bien plutôt que du mal. »195
Simon de MONTFORT (vers 1150-1218), au roi d’Aragon, janvier 1213. Histoire albigeoise (1951), Petrus Sarnensis, Pascal Guébin, Henri Maisonneuve
Pierre II d’Aragon soutient Raymond VI, comte de Toulouse, excommunié pour s’être à nouveau rallié aux cathares. Philippe Auguste propose un concile à Lavaur, entre les évêques du Midi et les seigneurs dépossédés par la croisade. D’où cette trêve de huit jours, respectée à regret par Simon de Montfort.
En septembre 1213, il va tuer le roi d’Aragon qui attaque la ville de Muret tenue par les croisés, puis vaincre Raymond VI qui s’enfuit, et prendre Toulouse (1215). Le roi lui donne en fief la ville, mais Toulouse se révolte contre cet homme venu du Nord et qui se conduit ici en pays conquis. Simon de Montfort refait le siège de Toulouse et meurt d’un jet de pierre tiré par une femme (1217). Étrange destinée.
La croisade contre les Albigeois sera relancée par la « croisade royale » qui trouve ainsi le moyen de mettre au pas le Midi rebelle, et l’Inquisition créée par le pape, fondée sur la délation systématique, pour en finir avec les cathares. Jusqu’au dernier îlot de résistance, Montségur, son château et son bûcher de sinistre mémoire (1244).
« Grand péché firent ceux qui lui [à Louis IX] conseillèrent la croisade, vu la grande faiblesse de son corps. »223
Jean de JOINVILLE (vers 1224-1317), Le Livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis (posthume)
Joinville n’est pas de cette dernière aventure, ayant tenté de dissuader le roi de partir avec ses trois fils, persuadé qu’il est plus utile en France, à ses sujets.
Le roi n’écoute pas son ami et conseiller, il s’embarque le 1er juillet 1270 pour la huitième (et dernière) croisade, dans l’espoir de convertir le sultan de Tunisie. Le futur Saint Louis meurt à 56 ans devant Tunis. Son mot de la fin : « Jérusalem. »
Les vertus unanimement reconnues de ce roi conduiront à sa rapide canonisation par le pape Boniface VIII.
« Ce n’est ni un homme ni une bête, c’est une statue. »230
Bernard SAISSET (vers 1232-vers 1311), parlant de Philippe le Bel. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
L’évêque de Pamiers est ami du pape Boniface VIII qui a créé cet évêché pour lui. Le portrait qu’il fait du roi, ennemi déclaré du pape, est fatalement partial. Mais les adversaires de Philippe le Bel l’appelleront souvent « roi de fer » ou « roi de marbre », il doit donc y avoir une part de vérité dans ce portrait.
L’histoire retiendra à son passif trois grandes affaires de nature différente : les manipulations monétaires, son conflit aigu avec la papauté, en attendant le procès fait aux Templiers.
« [Interdiction] à quiconque […] d’oser faire sortir par terre ou par mer, personnellement ou par député, hors du royaume, l’or et l’argent sous quelque forme que ce soit, les armes, les chevaux ou toutes choses servant à la guerre. »232
PHILIPPE IV le Bel (1268-1314), Ordonnance, 17 août 1296. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Ce texte est l’ancêtre de tous les décrets sur le commerce extérieur et le contrôle des changes.
La mesure prise répond à une nécessité impérieuse : le roi a grand besoin d’argent. Il fait la guerre à l’Angleterre, à la suite d’une querelle sur les zones de pêche, et à la Flandre son alliée. Or la guerre coûte cher. Mais le pape prend très mal cette ordonnance…
« Malheureux ! n’oublie pas que, sans l’appui de l’Église, tu ne pourrais résister [aux rois ennemis]. Que t’arriverait-il si, ayant gravement offensé le Saint-Siège, tu en faisais l’allié de tes ennemis et ton principal adversaire ? »233
Boniface VIII (vers 1235-1303), Bulle Ineffabilis amor, 20 septembre 1296. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Le pape s’est cru directement visé par l’ordonnance du 17 août dernier, les ressources venues de France étant nécessaires aux finances pontificales. Il interpelle directement le roi, qui sera à son tour furieux. Épisode d’un long duel… qui embarrasse le clergé de France.
« Nous vous prions de nous accorder d’urgence la permission de fournir au roi la subvention qu’il demande, car nous avons lieu de craindre que la détresse du royaume et chez quelques-uns la mauvaise intention ne poussent les laïcs à piller les biens des églises, si nous ne concourons pas avec eux à la défense commune. »234
Assemblée du clergé, Lettre à Boniface VIII, 1er février 1297. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Prélats et clercs doivent obéissance au pape, mais, pour mériter la protection du roi, ils doivent verser des décimes aux coffres de l’État. Le pape s’incline. C’est le début d’une courte trêve avec le roi de France, au cours de laquelle Louis IX va devenir Saint Louis pour l’histoire.
Les relations vont se tendre à nouveau entre le roi et le pape. Saisset, évêque de Pamiers et ami de Boniface VIII, est emprisonné, accusé de complot et propos injurieux contre le roi. Le pape, homme de caractère, va réagir.
« Écoute, mon très cher fils… »237
Boniface VIII (vers 1235-1303), Bulle Ausculta fili carissime, 11 février 1302. Histoire de France depuis l’établissement des Francs dans la Gaule, volume II (1838), Mathieu-Richard-Auguste Henrion.
Le pape proclame la souveraineté du Saint-Siège sur les rois, thèse soutenue par son ami l’évêque de Pamiers dont il exige la libération. La bulle est lue par l’ambassadeur pontifical, le 11 février 1302, devant le roi et son Conseil.
Soucieux de se concilier l’opinion publique, Philippe le Bel convoque le 10 avril les prélats, les barons et les députés du royaume – donc les trois ordres. Le chancelier Flotte fait un résumé tendancieux de la bulle, à l’instigation du roi qui obtient des États du royaume leur approbation dans sa lutte contre le pape.
« La puissance de mon maître est réelle ; la vôtre est un mot. »238
Pierre FLOTTE ( ??-vers 1302), à Boniface VIII. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Chancelier de Philippe le Bel à partir de 1295 et premier laïc à ce poste, traité par le pape de « petit avocat borgne », puis de « suppôt de Satan », ce grand légiste semble oublier la puissance spirituelle de la papauté… et l’excommunication toujours possible.
Au-delà du conflit religieux et de la manipulation royale, cette première convocation des États du royaume (préfiguration des États généraux) marque une étape dans l’entrée de la bourgeoisie en politique : « Le temps de Philippe le Bel fut une grande époque en France, par l’admission du tiers état aux assemblées de la nation » (Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations).
« Voilà ma tête, voilà mon cou ! Au moins, je mourrai pape. »242
Boniface VIII (vers 1235-1303), Palais du pape, Anagni, 7 septembre 1303. Mémoire à propos de l’affaire du pape Boniface, archives de Guillaume de Nogaret
Le roi, excommunié, a chargé Nogaret, nouveau chancelier, d’enlever le pape, pour le faire comparaître devant un concile qui le déposerait : c’est la malheureuse expédition d’Anagni !
Les envoyés de Philippe le Bel forcent le palais. Le pape, s’attendant à être mis à mort, a revêtu sa chape la plus précieuse, coiffé sa tiare d’or et de pierreries. Il fait front aux agresseurs et traite Nogaret de « fils de cathare ». Nogaret le gifle en le traitant de « patarin » (cathare), et ajoute : « Je veux vous conserver la vie. Et vous serez jugé, bon gré mal gré. À ces fins, je vous arrête en vertu des règles du droit public. » Mais Nogaret ne peut pas arrêter le pape…
« Vive le pape ! Mort aux étrangers ! »243
Cris du peuple d’Anagni, 7 septembre 1303. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1912), Paul Vidal de la Blache, Alexandre Saint-Léger, Alfred Rébelliau
Le peuple de la ville, les paysans alertés, toute une foule cerne le palais en poussant ces cris de menace contre Nogaret, Colonna et leurs hommes. Les Français prennent la fuite… et laissent le pape.
Boniface VIII, 68 ans, épuisé par sa lutte contre le roi de France et bouleversé par les événements d’Anagni, meurt un mois plus tard. Son successeur Benoît XI apaisera le conflit.
Clément V (archevêque de Bordeaux, donc pape français) annule l’excommunication et décide d’installer la papauté avec sa cour à Avignon. Couronné à Lyon, il ne peut rejoindre Rome en proie à la guerre civile…
Le drame de sa vie de pape sera l’affaire des Templiers.
« Boire comme un Templier. »
« Jurer comme un Templier. »249Expressions populaires, au début du XIVe siècle. Le Livre des proverbes français, tome I (1842), Antoine-Jean-Victor Le Roux de Lincy
Dictons toujours cours, même si on en oublie l’origine.
Ils donnent une faible idée des vices, crimes et péchés que la rumeur publique prêtait aux chevaliers. « Le Temple avait pour les imaginations un attrait de mystère et de vague terreur. Les réceptions avaient lieu, dans les églises de l’ordre, la nuit et portes fermées. On disait que si le roi de France lui-même y eût pénétré, il n’en serait pas sorti » (Jules Michelet, Histoire de France).
La rumeur est entretenue par le chancelier Nogaret. Le roi a décidé d’éliminer cet « État dans l’État », car les Templiers ne dépendent que de l’autorité du pape. Il veut aussi récupérer une part de leur fortune – le fameux « trésor ». L’opération secrète sera vite et bien menée. « L’an 1307 le 22 septembre, le roi étant au monastère de Maubuisson, les sceaux furent confiés au seigneur Guillaume de Nogaret ; on traita ce jour-là de l’arrestation des Templiers. »
Le 13 octobre 1307, les Templiers sont arrêtés dans l’enceinte du Temple à Paris, et pareillement saisis dans leurs châteaux en province. Ils n’opposent aucune résistance : l’effet de surprise est total, et la Règle des moines soldats leur interdit de lever l’épée contre un chrétien. Une douzaine a pu fuir ; les autres, environ 2 000, seront livrés à l’Inquisition.
« Que le pape prenne garde […] On pourrait croire que c’est à prix d’or qu’il protège les Templiers, coupables et confès, contre le zèle catholique du roi de France. »254
Pierre DUBOIS (vers 1250-vers 1320), Pamphlet, 1308. La Magie et la sorcellerie en France (1974), Thomas de Cauzons
Avocat à Coutances, il écrit ces mots dans le dessein d’effrayer Clément V. Il conclut en clouant au pilori « les indécis [qui] sont les nerfs des testicules du Léviathan » ! Une image propre à faire trembler un pape hésitant par nature, bien embarrassé par l’affaire, et par ailleurs malade.
Le pape s’était mollement et tardivement ému du destin des Templiers, leur redonnant quelque espoir en février 1308 : il suspend l’action des inquisiteurs et annule les procédures engagées par Philippe le Bel. Fureur du roi ! Et riposte. Pierre Dubois, avocat du roi, écrit donc à sa demande et le chancelier Nogaret manœuvre en coulisses.
Clément V, Français d’origine, se soumet bientôt à la volonté royale et abandonne les Templiers à leur sort, demandant seulement qu’on y mette les formes, d’un point de vue juridique. Il y aura donc un nouveau procès, et quelques bulles… Les Templiers qui ont avoué en 1307 vont se rétracter, au risque du bûcher. « J’ai reconnu quelques-unes de ces erreurs, je l’avoue, mais c’était sous l’effet des tourments. J’ai trop peur de la mort », ajoute Aymeri.
« Vox clamantis. » « La voix qui crie. »257
CLÉMENT V (vers 1264-1314), Bulle pontificale qui dissout l’ordre des Templiers, 3 avril 1312. Les Templiers (1963), Georges Bordonove
Acte juridique lu à l’ouverture de la deuxième session, au concile de Vienne : l’ordre a fini d’exister.
Notons que l’expression « Vox clamantis (in deserto) » – soit « La voix qui crie (dans le désert) » – est la réponse de Jean-Baptiste aux envoyés des Juifs venus lui demander « Qui es-tu ? » (Bible, Nouveau Testament, Évangile de Jean, 1, 23).
Par la bulle Ad providam du 2 mai, les biens des Templiers sont transmis aux Hospitaliers. Le roi, sous prétexte de dettes, en a déjà prélevé la plus forte part possible, mais le fameux « trésor » demeure introuvable.
Une trentaine de Templiers rejoignent dans le supplice les deux principaux dignitaires, Jacques de Molay, le grand maître de l’Ordre, et Geoffroy de Charnay, le précepteur : après quatre ans de prison et de silence, ils ont proclamé leur innocence et dénoncé la calomnie, à la lecture publique de l’ultime sentence du 19 mars, sur le parvis de Notre-Dame, face à la foule amassée. C’est comme si le courage leur revenait soudain. Après sept ans d’« affaire des Templiers », le roi qui veut en finir a ordonné l’exécution groupée des plus « suspects », le soir même.
« Clément, juge inique et cruel bourreau, je t’ajourne à comparaître dans quarante jours devant le tribunal du souverain juge. »259
Jacques de MOLAY (vers 1244-1314), sur le bûcher dans l’îlot aux Juifs, île de la Cité à Paris, 19 mars 1314. Histoire de l’Église de France : composée sur les documents originaux et authentiques, tome VI (1856), abbé Guettée
Dernières paroles attribuées au grand maître des Templiers. Ce « mot de la fin » est l’un des plus célèbres de l’histoire, pour diverses raisons.
Quarante jours plus tard, le 20 avril, Clément V meurt d’étouffement, seul dans sa chambre à Avignon, comme aucun pape avant lui, ni après.
« Chers et bien-aimés, Je vous ai écrit par deux fois d’élire maître Auger de Brie, mon conseiller. Vous n’en avez rien fait. Aussitôt ces lettres lues, élisez-le, car pour rien je ne souffrirais qu’un autre eût l’évêché que notre dit conseiller. Si l’un de vous s’y oppose, je lui ferai vider le royaume. »383
LOUIS XI (1423-1483), aux chanoines d’Angers, 13 mai 1479. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Bel exemple de pression du roi sur son clergé. Sous Charles VII, la Pragmatique Sanction de Bourges (1438) permit au roi d’intervenir pour recommandation dans l’élection des abbés et des évêques. En fait, le roi contrôle l’Église de France et le pape lutte contre ce gallicanisme qui porte ombrage à son autorité.
Louis XI, qui n’a pas appliqué la Pragmatique dans son Dauphiné l’abroge à son avènement. Notre roi est assez retors pour vouloir à la fois se mettre en bons termes avec le pape Sixte IV et réduire son clergé à l’obéissance.
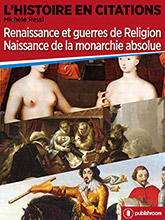 RENAISSANCE et GUERRES DE RELIGION
RENAISSANCE et GUERRES DE RELIGION
« Les Français veulent faire de moi le chapelain de leur roi, mais j’entends être pape et le leur montrerai par des actes. »433
JULES II (1443-1513), en 1510. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
Le 214e pape, dit le Terrible pour son énergie, est également malin, voire machiavélique, et les rois de France (avec leurs conseillers) seront jusqu’à la fin les cocus de cette comédie italienne à épisodes et imbroglio.
Pas assez fort pour chasser d’Italie les « barbares », Jules II les a utilisés. II s’est allié à Louis XII contre Venise (Ligue de Cambrai, 1508), puis s’allie à présent avec Venise contre Louis XII : c’est la Sainte Ligue, le 24 février 1510. En fait, c’est la coalition de toute l’Europe occidentale contre la France !
« Le Turc qu’il veut attaquer, c’est moi ! »434
LOUIS XII (1462-1515). Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1901), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Le roi comprend et note, non sans humour, qu’il est devenu la « tête de Turc » du pape, les Ottomans étant toujours une menace virtuelle, capable de fédérer tous les souverains d’Europe.
Jules II est aussi connu pour son tombeau sculpté par Michel Ange à la Basilique papale San Pietro de Rome… Il déteste le roi de France et va l’excommunier en 1511. Cette quatrième guerre d’Italie se termine après la mort du « Terrible » et l’élection d’un pape pacifique, Léon X. Ni vaincu ni vainqueur, au traité de Dijon (septembre 1513) non ratifié par Louis XII, mais du moins y a-t-il réconciliation entre le pape et le roi de France, en janvier 1514.
Le seul avantage de ces guerres d’Italie est d’importer peu à peu la Renaissance italienne en France, pour le plus grand bien de notre art de vivre et de nos beaux-arts.
« Le soleil chauffe pour moi comme pour les autres et je désire fort voir le testament d’Adam pour savoir comment celui-ci avait partagé le monde. »473
François Ier (1494-1547), Déclaration à Charles Quint en 1540. Histoire de la France : dynasties et révolutions, de 1348 à 1852 (1971), Georges Duby
En Europe, les deux grands rivaux font trêve pour un temps. Charles Quint, perpétuel voyageur à travers ses États, se vante d’avoir un empire sur lequel « le soleil ne se couche jamais » et rêve de restaurer l’empire de Charlemagne – chose impossible, avec la nouvelle géopolitique de la Renaissance et l’avènement des nations modernes.
François Ier, de son côté, refuse la ligne de partage du monde, établie en 1493 par les Espagnols et les Portugais, confirmée en 1494 par une bulle du pape Alexandre VI jouant les arbitres entre ces deux peuples conquérants et catholiques. Il veut profiter des richesses de l’Amérique découverte par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. C’est aussi une façon de s’opposer à l’hégémonie de Charles Quint, devenu roi d’Espagne. François Ier encourage donc les marins français à se lancer dans de lointaines expéditions et les pilotes étrangers à « naviguer sur la mer commune » au service des armateurs français.
« Madame, contentez-vous d’avoir infecté la France de votre infamie et de votre ordure, sans toucher aux choses de Dieu. »482
Un domestique du tailleur d’Henri II, s’adressant à Diane de Poitiers (1550). Histoire de France au seizième siècle, Guerres de religion (1856), Jules Michelet
Le ton dit assez la violence des haines qui couvent. L’homme est interrogé sur son éventuelle conversion au calvinisme par Diane de Poitiers, la maîtresse du roi qui encourage la répression du protestantisme. Il paiera de sa vie cette phrase, sitôt condamné à être brûlé vif devant Henri II, spectateur du supplice.
Envers et contre tout, l’Église réformée de France va se constituer sous ce règne.
« Il n’était fils de bonne mère qui n’en voulût goûter. »493
Blaise de MONLUC (1502-1577), Commentaires (posthume)
Soldat à 16 ans sous les ordres du chevalier Bayard, servant sous quatre rois successifs avec sa fière devise « Deo duce, ferro comite » (« Dieu pour chef, le fer pour compagnon »), fait maréchal de France à 72 ans, couvert de gloire et de blessures, Monluc reste fidèle à la religion catholique et s’indigne en 1559 de voir les seigneurs de France embrasser le calvinisme.
Ainsi Louis Ier, prince de Condé (futur chef du parti protestant contre les Guise) et trois neveux du connétable de Montmorency, le plus célèbre étant l’amiral Gaspard de Coligny. Pour Monluc, militaire gascon pur et dur, tout protestant est un rebelle, un ennemi du roi : c’est pour cette trahison et non par fanatisme religieux qu’il participera à la répression, durant les guerres de Religion. Il s’en justifie dans ses Commentaires, « bible du soldat » selon Henri IV, document clair et précis sur l’histoire politique et militaire du xvie siècle.
« Fille pire que sa mère, qui avait gâté son mari et infesté toute la maison de Vendôme. »494
PAUL IV (1476-1559), peu avant sa mort. Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret (1882), baron Alphonse de Ruble
Le pape parle de Jeanne d’Albret, fille de Marguerite de Navarre – sœur de François Ier qui protégea les artistes, les humanistes et les protestants. La nouvelle reine de Navarre entraîne son époux, le très indécis Antoine de Bourbon (duc de Vendôme) et son royaume de Navarre à suivre Calvin le protestant. Elle professe publiquement la nouvelle religion en 1560 et l’impose en 1567. Entre-temps, Antoine de Bourbon, nommé lieutenant général du royaume, se retrouve combattant avec les Guise, à la tête des armées catholiques.
« La mauvaise femme est morte. »518
Antonio Maria SALVIATI (1537-1602), nonce apostolique, au pape Grégoire XIII. Correspondance du nonce en France, Antonio Maria Salviati : 1572-1578 (1975)
Telle est l’oraison funèbre de Jeanne d’Albret, morte à Paris le 9 juin 1572. Femme de tête et de conviction protestante, cette reine de Navarre sut préserver l’indépendance de son royaume. Mais en professant publiquement le calvinisme, puis en imposant cette religion à la Navarre, elle est devenue la mortelle ennemie des papes de Rome.
« Si Monsieur le pape fait trop la bête, je prendrai moi-même Margot par la main et la mènerai épouser en plein prêche ! »519
CHARLES IX (1550-1574), 1er août 1572. Cité par Voltaire (Œuvres complètes) et au siècle suivant par Alexandre Dumas (La Reine Margot), entre autres sources
Le roi s’impatiente, le pape tardant à donner sa dispense pour le mariage de sa sœur avec Henri de Navarre, protestant. Il espère, comme son conseiller Coligny, que cette union sera gage de réconciliation, après la paix de Saint-Germain qui mit fin à la troisième guerre de Religion.
La très belle et raffinée Marguerite de France (ou de Valois), 19 ans, est éprise du très ambitieux Henri, duc de Guise, dit le Balafré, chef de file des catholiques, et partisan de la guerre à outrance contre les protestants. La voilà donc forcée, et d’abord par sa mère Catherine de Médicis, d’épouser ce souverain d’un petit royaume, homme rustique et jovial, sentant le gousset (ail) et d’allure peu royale. Le mariage sera annulé en 1599 : pour défaut de consentement de la mariée, et consanguinité (entre cousins). Il va surtout déclencher la quatrième guerre de Religion.
« Les Parisiens se mettent au pillage avec une extraordinaire avidité : bien des gens ne s’étaient jamais imaginé qu’ils pourraient posséder un jour les chevaux et l’argenterie qu’ils ont ce soir dans les mains. »528
Antonio Maria SALVIATI (1537-1602), nonce apostolique, lettre au pape Grégoire XIII. Correspondance du nonce en France, Antonio Maria Salviati : 1572-1578 (1975)
Salviati est Florentin et cousin de Catherine de Médicis. Il a bien intrigué pour se faire envoyer à la cour de France. Arriver en cette année 1572 fait de lui un témoin privilégié d’une page d’histoire qui concerne par ailleurs le pape, même si le Saint-Siège n’est pour rien dans le massacre ! La correspondance de Salviati est un modèle d’ordre et de régularité. Une source précieuse pour les historiens, avec une partialité somme toute logique en faveur des catholiques. Par ordre du gouvernement, la tuerie va s’étendre à tout le royaume.
Cette paix mécontente les ultra-catholiques. Des ligues de défense de la religion se créent en Picardie, puis un peu partout, bientôt unies en Ligue (Sainte Ligue ou Sainte Union), derrière le duc de Guise, avec l’appui du pape et du roi Philippe II d’Espagne. Et la sixième guerre de Religion commence.
« Je veux peindre la France une mère affligée,
Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée. »545Agrippa d’AUBIGNÉ (1552-1630), Les Tragiques (1616)
Témoin à 8 ans des horreurs de la guerre civile qui commence à déchirer le pays et jurant à son père calviniste de venger les pendus d’Amboise en 1560, il mourra à 78 ans, sous le règne de Louis XIII.
Combattant aussi farouche l’épée ou la plume à la main, il entreprend cette épopée de la foi en 1577 – long poème de sept livres, publié en 1616, quand le fond et la forme en apparaîtront totalement anachroniques. Cri de haine contre les catholiques, hymne à la gloire des protestants, chant d’amour à la France incarnée en femme.
Cette année 1577, la France vit sa sixième guerre de Religion. Parti catholique et parti protestant se sont également renforcés, structurés, au point que nul ne peut vraiment l’emporter. La paix de Bergerac ne sera que provisoire.
« Pensant à cela et tenant ma tête appuyée sur ma main, l’appréhension des maux que je ressentis pour mon pays fut telle qu’elle me blanchit la moitié de la moustache. »555
HENRI III DE navarre (1553-1610) au duc de La Force. Henri IV ou la France sauvée (1943), Marcel Reinhard
Parole du futur Henri IV, quand il apprend la volte-face du roi : une nouvelle guerre civile est imminente. De surcroît, pour conforter la Ligue et le roi, le 225e pape, Sixte Quint, excommunie « Henri jadis roi de Navarre » : comme relaps, pour s’être converti à la Saint-Barthélemy (contraint, « la messe ou la mort »), et avoir ensuite abjuré.
La huitième et dernière guerre de Religion sera la plus longue : treize années. Baptisée la guerre des trois Henri, elle oppose le roi de France Henri III, Henri III de Navarre (bientôt Henri IV), et Henri de Guise, le Balafré, chef incontesté de la Ligue. Elle commence en 1585, par une série de batailles dont aucune n’est décisive et les alliances vont changer, entre les forces en présence. Aucun des trois Henri ne mourra au combat, mais chacun sera victime d’un assassinat, dont deux relevant du régicide.
« À présent, je suis roi. »568
HENRI III (1551-1589) : billet adressé au légat du pape et écrit de sa main, qui commence par ces mots. Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1911), Ernest Lavisse, Paul Vidal de La Blache
Il annonce à Sixte Quint (grand bâtisseur de Rome) l’assassinat du duc de Guise et de son frère. Le pape répond en excommuniant le roi de France !
Henri III va se battre encore quelques mois avant de subir le même sort. À la nouvelle du drame de Blois, Paris se soulève. Un autre Guise, frère cadet d’Henri, Charles de Lorraine, duc de Mayenne, prend la tête de la Ligue et le pouvoir à Paris. Il s’autoproclame lieutenant général du royaume. Le roi tente de « recoudre ».
« Ah ! le méchant moine, il m’a tué, qu’on le tue ! »573
HENRI III (1551-1589), Saint-Cloud, 1er août 1589, « premier mot de la fin ». Mémoires relatifs à l’histoire de France, Journal de Henri III (posthume), Pierre de l’Estoile
Au château de Saint-Cloud, le roi prépare le siège de Paris avec Henri de Navarre : 30 000 hommes sont prêts à attaquer la capitale, défendue par la milice bourgeoise et la Ligue, armée par Philippe II d’Espagne.
Dominicain de 22 ans, ligueur fanatique, Jacques Clément préparait son geste : le complot est connu, approuvé de nombreux catholiques et béni par le pape Sixte Quint. Le moine réussit à approcher le roi – seul, sur sa chaise percée. La garde personnelle (les Quarante-Cinq), alertée par les cris du roi poignardé, transperce l’assassin à coups d’épée : défenestré, le corps est sitôt tiré par quatre chevaux, écartelé, et brûlé sur le bûcher, pour régicide.
La scène se rejouera avec Ravaillac et Henri IV. Ces assassinats, comme tous les complots et attentats contre les rois de l’époque, s’inspirent de la théorie du tyrannicide, dont Jean Gerson fut l’un des prophètes : « Nulle victime n’est plus agréable à Dieu qu’un tyran. »
NAISSANCE DE LA MONARCHIE ABSOLUE
« Si j’avais deux vies, j’en donnerais volontiers une pour satisfaire Sa Sainteté. N’en ayant qu’une, je dois la garder pour son service et l’intérêt de mes sujets. »610
HENRI IV (1553-1610), au pape Paul V. Histoire de France au dix-septième siècle, Henri IV et Richelieu (1874), Jules Michelet
Henri IV est sans convictions religieuses bien marquées, faisant passer avant tout la pacification du royaume et la restauration de l’autorité royale.
Le pontificat du pape Paul VI est marqué par une application stricte du droit canonique. Lui-même est reste célèbre pour avoir achevé la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a également fondé les archives secrètes du Vatican.
« Hérétique point ne seras
De fait ni de consentement.
Tous tes péchés confesseras
Au Saint Père dévotement […]
En ce faisant te garderas
Du couteau de frère Clément. »635Les Commandements d’Henri (1597). Petites ignorances historiques et littéraires (1888), Charles Rozan
Les prétendus commandements sont au nombre de dix, dans ce pamphlet papiste en forme de parodie. Rappelons que frère Clément fut l’assassin d’Henri III.
La conversion d’Henri IV semble suspecte aux ultra-catholiques, plus chrétiens que le pape Clément VIII qui finit par lui accorder son absolution (septembre 1595), incitant Mayenne (gouverneur de Bourgogne) et la maison de Lorraine à faire la paix avec le roi. Le maréchal de Joyeuse (gouverneur du Languedoc) et le duc d’Épernon (gouverneur de Provence) ont suivi, obtenant leur grâce et se soumettant, moyennant finances ou avantages personnels. Henri IV sait pardonner – en bon politique plus encore qu’en bon chrétien.
« Cela me crucifie ! »640
CLÉMENT VIII (1536-1605), à l’annonce de la signature de l’édit de Nantes, 1598. Les Réactions du Saint-Siège à l’édit de Nantes (1998), Bertrand Haan
Le pape est devenu l’allié d’Henri IV depuis sa conversion en 1594 – une messe pour une couronne de Roi Très Chrétien. Il lui a donné son absolution en 1595. Mais le 229e pape ne peut approuver l’édit de Nantes : « C’est le plus mauvais édit qui se puisse imaginer. »
Il ne faut pas y voir une manifestation d’intolérance. Plutôt la parole d’un homme passionné, horrifié par les progrès de ce qu’il considère comme une hérésie en France – fille aînée de l’Église depuis le baptême de Clovis et pays où prévaut l’adage « Une foi, une loi, un roi ».
Il n’a pas été tenu au courant des négociations, ni de l’enregistrement par le Parlement. Le clergé fait chorus, les universités condamnent aussi l’édit et Henri IV doit lutter encore deux ans pour arracher leur consentement à tous les Parlements de France, cependant que des prédicateurs zélés menacent des flammes de l’enfer les magistrats trop tolérants !
« J’ai sauté sur des murailles de ville, je sauterai bien sur des barricades. »645
HENRI IV (1553-1610), Déclaration au Parlement, 7 janvier 1599. Mémoires relatifs à l’histoire de France, Journal de Henri IV (posthume), Pierre de l’Estoile
Le Parlement de Paris n’a toujours pas approuvé l’édit de Nantes. Et le roi fait pression devant lui pour obtenir la ratification, indispensable pour que l’édit ait force de loi dans le royaume : « Je couperai la racine à toutes ces factions et à toutes ces prédications séditieuses, faisant accourcir tous ceux qui les suscitent. J’ai sauté sur des murailles de villes, je sauterai bien sur des barricades. Ne m’alléguez point la religion catholique ; je l’aime plus que vous, je suis plus catholique que vous : je suis le fils aîné de l’Église, nul de vous ne l’est ni ne peut l’être. Vous vous abusez si vous pensez être bien avec le pape ; j’y suis mieux que vous. Quand je l’entreprendrai, je vous ferai tous déclarer hérétiques, pour ne vouloir pas obéir. »
Ce n’est que le 25 février 1599 que les parlementaires parisiens enregistrent l’édit, non sans en avoir renégocié le texte, qui passe de 95 à 92 articles. Les parlements de province le ratifient pour la plupart en 1600, et le parlement de Rouen ne cède qu’en 1609.
La paix religieuse étant rétablie après l’édit de Nantes, le roi va tenter de restaurer l’autorité royale avec une détermination imagée, qui est bien dans sa nature : « Je couperai la racine à toutes les factions et à toutes les prédications séditieuses. » Mais le roi mourra assassiné le 14 mai 1610 par Ravaillac. Le régicide sera écartelé, après avoir été torturé : il affirma avoir agi seul. Sully, dans ses Mémoires, n’y croit pas. Le mystère demeure, sur la mort d’Henri IV le Grand. C’est l’une des grandes énigmes de l’histoire de France.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.