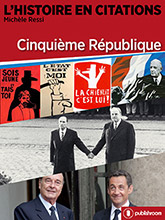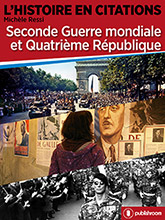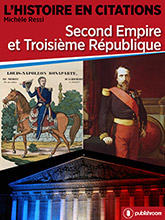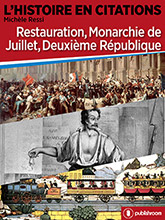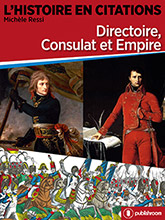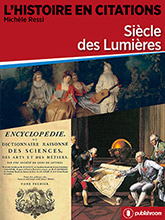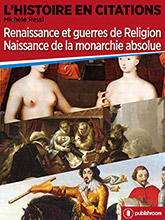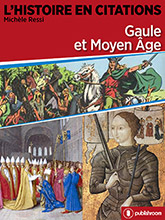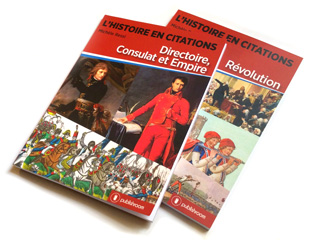« France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? »
JEAN-PAUL II (1920-2005). 1980, une date mémorable
La religion en France, c’est une très longue histoire qui commence avec le baptême de Clovis, premier roi des Francs. Elle passe aussitôt par des luttes de pouvoir et des conflits d’egos qui marquent les mille ans du Moyen Âge, temps des croisades et des cathédrales. Elle déchire la France sous les guerres de Religion et le massacre de la St-Barthélemy (1572), jusqu’à l’édit de pacification de Nantes (1598) qui définit les droits des protestants, mais « crucifie » le pape et nourrit la théorie du régicide, fatal à Henri IV.
L’histoire rebondit sous la monarchie absolue de Louis XIV entre gallicanisme et jansénisme, se précise au Siècle des Lumières et divise les consciences sous la Révolution, pour s’apaiser avec le Concordat de 1801 et le Sacre de Napoléon, mais rebondit pour atteindre un paroxysme de violence entre l’empereur et Pie VII, prisonnier près de cinq ans ! Elle voit naître le catholicisme social au XIXe avec Lamennais, bouleverse l’opinion publique sous la Troisième République et multiplie les manifestations publiques… jusqu’à la séparation des Églises et de l’État dans une France républicaine et laïque depuis 1905. Mais le pape reste une autorité morale et ses prises de position politiques ou sociétales font toujours débat.
Dans l’ensemble sur monde, le pape s’adresse aujourd’hui encore à 1,4 milliard de catholiques. Ses paroles et son charisme personnel constituent sa première arme et font l’essentiel de son pouvoir. Le pape prouve à lui seul la force de la citation dans l’Histoire.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
SIÈCLE DE LOUIS XIV
« Vous retrouverez Dieu et Port-Royal partout. On n’est jamais seule quand on a la foi. »865
Henry de MONTHERLANT (1895-1972), Port-Royal (1954)
Ainsi fait-il parler sœur Françoise, tentant de réconforter sœur Angélique quand il leur faut quitter l’abbaye de Port-Royal des Champs.
L’action de la pièce, située en 1664, respecte parfaitement l’histoire : le pape Alexandre VII, l’Église, les tout-puissants jésuites ont condamné le jansénisme, et Louis XIV veut la soumission de la « secte ». Mais douze sœurs refusent de signer le Formulaire (adhésion « de cœur et d’esprit » à la condamnation par le pape des Cinq Propositions extraites de l’Augustinus, traité de théologie de Jansénius à l’origine de la controverse).
Les sœurs, chassées de leur monastère, sont dispersées dans d’autres institutions. Une première série d’expulsions a eu lieu en 1661. Le même scénario se reproduit en 1709, plus dramatique encore : expulsion des dernières sœurs de Port-Royal, l’abbaye étant rasée en 1711.
« Nous sommes si étroitement attachés à Votre Majesté que rien n’est capable de nous en séparer. »887
Assemblée générale du clergé, Déclaration de 1680. « Les Assemblées du clergé en France sous l’ancienne monarchie », Alfred Maury, Revue des deux mondes, 1880
Cette fois, la guerre est religieuse et se joue entre Louis XIV et le Saint-Siège. Elle a commencé en 1673 et durera vingt ans.
Louis XIV, roi de droit divin, tenant son pouvoir de Dieu seul, estime avoir des droits sur les biens de l’Église. Pressé par les nécessités de la guerre (de Hollande), il a étendu de son propre chef le droit de « régale » à tous les diocèses : autrement dit, en cas de vacance et jusqu’à l’installation d’un nouvel évêque, il touche les revenus du temporel. Innocent XI, 240e pape, s’y oppose, mais le clergé de France (hormis quelques jansénistes) est du côté du roi, dans l’affaire de la régale. Le haut clergé, où se trouvent en grand nombre amis et parents de ministres, se montre même d’une remarquable servilité.
« Les papes n’ont reçu de Dieu qu’un pouvoir spirituel. Les rois et les princes ne sont soumis dans les choses temporelles à aucune puissance ecclésiastique. »888
BOSSUET (1627-1704), Déclaration des Quatre Articles, 19 mars 1682
Votée par l’assemblée générale extraordinaire du clergé : l’ingérence du pape dans les affaires de l’Église de France est considérée comme une violation du concordat de 1516 et les libertés de l’Église gallicane sont officiellement proclamées. L’obscurité de certains passages doit être volontaire : il faut éviter l’irréparable, le schisme, la rupture avec Rome, dans une France profondément catholique.
Louis XIV, satisfait de son clergé, érige aussitôt cette Déclaration en loi.
« Nous improuvons, déchirons, cassons tout ce qui a été fait dans cette assemblée pour l’affaire de la Régale. »889
INNOCENT XI (1611-1689), Déclaration du 17 avril 1682. Histoire de France illustrée depuis les origines jusqu’à la Révolution (1900-1912), Ernest Lavisse
Furieux, le pape condamne tous les édits relatifs au droit de régale, avant de refuser l’investiture canonique aux évêques désignés par Louis XIV. Les relations s’enveniment encore en 1688, pour s’apaiser l’année suivante avec Alexandre VIII, le 241e pape, Louis XIV renonçant de son côté à l’application de la Déclaration des Quatre Articles en 1693.
« La Chamilly est si touchée
Des grands plaisirs du Paradis,
Qu’après sa prière achevée,
Elle a dit à son favori :
Pour mon corps, je vous l’abandonne,
Mon âme étant mon seul souci,
Et lorsque à Dieu son âme on donne,
On peut donner le reste à son ami. »919Sur une dame quiétiste (1698), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Le quiétisme, doctrine mystique du « pur amour », prône une contemplation passive, au détriment de la pratique religieuse : l’âme imprégnée de Dieu, en état de « quiétude » et d’oraison, ne saurait pécher, même si le corps semble enfreindre les commandements.
Cette hérésie venue d’Espagne, répandue en France par Mme Guyon, est soutenue par Fénelon, séduit par cet amour désintéressé de Dieu. Mme de Maintenon s’y met, et tout Saint-Cyr aussi. Inutile de préciser que le pape Innocent XII condamne cette doctrine !
« Si Bossuet touchant le pur amour
À Fénelon est si contraire
Il parle en évêque de Cour
Qui ne connaît que l’amour mercenaire. »920Bossuet et Fénelon (1698), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Louis XIV charge Bossuet d’enquêter sur le quiétisme décidément trop à la mode. Strict légaliste, Bossuet craint que cette doctrine ne détourne les croyants de la pratique religieuse et des dogmes, pour aboutir au déisme.
En vertu de quoi il condamne l’hérésie dans sa Relation sur le quiétisme (1698). Fénelon réplique, et les deux prélats jadis amis s’opposent publiquement. Bossuet l’emporte. Le pape Innocent XII condamne Fénelon dont Louis XIV précipite la disgrâce.
« Les jansénistes, voulant faire des saints de tous les hommes, n’en trouvent pas dix, dans un royaume, pour faire des chrétiens tels qu’ils les veulent. »938
Saint-Évremond (vers 1615-1703), Conversation de M. d’Aubigny avec M. de Saint-Évremond (1662). Œuvres mêlées de Saint-Évremond (1706)
C’est parole de libertin réfugié à Londres.
En fait, le jansénisme est l’une de ces affaires religieuses qui empoisonnent le siècle de Louis XIV. Les derniers actes sont dramatiques en cette fin de règne : ultime expulsion des sœurs de Port-Royal (1709), abbaye rasée (1711), condamnation par Clément XI, le 243e pape, qui divise le clergé français. La suite et fin se jouera au siècle des Lumières.
SIÈCLE DES LUMIÈRES
« Qu’est-ce qu’un cardinal ? C’est un prêtre habillé de rouge qui a cent mille écus du roi, pour se moquer de lui au nom du pape. »960
CHAMFORT (1740-1794), Pensées, maximes et anecdotes (posthume, 1803)
En fait, le clergé reste l’un des fondements de l’Ancien Régime, et sans doute le plus profondément loyaliste.
Mais la religion est contestée dans son ensemble, ébranlée par la philosophie nouvelle et souvent déconsidérée par diverses pratiques et querelles, cependant que le haut clergé (tous les évêques sont nobles après 1760) a des préoccupations plus laïques que religieuses.
« On a déjà dit que le pape était le meilleur cuisinier qu’il y eut, qu’il avait fait d’un maquereau un rouget. »1087
Edmond Jean-François BARBIER (1689-1771), Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV (posthume, 1866)
Témoin du temps, avocat au Parlement de Paris, il note tout, de la plus petite à la plus grande histoire, et pendant plus de quarante ans, dans cette Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1763), ou Journal de Barbier - autres noms pour ce document où l’auteur s’efface devant l’événement.
Il prend acte de l’accès au cardinalat de l’abbé Dubois, le 16 juillet 1721. L’abbé est passé de sous-diacre à archevêque de Cambrai en quelques semaines - ordonné prêtre la veille. « Ne pourrait-on pas aussi lui donner le baptême ? » demandent les mauvais plaisants.
Dubois, petit homme infatigable, fils d’un pauvre apothicaire, veut tout : à la fois toutes les responsabilités ministérielles et la pourpre. Le pape Clément XI s’est maintes fois dérobé. Il meurt. Innocent XII lui succède et cède. Voilà Dubois cardinal. Déjà ministre des Affaires étrangères, il sera Premier ministre en 1722, académicien français, président de l’assemblée du clergé.
« De par le Roi, défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu. »1103Épigramme (anonyme) à la porte du cimetière Saint-Médard, fin janvier 1732. Dictionnaire philosophique (1764), Voltaire
L’affaire des convulsionnaires du cimetière Saint-Médard, cas spectaculaire de transe collective, défraie la chronique durant cinq années, créant un trouble à l’ordre public du plus mauvais effet.
Finalement, le Parlement approuvera l’ordonnance royale qui a ordonné la fermeture du cimetière. Et le jansénisme est discrédité. Le vieux cardinal Fleury espère pouvoir gouverner en paix, et rétablir les finances de la France.
« Faites vous-même le pape ! » « Fa el Papa ! »1140
BENOÎT XIV (1675-1758), au duc de Choiseul, ambassadeur de France à Rome, 31 août 1756. Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (1827), Saint-Albin Berville, François Barrière
Le 245e pape perd patience, malgré son esprit conciliant et ses 80 ans. C’est que la France, fille aînée de l’Église, se conduit de manière bien déraisonnable, au siècle de la raison !
Le clergé ranime la querelle janséniste et l’affaire de la bulle Unigenitus. Les rares jansénistes encore vivants semblent trop heureux de faire figure de martyrs en se faisant refuser l’absolution. Cette agitation plaît au Parlement, mais inquiète Louis XV, par ailleurs très croyant.
On demande donc au pape une lettre encyclique, pour ramener la paix dans les esprits. Publiée le 16 octobre, Ex omnibus réaffirme la soumission nécessaire à Unigenitus … tout en prêchant la modération dans son application.
« Le pape est une idole à qui on lie les mains et dont on baise les pieds »1141
VOLTAIRE (1694-1778), Le Sottisier (posthume, 1880)
Il s’en amuse, et se réjouit pour une autre raison, dans une lettre à d’Alembert (13 novembre 1756) : « Pendant la guerre des Parlements et des évêques, les gens raisonnables ont beau jeu et vous aurez le loisir de farcir l’Encyclopédie de vérités qu’on n’eût pas osé dire, il y a vingt ans. »
Mais ces querelles franco-françaises, partisanes et mesquines, sont du plus mauvais effet : Église, Parlement, pouvoir royal se déconsidèrent aux yeux de l’opinion. Laquelle a d’autres soucis, avec la guerre.
« Les classes du Parlement n’y vont pas de main morte. Ce sont des fanatiques qui en égorgent d’autres, mais il faut les laisser faire ; tous ces imbéciles qui croient servir la religion servent la raison sans s’en douter. »1168
D’ALEMBERT (1717-1783), Lettre à Voltaire, 4 mai 1762. Œuvres de d’Alembert, tome V (posthume, 1822)
L’affaire des Jésuites fait grand bruit.
Le 6 août 1761, le Parlement a condamné au feu certains de leurs ouvrages ; le 1er avril 1762, leurs collèges sont fermés ; la Compagnie de Jésus supprimée en août (motifs : « perverse, pernicieuse, séditieuse, attentatoire »). En mars 1764, un dernier arrêt les condamne au bannissement perpétuel, ce que Louis XV souhaitait éviter. C’est la victoire des parlementaires jansénistes et gallicans contre les jésuites ultramontains et soldats du pape Clément XIII. Ni le pouvoir royal ni la religion ne sortent intacts de tels affrontements.
« Innocents de tout ce que les Parlements disent contre eux et coupables de tout ce qu’ils ne disent pas, les condamnent à être lapidés avec les pierres de Port-Royal. »1169
VOLTAIRE (1694-1778). La France sous Louis XV (1864), Alphonse Jobez
Évoquant les ruines de l’abbaye janséniste de Port-Royal détruite en 1711 sur ordre de Louis XIV, Voltaire fait le procès parodique des jésuites (en février 1763), alors qu’on essaie de liquider leurs biens et de régler le sort des collèges. Le pape Clément XIV supprimera la Compagnie de Jésus en 1773. La Nouvelle Compagnie sera rétablie par Pie VII en 1814.
« Notre saint père est un dindon
Le calotin est un fripon
Notre archevêque un scélérat
Alleluya. »1250Première chanson anticléricale attaquant le pape (sans titre, et sans auteur). Dictionnaire des chansons de la Révolution (1988), Ginette Marty, Georges Marty
Le clergé était une cible habituelle, mais à la veille de la Révolution, Pie VI en personne est mis en cause. Ce n’est que le début des ennuis pour le 248e pape qui verra passer non seulement la Révolution française, mais aussi la campagne d’Italie de Napoléon Bonaparte – un des plus longs pontificats (24 ans et six mois).
Son successeur Pie VII aura encore plus de problèmes avec la fille aînée de l’Église.
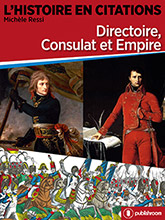 CONSULAT
CONSULAT
« Les conquérants habiles ne sont jamais brouillés avec les prêtres. »1719
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), Lettre à Lucien Bonaparte, ambassadeur à Madrid, 18 avril 1801. Courrier littéraire, XIXe siècle (1848), Émile Henriot
Dans cet esprit, le Premier Consul signe avec le pape Pie VII (représenté à Paris par le cardinal Consalvi, secrétaire d’État du Saint-Siège) le Concordat du 15 juillet 1801, adopté le 8 avril 1802 par les Assemblées. Ce compromis religieux règle les relations entre l’Église et l’État, jusqu’à la loi consacrant leur séparation, en 1905.
Une brouille viendra des « Articles organiques » élaborés par Portalis (juriste et directeur des Cultes), ajoutés unilatéralement au Concordat et rétablissant en fait l’emprise de l’État sur l’Église – indispensables pour faire passer le Concordat… C’est l’un des nombreux épisodes du gallicanisme en France, doctrine religieuse et politique mise en place sous l’Ancien Régime, qui cherche à organiser l’Église catholique de façon autonome par rapport au pape.
« Lorsqu’en 1801 Napoléon rétablit le culte en France, il a fait non seulement acte de justice, mais aussi de grande habileté […] Le Napoléon du Concordat, c’est le Napoléon vraiment grand, éclairé, guidé par son génie. »1721
TALLEYRAND (1754-1838), Mémoires (posthume, 1891)
Parole d’un grand diplomate et d’un politicien habile. Son nom est souvent associé à celui de Sieyès et de Fouché : c’est le « brelan de prêtres », selon l’ironique expression de Carnot.
Rendu boiteux par un accident qui lui interdit la carrière militaire, évêque d’Autun (en 1780) sans vocation religieuse, Talleyrand fut l’un des premiers prêtres à prêter serment à la Constitution civile du clergé en 1790 sous la Révolution.
Il approuve l’ensemble de la politique religieuse sous le Consulat, à commencer par le Concordat avec Pie VII. Bonaparte s’est ainsi rallié les sympathies des catholiques du monde entier, il a raffermi sur une base solide la puissance catholique ébranlée par la Révolution, et dont tout gouvernement sensé́ doit aider le développement en France à cette époque. Talleyrand sera d’ailleurs l’inspirateur des Articles organiques, pour faire passer le Concordat.
EMPIRE
« Commediante ! Tragediante ! »
« Comédien ! Tragédien ! »1781PIE VII (1742-1823). Servitude et grandeur militaires (1835), Alfred de Vigny
Ces deux mots n’ont peut-être pas été prononcés tels qu’ils sont passés à la postérité, mais ils reflètent ce que ce pape de caractère pensait de l’empereur.
Don de la simulation et sens théâtral sont deux qualités reconnues au grand premier rôle que fut Napoléon, sur la scène de l’histoire. Son don de la mise en scène, il en joue en artiste : « Rien n’interrompt aussi bien une scène tragique qu’inviter l’autre à s’asseoir ; lorsqu’il est assis, le tragique devient comique. » Il a d’ailleurs pris des cours avec le plus célèbre sociétaire de la Comédie-Française, son ami Talma. Il sait donner une dimension épique aux défaites comme aux victoires, revues et corrigées par les peintres voués à sa propagande.
Le sommet de l’art reste le sacre dont Pie VII est témoin et acteur, mais condamné au second rôle : Napoléon tint à se couronner lui-même … et le pape n’a béni que la couronne !
« Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République […] de respecter et de faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile […] de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »1797
NAPOLÉON Ier (1769-1821), cathédrale Notre-Dame de Paris, le jour de son sacre par Pie VII, 2 décembre 1804. Le Moniteur, phrase du journal officiel de l’époque, reprise dans toutes les bonnes biographies de l’empereur
La cérémonie dure cinq heures, entre la marche guerrière et le Te Deum, un premier serment religieux de Napoléon, la messe, l’Alléluia, les oraisons, les cris de « Vive l’empereur ». Et ce nouveau serment, sur les Évangiles. C’est l’instant le plus heureux des relations entre le pape et l’empereur. L’histoire a voulu que se croisent ces deux hommes qui ont la même volonté de fer.
Napoléon a déjà imposé sa volonté durant le sacre, il a pris la couronne présentée, l’a posée lui-même sur sa tête, avant de couronner son épouse Joséphine. C’est sans doute à cet instant qu’il s’est adressé à son frère aîné, pour la seule « improvisation » (authentique) de cette spectaculaire cérémonie : « Joseph, si notre père nous voyait ! »
« Votre Sainteté est souveraine de Rome, mais j’en suis l’Empereur. »1812
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre à Sa Sainteté le Pape, Paris, 13 février 1806. L’Église et la Révolution française : histoire des relations de l’Église et de l’État (1864), Edmond de Pressensé
En vertu du Concordat (1801), il précise à l’intention du pape : « Nos conditions doivent être que Votre Sainteté aura pour moi, dans le temporel, les mêmes égards que je lui porte pour le spirituel. » Mais les relations commencent à se gâter sérieusement entre ces deux fortes personnalités.
Pie VII voit d’un mauvais œil toute l’Italie passer sous la domination française, les territoires annexés au fur et à mesure des conquêtes impériales et au gré des circonstances… et les enclaves pontificales occupées par Joseph Bonaparte, nouveau roi de Naples.
« C’est la dernière fois que j’entre en discussion avec cette prêtraille romaine. »1829
NAPOLÉON Ier (1769-1821), Lettre à Eugène de Beauharnais, 22 juillet 1807. « L’Église romaine et les Négociations du Concordat (1800-1814) », Revue des deux mondes, tome LXXII (1867)
La « prêtraille », c’est le pape. Et l’empereur sous-estime l’adversaire.
Pie VII refuse d’annuler le mariage (américain) de Jérôme Bonaparte, le cadet de ses quatre frères, mineur à l’époque. Il refuse aussi de se joindre au blocus contre l’Angleterre, au nom de sa neutralité de pasteur universel.
Napoléon menace et charge Eugène, son beau-fils (qu’il a fait vice-roi d’Italie) de passer le message : « Si l’on veut continuer à troubler les affaires de mes États, je ne reconnaîtrai le pape que comme évêque de Rome […] Je ne craindrai pas de réunir les Églises gallicane (française), italienne, allemande, polonaise, dans un concile pour faire mes affaires sans pape. » Ce qui se fera, en 1811.
Après le Concordat, compromis religieux qui satisfait les deux partis et le sacre qui comble l’orgueil de l’empereur, les relations des deux hommes vont tourner au drame. Napoléon annexe les États de l’Église, le pape va l’excommunier…
« Romains, vous êtes appelés au triomphe sans avoir partagé le danger ! […] Romains, vous n’êtes pas conquis, mais réunis ! »1838
Les hérauts à la population, 10 juin 1809. La Revue des deux mondes (1960)
Le « département du Tibre, chef-lieu Rome », est rattaché à l’Empire français depuis un décret impérial du 15 mai, qui prend effet ce 10 juin : c’est l’annexion des États de l’Église. C’en est trop.
Pie VII signe dans la nuit l’excommunication de Napoléon : bulle Quum memoranda. Napoléon riposte par la force : il fait enlever le pape, le 6 juillet ! L’empereur devient, pour toute l’Europe, l’homme à abattre. D’où la cinquième coalition.
« Je sais qu’il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais le Pape n’est pas Dieu. »1852
NAPOLÉON Ier (1769-1821) au Comité ecclésiastique, Paris, 16 mars 1811. Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l’empereur Napoléon III (1858)
Pour l’heure, Pie VII est prisonnier à Savone depuis bientôt deux ans, et les affaires religieuses complètement désorganisées en France. D’où la décision de Napoléon : convoquer un concile pour mettre de l’ordre.
« Messieurs, vous voulez me traiter comme si j’étais Louis le Débonnaire. Ne confondez pas le fils avec le père […] Moi, je suis Charlemagne. »1856
NAPOLÉON Ier (1769-1821), aux Pères conciliaires, 17 juin 1811. Le Pape et l’empereur, 1804-1815 (1905), Henri Welschinger
Scène décrite dans les Mémoires de Talleyrand, avec force détails et dialogues. La colère de l’empereur explose. Le concile qu’il voulait à sa botte s’est ouvert à Paris ce 17 juin. Et voilà que les Pères jurent, un par un, obéissance au pape, lequel refuse aux évêques son investiture, pourtant prévue par le concordat signé avec Napoléon.
Il faut rappeler à quel point, en dix ans, les relations se sont envenimées entre les deux personnages ! Le pape a refusé de respecter le blocus, l’empereur a annexé les États de l’Église, le pape l’a excommunié, l’empereur l’a mis en prison. Et Pie VII refuse tout « accommodement » aussi longtemps qu’il ne recouvrera pas sa liberté. Napoléon fait arrêter trois évêques et suspend le concile – qui reprendra début août. Pie VII restera quatre ans prisonnier. C’est L’Otage de l’empereur, situation extraordinaire dont Claudel fera un drame en 1911.
Il survivra à Napoléon et lui pardonnera en termes très chrétiens.
MONARCHIE DE JUILLET
« Le cri du pauvre monte jusqu’à Dieu, mais il n’arrive pas à l’oreille de l’homme. »2048
Félicité Robert de LAMENNAIS (1782-1854), Paroles d’un croyant (1834)
Créateur du catholicisme social, soucieux d’appliquer un idéal de justice et de charité conforme à l’enseignement de l’Évangile, Lamennais profite de la nouvelle liberté de la presse en 1830 et lance le journal L’Avenir avec ses amis Lacordaire et Montalembert. En exergue : « Dieu et la liberté ».
Il est condamné par l’Encyclique Mirari vos (1832). Pour le pape Léon XII, souverainetés du peuple et de Dieu sont incompatibles.
Après une grave crise de conscience, il rompt avec l’Église pour n’être plus que socialiste, à l’inverse de ses deux amis qui se soumettent, sans abandonner leur action généreuse. Lamennais publie ses Paroles d’un croyant sous forme de versets, comme la Bible, et y affirme son socialisme : Dieu veut l’égalité, la liberté et la fraternité des hommes. « La liberté est le pain que les peuples doivent gagner à la sueur de leur front », écrit-il encore pour encourager le peuple au combat contre tous ceux qui l’oppriment.
« C’est la Marseillaise du christianisme et l’auteur est un prêtre en bonnet rouge », dit-on alors. C’est surtout un courant d’opinion très représentatif de cette fermentation des idées, face à la misère du peuple qui s’aggrave et contraste avec l’enrichissement de la bourgeoisie.
« La liberté est le pain que les peuples doivent gagner à la sueur de leur front. »2083
Félicité Robert de LAMENNAIS (1782-1854), Paroles d’un croyant (1834)
Prêtre devenu libéral, fondateur dès octobre 1830 du journal L’Avenir avec pour épigraphe « Dieu et la liberté », créateur – sans autorisation – d’une école libre, Lamennais est condamné en 1832 par Grégoire XVI (dernier prêtre élu pape avant d’être ordonné évêque) : la souveraineté du peuple est incompatible avec celle de Dieu.
Après une grave crise de conscience et un long silence, Lamennais écrit ce livre rédigé sous forme de versets comme la Bible et prêche le socialisme chrétien : Dieu veut l’égalité, la liberté et la fraternité des hommes. On parlera plus tard de catholicisme social, et de gauche chrétienne.
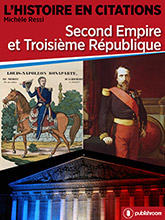 TROISIEME REPUBLIQUE
TROISIEME REPUBLIQUE
« La France est-elle réduite à n’être que le dernier boulevard de la politique des jésuites ? »2416
Léon GAMBETTA (1838-1882), Chambre des députés, été 1871. La Troisième République (1968), Maurice Baumont
Réélu député le 2 juillet 1871 après des élections complémentaires, plus que jamais ardent républicain, il apostrophe les monarchistes qui gardent la majorité à l’Assemblée, et veulent aller rétablir le pouvoir temporel du pape à Rome.
Gambetta va siéger à l’extrême gauche, à la tête de l’Union républicaine, animer la Chambre par ses talents d’orateur et scandaliser les conservateurs, tout en soutenant la politique de Thiers.
« Le duc de Broglie caresse la France, mais c’est à rebrousse-poil ! »2430
Edmond ABOUT (1828-1885). Cent ans de République (1970), Jacques Chastenet
Écrivain et journaliste politique, cet anticlérical déplore les mesures prises par le ministère. L’« ordre moral », c’est le renforcement de la puissance du pape, de l’Église catholique et de son ascendant sur les masses pratiquantes.
« Sauvez Rome et la France
Au nom du Sacré-Cœur ! »2431Chant de ralliement des pèlerins monarchistes à Notre-Dame de Chartres et à Paray-le-Monial, les 27 et 28 mai 1873. Annales de l’École libre des sciences politiques, volume VI (1891), École libre des sciences politiques
Une cinquantaine de députés, cierge à la main, marchent en tête des 20 000 pèlerins : « Ce fut le cri de ralliement, le chant de guerre de l’ultramontanisme, une sorte de Marseillaise catholique. Nous touchons ici au point culminant du mouvement d’enthousiasme que nous avons vu se dessiner dans l’Église de France en faveur du pape et des idées romaines. »
Pèlerinages, processions, manifestations cléricales vont moins soutenir que compromettre le ministère. Le duc de Broglie lui-même parle de « bizarreries cléricales », de « regrettables ostentations ». Renan, Taine, Flaubert l’accusent d’« obscurantisme », et Gambetta aura beau jeu de crier bientôt : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! »
« Je sens une odeur de sacristie qui monte. »2433
George SAND (1804-1876), Lettre à Flaubert (1873). Cent Ans de République (1970), Jacques Chastenet
Le régime d’attente et de conservatisme fait l’objet de très vives attaques. Les républicains, en province, agitent devant les paysans l’épouvantail d’une restauration qui, en même temps qu’un roi, risque de ramener la dîme et les privilèges nobiliaires ! Les bonapartistes, souvent anticléricaux eux aussi, mènent à nouveau campagne et vont connaître un regain de popularité aux élections partielles.
« Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi. »2450
Léon GAMBETTA (1838-1882), Discours sur les menées ultramontaines, Chambre des députés, 4 mai 1877. Le Cléricalisme, voilà l’ennemi ! (1879), Paroles de M. Gambetta, commentées par Émile Verney
La question religieuse prend des proportions démesurées, sous la Troisième République. Pour l’heure, les catholiques français veulent aider le pape contre le gouvernement italien, et les républicains refusent absolument cette intervention : « Nous en sommes arrivés à nous demander si l’État n’est pas maintenant dans l’Église, à l’encontre de la vérité des principes qui veut que l’Église soit dans l’État », proteste Gambetta. En tout cas, il redonne à l’union des gauches son principe d’anticléricalisme. Sa formule fait mouche, elle va beaucoup resservir !
Mac-Mahon, après le renvoi de Jules Simon, rappelle un monarchiste, le duc de Broglie comme chef de gouvernement, le 16 mai. L’ordre moral revient à l’ordre du jour, face à une Assemblée qui ne peut l’accepter.
« Vous êtes le gouvernement des prêtres et le ministre des curés. »2451
Léon GAMBETTA (1838-1882), au ministre de l’Intérieur Fourtou, mi-juin 1877. Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (1884)
Oscar Bardy de Fourtou, adepte de la manière forte, de nouveau en poste à l’Intérieur, a pour mission d’empêcher le retour en force des républicains à l’Assemblée. La coalition monarchiste et conservatrice caresse à nouveau la France à rebrousse-poil.
Le 18 juin, les 363 députés républicains font adopter un ordre du jour – l’Ordre des 363 – qui refuse la confiance au cabinet de Broglie. Une semaine plus tard, avec l’accord du Sénat, Mac-Mahon dissout la Chambre des députés, le 25 juin. C’est la crise la plus grave depuis la Commune : le sort du régime républicain est en jeu. Tout va dépendre des prochaines élections, fixées au 14 octobre.
« L’ordre moral atteint au délire de la stupidité. »2452
Gustave FLAUBERT (1821-1880), Correspondance, volume IV (1893)
Dans la campagne électorale qui bat son plein, cet été 1877, Mac-Mahon prend parti, tel un maréchal à la tête de ses troupes, et lance dans la bataille les fonctionnaires et le clergé.
De leur côté, les républicains font bloc, avec deux têtes d’affiche : le toujours jeune Gambetta (40 ans) et le déjà vieux Thiers qui, malgré ses 80 ans, se verrait bien succéder à son successeur Mac-Mahon.
« Allons Combes, chasseur de nonnes,
À ton cor, mets vite un bouchon […]
Tu mets sous scellés les nonettes,
T’y mettras pas la religion. »2541Antonin LOUIS (1845-1915), Le Chasseur de nonnes, chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
On cible le « petit père Combes » : ancien séminariste devenu franc-maçon, militant provincial, esprit petit-bourgeois radical et borné, conservateur et anticlérical, il est président du Conseil de juin 1902 à janvier 1905. Il va lasser sa propre majorité, irriter le pape et, plus grave, révolter une partie du pays, en faisant fermer des milliers d’« écoles libres » et en dispersant quelque 18 000 religieux de congrégations.
La chanson reflète l’hostilité de l’opinion publique qui veut simplement « la liberté pour tout le monde ». L’imbroglio de la question religieuse, qui dure depuis 1880, aboutira enfin le 9 décembre 1905 (sous le nouveau ministère de Rouvier) à la loi sur la séparation des Églises et de l’État, rapportée par Aristide Briand.
ENTRE DEUX GUERRES
« La fonction royale est plus un devoir qu’elle n’est un don. Un devoir constant, toujours pénible, quelquefois terrible. »2672
Léon DAUDET (1867-1942), au lendemain de la mort accidentelle de la reine Astrid de Belgique (29 août), L’Action française, 1er septembre 1935. Encyclopédie des citations (1959), P. Dupré
Le quotidien d’extrême droite fondé en 1908 et animé par Jacques Bainville, Léon Daudet et Charles Maurras, défend toujours le « nationalisme intégral » et la monarchie « héréditaire, antiparlementaire et décentralisée ». Son audience est réduite après sa mise à l’Index par le pape Pie XI - premier chef d’État en titre du Vatican, ville-État située au cœur de Rome, siège de l’Église catholique romaine et résidence du pape.
Mais la droite ou plutôt les droites françaises multiplient les « ligues » et ne manquent pas une occasion de faire entendre leur voix. Ainsi, quand la France à la Société des nations vote les sanctions contre l’Italie qui a envahi l’Éthiopie le 18 octobre 1935, Marcel Aymé, Pierre Gaxotte, Thierry Maulnier, de nombreux académiciens et autres intellectuels s’insurgent contre « des sanctions qui, pour mettre obstacle à la conquête civilisatrice d’un des pays les plus arriérés du monde […] n’hésiteraient pas à déchaîner une guerre universelle ». Le ton monte.
« Spirituellement, nous sommes des Sémites. »2689
PIE XI (1857-1939), 6 septembre 1938. Dialoguer pour ne pas mourir (1998), Jean-Marie Roger Tillard
« L’antisémitisme est inadmissible. » Mot fameux du 259e pape de l’histoire – rappelons qu’il a mis le journal (notoirement antisémite) de l’Action Française à l’Index (dès 1926).
Plus généralement, Pie XI (né dans l’empire d’Autriche) condamne tous les excès de cet entre-deux-guerres : ceux du fascisme (dès 1931) et du bolchevisme comme du nazisme (en 1937).
L’encyclique Mit brennender Sorge (« Avec une vive inquiétude ») s’adresse directement aux Allemands et en allemand, pour attaquer le racisme, le mythe du sang et celui de la terre. En 2007, les archives vaticanes dévoilent le discours contre le fascisme et le nazisme que Pie XI aurait dû prononcer en présence de Mussolini.
Son principal collaborateur et successeur Pie XII (1939-1958) condamnera lui aussi le fascisme et le nazisme, mais il suscite beaucoup plus de polémiques. Attaché depuis 1917 au principe de la neutralité politique du Vatican en tant que chef de l’Église universelle, le padre comune de tous les fidèles catholiques a les mains liées, au moins publiquement. La question de l’antisémitisme des catholiques, récurrente, s’est posée de manière dramatique, en diverses époques. Une longue et dramatique histoire dans l’Histoire
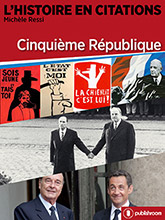 CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
« France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? »1
JEAN-PAUL II (1920-2005). 1980, une date mémorable, les paroles du pape Jean-Paul II
264e pape, premier pape non italien depuis Adrien VI au XVIe siècle, premier et unique pape polonais (né Karol Józef Wojtyła), c’est l’un des pontificats les plus longs après saint Pierre et Pie IX : 26 ans et 5 mois. À sa mort, il fut très vite béatifié par son successeur Benoît XVI le 1er mai 2011, et canonisé le 27 avril 2014 par François.
Jean-Paul II est considéré comme l’un des meneurs politiques les plus influents du XXe siècle, présenté en même temps comme le modèle de la nouvelle évangélisation portée par l’ensemble de sa vision pastorale et incarnée jusque dans sa sainteté de vie.
Quant à la a célèbre formule aujourd’hui quelque peu anachronique, elle fut « lancée » par un pape à la fin du XIXe siècle : « Embrassant de bonne heure le christianisme à la suite de son roi Clovis, elle [la France] eut l’honneur d’être appelée ‘la fille aînée de l’Église’, témoignage et récompense tout ensemble de sa foi et de sa piété. » Léon XIII, Nobilissima Gallorum Gens, Lettre encyclique du 8 février 1884.
L’expression « France, fille aînée de l’Église » est attestée pour la première fois lors du « Discours sur la vocation de la nation française » du père dominicain Henri-Dominique Lacordaire (ex compagnon de route de Lamennais et Montalembert), prononcé le 14 février 1841 en la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette formule qui semble ignorer la Révolution française de 1789 survit ensuite à la séparation des Églises et de l’État instituant la laïcité (1905).
Paradoxe institutionnel, c’est surtout le témoignage historique de ce passé chrétien qui imprègne notre culture, marque encore les esprits et dicte le calendrier de nos fêtes, Pâques, Noël, Pentecôte, Ascension, Toussaint…
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.