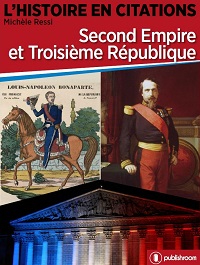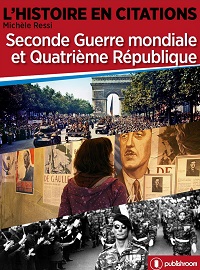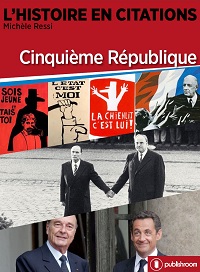« Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. » (proverbe romain)
Et pourtant, l’on ne cesse d’en débattre depuis toujours !
En deux semaines, vous allez en voir vraiment de toutes les couleurs, au fil des références factuelles, historiques et artistiques de la Gaule à nos jours !
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
« Paris ouvrait à une page blanche le livre de l’histoire et y inscrivait son nom puissant ! » 2364
Comité central de la garde nationale, Proclamation du 28 mars 1871. Histoire du socialisme (1879), Benoît Malon
Les révolutionnaires ont parfois des bonheurs d’expression qui valent citations, quand la forme et le fond sont unis pour faire sens !
En présence de 200 000 Parisiens, le comité central de la garde nationale s’efface devant la Commune, le jour de sa proclamation officielle. Le lyrisme s’affiche : « Aujourd’hui il nous a été donné d’assister au spectacle populaire le plus grandiose qui ait jamais frappé nos yeux, qui ait jamais ému notre âme. » Le mouvement s’étend à quelques villes : Lyon, Marseille, Narbonne, Toulouse, Saint-Étienne. Sa répression finira dans le sang sur les pavés rougis.
« L’insurgé, son vrai nom c’est l’homme !
Qui n’est plus la bête de somme,
Qui n’obéit qu’à la raison
Et qui marche avec confiance
Car le soleil de la science
Se lève rouge à l’horizon. » 2407Eugène POTTIER (1816-1888), paroles, et Pierre DEGEYTER (1848-1932), musique, L’Insurgé (1884), chanson
Le soleil rouge de la science rime avec confiance dans le progrès (technique, social), mais il renvoie aussi à la Révolution et au sang des barricades. En deux mois, la Commune est un raccourci saisissant de l’Histoire.
Poète et révolutionnaire, chansonnier socialiste le plus important (et sincère) du XIXe siècle, Pottier a déjà écrit l’Internationale. Membre de la Commune, réfugié aux États-Unis après la Semaine sanglante, il rentre de son exil suite à la loi d’amnistie (1880) et dédie ce chant « à Blanqui et aux Communards » : « Devant toi, misère sauvage, / Devant toi, pesant esclavage, / L’insurgé se dresse / Le fusil chargé. / On peut le voir en barricades / Descendr’ avec les camarades, / Riant, blaguant, risquant sa peau… »
Beaucoup de chansons communistes voient le jour dans les années 1880 : lutte des classes, guerre sociale contre les patrons, appel à la révolte armée des ouvriers, mineurs, paysans.
En mars 1880, les libertaires de Rimini célèbrent l’anniversaire de la Commune de Paris en hissant sur l’Arc de triomphe de la ville ce que le militant anarchiste et socialiste italien Andrea Costa appelle « le drapeau rouge et noir de l’Internationale » . La symbolique du rouge de l’Action socialiste se marie à celle du Noir de l’Anarchie associée à la rébellion et la mort. Donc, rien à voir avec le Rouge et noir de Stendhal (armée et clergé) !
L’agitation sociale connaîtra en France une nouvelle flambée avant la Première Guerre mondiale. Ni l’État, ni les patrons, ni les syndicats français de cette époque ne sont aptes à résoudre les conflits sociaux nés du développement économique et du capitalisme.
« J’ai reçu le drapeau blanc comme un dépôt sacré, du vieux roi mon aïeul. Il a flotté sur mon berceau, je veux qu’il ombrage ma tombe ! » 2417
Comte de CHAMBORD (1820-1883), Manifeste du 5 juillet 1871, à Chambord. La Droite en France, de la première Restauration à la Ve République (1963), René Rémond
Encore un drapeau. Mais le blanc vient de loin – de l’Ancien Régime ! Henri de Bourbon, comte de Chambord, se fait appeler Henri V et se voit déjà roi de France. On frappe des monnaies à son effigie, on construit des carrosses pour son entrée à Paris… Les deux partis, légitimistes et bonapartistes, se sont en effet mis d’accord sur son nom et sa plus grande légitimité.
Dans ce discours, il renie le drapeau tricolore. Scandalisés, certains de ses partisans en deviennent républicains ! L’« Affaire du drapeau » sert la stratégie politicienne de Thiers qui pavoise devant tant de maladresse. Il dit même que le prétendant mérite d’être « appelé le Washington français, car il a fondé la République ! »
Cette attitude s’explique : le comte de Chambord a vécu quarante ans en exil, dont trente dans un château coupé du monde, entouré d’une petite cour d’émigrés aristocrates, assurément plus royalistes que le roi, comme tant de courtisans. Charles X était dans le même cas, sous la Restauration, son règne a vite tourné court (avec la révolution des Trois Glorieuses) et cela date d’un demi-siècle.
« Les couleurs politiques sont comme les couleurs du peintre, elles n’ont qu’une surface mince et cachent toutes la même toile. » ,
Alphonse KARR (1808-1890), Les Guêpes (1874)
Romancier, journaliste, directeur du Figaro (né hebdomadaire parisien et satirique), il crée en 1839 la revue satirique mensuelle Les Guêpes dont les pamphlets visent le monde des arts, des lettres et de la politique.
Inutile de préciser que les couleurs du peintre lui tiennent très à cœur, et qu’on peut se battre, voire mourir pour le symbole des couleurs politiques.
« Je désire reposer […] en face de cette ligne bleue des Vosges d’où monte jusqu’à mon cœur fidèle la plainte des vaincus. » 2508
Jules FERRY (1832-1893), Testament. Jules Ferry (1903), Alfred Rambaud
Mort le 17 mars 1893, il reste dans l’histoire pour sa politique scolaire, mais aussi coloniale. Ses derniers mots prouvent qu’il n’oubliait pas l’Alsace et la Lorraine perdues, alors même qu’il lançait la France à la conquête de la Tunisie et du Tonkin (Indochine, nord du Vietnam). Mal compris, Ferry a pu voir relancée, à la fin de sa vie, une nouvelle colonisation prise en main par des politiques, des militaires, des hommes d’affaires : Indochine, Madagascar, Afrique noire, Maroc.
Mais la « ligne bleue des Vosges » reste dans la mémoire collective.
« Vos mains sont couvertes de sang.
— Comme l’est votre robe rouge ! » 2511Émile HENRY (1872-1894), répondant au président du tribunal, 27 avril 1894. Historia (octobre 1968), « L’Ère anarchiste » , Maurice Duplay
Fils de bourgeois, il épouse la cause anarchiste par idéal révolutionnaire et veut frapper partout, parce que la bourgeoisie est partout. Il a 19 ans quand sa bombe portée pour examen au commissariat de police des Bons-Enfants explose : 5 morts, le 8 novembre 1892. Nouvelle bombe au café Terminus de la gare Saint-Lazare : un mort, 20 blessés, le 12 février 1894.
À son procès, il proclame que l’anarchie « est née au sein d’une société pourrie qui se disloque. Elle est partout, c’est ce qui la rend indomptable, et elle finira par vous vaincre et vous tuer. » Émile Henry sera guillotiné le 21 mai 1894, criant « Courage, camarades ! Vive l’anarchie ! » Rappelons que l’anarchie est passée du drapeau rouge au drapeau noir en 1882, les deux couleurs s’associant au nom de l’Internationale (communiste).
« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes. »Arthur RIMBAUD (1854-1891), Poésies (1881 ou 1872), Voyelles
Poème maintes fois commenté, à la symbolique obstinément obscure ! Le plus simple est de se laisser emporter par le rythme rimbaldien – en oubliant l’interversion de deux voyelles… et l’oubli de la sixième, Y.
« A, noir corset velu des mouches éclatantes / Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, Golfes d’ombre ;
E, candeurs des vapeurs et des tentes, / Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles / Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrements divins des mers virides, : / Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides / Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, / Silences traversés des Mondes et des Anges : — O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! »
« Ne jamais ternir la couleur, c’est une fleur. Si l’on y passe et repasse le doigt, il n’y a plus de velouté, plus de charme, plus de coquetterie. Et puis, ces tons ternes et plombés, il faut les bannir à tout jamais. »
Eugène BOUDIN (1824-1898), Eugène Boudin. Au fil de ses voyages (2013), Musée Jacquemart-André
Cette phrase délicate annonce l’impressionnisme, cette fête des couleurs dont Boudin fut le précurseur.
L’impressionnisme est un mouvement pictural né de l’association d’artistes vivant en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement critiqué et moqué à ses débuts, il se manifeste de 1874 à 1886 par des expositions publiques à Paris et marque la rupture de l’art moderne avec la peinture académique, jusqu’alors très en vogue à l’époque. Sur le marché de l’art, sa cote atteint aujourd’hui des sommets vertigineux.
Dans des tableaux de petit format, il privilégie la couleur par rapport au dessin, avec des traits de pinceau visibles, l’utilisation d’angles de vue inhabituels, une tendance à noter les « impressions » fugitives portées directement sur la toile, la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux, plutôt que l’aspect stable et conceptuel des choses.
« Un matin, l’un de de nous manquant de noir, se servit de bleu : l’impressionnisme était né. » .
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919), propos rapportés par G. Coquiot
Voilà qui est simple. Et génial, si le talent suit !
Le nom aujourd’hui célèbre de cette nouvelle école picturale vient d’une toile signée Claude Monet, Impression, soleil levant (1872). Un critique malveillant reprit le titre pour se moquer de cette peinture qui bouscule les codes et l’art de peindre classique… En attendant la révolution cubiste de Picasso et l’art moderne qui va tout bousculer !
« Le noir, une non-couleur ? Où avez-vous encore pris cela ? Le noir, mais c’est la reine des couleurs ! »
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919), Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir… (1938)
Paradoxe apparent, aux yeux des profanes ! Mais Soulages le prouvera à sa manière. De même que la mode du noir qui habille si bien tant de femmes. Le peintre ajoute : « Vous vous échauffez à chercher, vous mettez une petite pointe de noir d’ivoire ; ah que c’est beau ! » (le noir d’ivoire étant une poudre faite d’ivoire calciné et pulvérisé)
Membre à part entière du groupe impressionniste, dans une misère noire, il peint Le Déjeuner des canotiers à Chatou, en 1880. Dernière grande œuvre du peintre dans ce style : l’ombre et la lumière se mêlent dans les tons de bleu, les traits sont puissants et purs à la fois. Le souci du détail apporté aux costumes bourgeois (à la mode parisienne) ou populaires nous rappelle le métier de ses parents – père tailleur et mère couturière.
Après son voyage en Italie de 1881, le bohême évolue vers un style plus réaliste et classique, sous l’influence de Raphaël (peintre de la Renaissance italienne qu’il découvre). Il part aussi en Algérie, pour changer d’air et de palette, comme Delacroix renouvelant son inspiration après son voyage au Maroc. Renoir veut réapprendre à dessiner, entrant dans sa période « ingresque » (ou « sèche » ) qui culmine avec ses Grandes Baigneuses en 1887. Très classiques et très nues – un thème éternellement repris. Mais la critique n’apprécie guère : « Allons, bon ! Encore un qui est pris par le bromure de Raphaël ! » Joris-Karl Huysmans. L’avant-garde lui reproche de s’égarer, son marchand d’art (Durand-Ruel) l’encourage à changer de manière. Sur le conseil de sa future femme, il part redécouvrir son village natal, Essoyes (dans l’Aube). « Je suis en train de paysanner en Champagne pour fuir les modèles coûteux de Paris. Je fais des blanchisseuses ou plutôt des laveuses au bord de la rivière. » Lettre à son amie Berthe Morisot.
Renoir enchaîne avec sa troisième période, celle de la consécration et de la maturité, qui concilie idéalement et tout naturellement la couleur et le dessin. Ses Jeunes filles au piano (1892) illustrent sa « période nacrée » . Moins de couleurs et de dessin, plus de charme, de douceur et de fluidité dans cette « scène de genre » familiale. Il exprime sa passion pour la jeunesse faite femme. Il en fait plusieurs versions, l’État lui achète une toile. Le peintre est enfin reconnu, à 50 ans, bientôt célèbre. Il travaille avec les deux grands marchands d’art, Ambroise Vollard et Durand-Ruel. Mais il reste avant tout le peintre du bonheur simple – qualité assez rare.
Peintre de portraits et de nus féminins, de paysages et de marines, de natures mortes et de scènes champêtres, Renoir est aussi pastelliste, graveur, lithographe, sculpteur et dessinateur. En soixante ans, il a réalisé quelque quatre mille tableaux : « Mettez-vous cela dans la tête : il n’existe qu’un seul indicateur de la valeur d’un tableau : c’est la salle des ventes. » Il a vécu des années dans la misère, il n’a cessé de travailler et de progresser. On lui a injustement reproché cette phrase, comme si la popularité d’un artiste était antinomique avec son génie. L’histoire prouve heureusement le contraire.
Homme de famille, c’est le père du réalisateur Jean Renoir et du comédien Pierre Renoir.
« Je voudrais bien qu’avec la couleur, on eût aussi peu à se gêner qu’avec la plume et le papier. »
Vincent VAN GOGH (1853-1890), Lettres à son frère Théo
La première lettre de Vincent à son frère Théo, datée d’août 1872, est envoyée de La Haye. Il a dix-neuf ans. Il ne sait pas qu’il va peindre. La dernière lettre, inachevée, Théo la trouve dans la poche de Vincent qui s’est tiré une balle dans la poitrine à 37 ans, le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise. Des dizaines de toiles encombrent sa chambre. Il n’aura vendu qu’un tableau – c’est aujourd’hui l’un des artistes les plus cotés et les plus admirés, au génie universellement reconnu.
Presque quotidiennement, Vincent écrit à Théo à propos de tout. Il lui envoie toutes ses toiles – Théo est marchand d’art. Il lui montre ce qu’il peint comme ce qu’il est. Sans aucune gêne avec la plume, le papier ou le pinceau !
Ces lettres – récits, aveux, appels, professions de foi au double sens du mot – donnent à voir le vrai Van Gogh… Il n’est pas fou. Mais solitaire, déchiré, malade, affamé, il ne cesse d’écrire. Extralucide, il traque la lumière. Et il est vraiment fou de couleurs. Né aux Pays-Bas, il les a découvertes à Arles et Saint-Rémy de Provence – Monet et Renoir, Cézanne et Pissarro, la plupart des impressionnistes s’inspirèrent des tons délicats de Normandie. Hors Cézanne, Gauguin et Van Gogh.
« Je ressens tout à fait l’importance qu’il y a de rester dans le midi, et de sentir qu’il faut encore outrer la couleur davantage. » Elles ne sont jamais trop vives à ses yeux : « Toutes les couleurs que l’impressionnisme a mises à la mode sont changeantes, raison de plus pour les employer hardiment trop crues, le temps ne les adoucira que trop. »
Sa couleur préférée, le jaune : « Un soleil, une lumière que faute de mieux je ne peux appeler que jaune, jaune soufre pâle, citron pâle, or. C’est beau le jaune ! » C’est la « clarté suprême de l’amour » et le jaune des chapeaux de paille, des champs de blé ou des Tournesols (peints en deux séries, parisienne et arlésienne). Avec le jaune du soleil omniprésent, intense, excessif, incandescent, extatique. Un jaune « qui hurle » . Associé à son complémentaire le bleu (image de l’infini), il peut rendre fou, mais il représente aussi l’accord parfait du bonheur et de la vie (comme dans La Sieste). Sans oublier son frère : « Le cobalt est une couleur divine et il n’y a rien d’aussi beau pour mettre de l’air autour des objets. » L’orgie de couleurs continue. « Le carmin est le rouge du vin et il est chaud et spirituel comme le vin. Le vert émeraude aussi. Ce n’est pas une économie de se passer de ces couleurs. » Il ne cesse de les interroger dans ses Lettres : « Les meilleures peintures et justement les plus parfaites du point de vue technique, en les regardant de près, sont faites de couleurs l’une à côté de l’autre et produisent leur effet à une certaine distance. Rembrandt n’en a pas démordu, malgré toutes les souffrances que cela lui a valu (Ces bons bourgeois trouvaient Van der Hels bien meilleur, parce qu’on pouvait aussi le voir de près.) »
Très jeune déjà, il aimait et il savait écrire. Il n’a pas cessé. Mais tous les impressionnistes ont trouvé les mots pour parler des couleurs.
« Nécessité d’introduire, dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air. »
Paul CEZANNE (1839-1906), Lettre à Émile Bernard du 15 avril 1904
Né et mort à Aix-en-Provence, impressionniste considéré ensuite comme post-impressionniste, c’est aussi le précurseur du cubisme et le « père de l’art moderne » .
« Trouver les volumes » , « faire du Poussin sur nature » , « quelque chose de solide comme l’art des musées » , voilà quelques-unes des raisons de peindre, pour Cézanne. Continuateur de l’esprit classique français, il va devenir un innovateur radical par l’utilisation de la géométrie dans les portraits, les natures mortes et tous les paysages d’Île-de-France et de Provence – la campagne d’Aix-en-Provence.
Il peint quelque 80 fois La Montagne Sainte-Victoire, à l’huile ou à l’aquarelle. Il aime aller « sur le motif » dans sa campagne d’enfance, s’engageant toujours plus loin dans cette voie qui s’achève en 1906, ne cessant de se recommander de la nature : « L’étude réelle et précieuse à entreprendre, c’est la diversité du tableau de la nature. » Il ajoute : « Peindre d’après nature pour copier la nature , ce n’est pas l’objectif, c’est réaliser des sensations. » C’est une autre définition de l’ « impressionnisme » .
« J’en reviens toujours à ceci : le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature, et tâcher de produire des tableaux qui soient un enseignement. » Mais il avait conscience du défi qu’il s’imposait à lui-même et le doute l’étreignait souvent : « On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins maître de son modèle et surtout de ses moyens d’expression. » Tous les peintres se sont interrogés sur leur art – même Ingres qui semblait si sûr de lui et du classicisme. Mais la révolution picturale entre fin du XIXe et début du XXe siècles est plus propice encore aux doutes, avec l’explosion vertigineuse du marché.
« Degas disait que s’il s’était allé à son goût propre, il ne serait pas sorti du noir et blanc : ‘mais quand on a tout le monde sur le dos pour vous demander de la couleur !…’ »
Ambroise VOLLARD (1866-1939) , En écoutant Cézanne, Degas, Renoir… (1938)
Né à Saint-Denis de la Réunion, Vollard vient à Paris pour faire son droit, mais il se passionne pour la peinture à Montmartre et ouvre sa première galerie à Paris, rue Laffitte, en 1893. Il expose Gauguin et Matisse, il se lie avec Cézanne et Renoir qui peignent son portrait. En 1901, il est le premier à exposer un jeune peintre espagnol récemment installé à Paris (et qui peindra également son portrait). C’est Pablo Picasso. Il compte parmi ses clients de grands collectionneurs, Gertrude Stein et son frère Leo, l’Américain Barnes.
Profitant du nouveau marché de l’art, il fait la carrière de peintres impressionnistes qui feront sa fortune. On peut dire la même chose de Paul Durand-Ruel.
Quant à Degas (1834-1917), classé parmi les impressionnistes, il fait bande à part. Fils de famille fortunée, il pourrait vivre sans se soucier de vendre, mais… il finit par répondre au marché. Admirateur inconditionnel d’Ingres, il affirme la domination du dessin sur la couleur, mais… il est lié du début à la fin au mouvement impressionniste. Il se refuse à peindre en plein air, mais… il écrit dans une lettre à l’un de ses rares amis peintres, Évariste de Valernes : « Ah ! si j’avais eu plus de temps pour peindre sur nature ! » Sa nièce évoque sa mémoire visuelle prodigieuse, lui permettant de peindre en atelier des paysages qu’il avait eus sous les yeux, quelques jours auparavant. Mais… les paysages ne l’intéressent pas : « Je ne veux pas perdre la tête face à la nature. »
Il se passionne pour les courses de chevaux. À Longchamp qui vient d’ouvrir, il étudie attentivement l’animation des champs de course – l’univers des jockeys, les préparatifs et le départ des courses. Autre thème favori, le théâtre, la musique et la danse : il invente des compositions étonnantes et très étudiées, ne se fiant jamais à l’« impression » chère à ses confrères : « Aucun art n’est aussi peu spontané que le mien. Ce que je fais est le résultat de la réflexion et de l’étude des grands maîtres ; de l’inspiration, la spontanéité, le tempérament, je ne sais rien… » Outre la magie du ballet et du mouvement qu’il rend parfaitement, il s’attache à l’envers du décor, aux artistes dans le coulisses, aux exercices et aux répétitions, donnant à voir le décalage entre la féerie des costumes et des spectacles et la situation sociale misérable des danseurs et surtout des danseuses.
Épris de modernité, il peint la vie urbaine, mais là encore, il n’est pas question de bonheur ni de progrès. C’est la dureté du quotidien, la condition sociale des petites gens qui le touchent. Degas est pessimiste, amer. Il se passionne deux ans pour la photographie (entre 1896 et 1896), il se met à la sculpture et au pastel – à cause d’une maladie des yeux qui lui interdit la peinture à l’huile trop minutieuse. Il cessera de peindre en 1911, devenu aveugle. Il laisse quelque 2 000 tableaux profondément originaux et personnels, non conformes à l’idée qu’on se fait de l’Impressionnisme. Et la Petite danseuse de 14 ans, sculpture habillée à plusieurs versions, qui fit plusieurs fois scandale par son réalisme et son expressionnisme à la limite de la laideur – d’une beauté aussi bouleversante que provocante.
« Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge. » 1005
Alphonse ALLAIS (1854-1905), Salon des Arts incohérents (1884)
Étudiant paresseux, pharmacien fantaisiste, photographe raté, il devient bon journaliste au Chat noir et son humour tout terrain fait mouche. Il sera célèbre sous la Belle Époque. Dans cet édito, il remporte la palme sans nul doute – alors qu’il est bien difficile de dire quel artiste a le plus de génie !
Ce monochrome (peinture à une couleur) entièrement rouge succède au tableau entièrement noir de son ami Paul Bilhaud : Combat de nègres dans un tunnel, présenté en 1882 à la première exposition des Arts incohérents. En 1883, Allais exposa un bristol sans tache ni trait, autrement dit blanc de blanc : Première communion de jeunes filles chlorotiques par temps de neige.
Rappelons que ces mêmes années, la nouvelle vague impressionniste déploie ses talents multicolores au Salon (des Indépendants ?) et commence enfin à trouver son public. Cela dit, les blagues monochromes remontent au XVIIe siècle classique et se multiplient au XIXe dans la vaste catégorie : caricature de l’art non figuratif.
Dans le même esprit, Allais publie sa Marche funèbre composée pour les funérailles d’un grand homme sourd (1897), un « Lento rigolando » de vingt-quatre mesures remplissant deux pages sans une seule note, où les musiciens devront uniquement s’occuper à compter des mesures, parce que « les grandes douleurs sont muettes » . Ces œuvres et quelques autres du même esprit sont publiées dans l’Album Primo-Avrilesque de 1897.
Questions (im)pertinentes à d’autres créateurs sérieusement minimalistes du XXe siècle : John Cage eut-il écho de la Marche funèbre d’Allais, quand il composa en 1952 sa très semblable pièce muette 4’33’’ en 1952 ? Même question à Kasimir Malevitch, peintre du Carré blanc sur fond blanc (1918) ou à Yves Klein célèbre (et quelque peu scandaleux) pour ses Monochromes bleus dans les années 1950 ?
« Quand je peins en vert, ça ne veut pas dire de l’herbe; quand je peins en bleu, ça ne veut pas dire le ciel. »
Henri MATISSE (1869-1954), Peindre en liberté, La figuration créative, Yves Desvaux Veeska
Simplification, stylisation, synthèse et couleur comme seul sujet de la peinture, Matisse influencera les peintres figuratifs ou abstraits du XXe siècle.
C’est d’abord le chef de file du fauvisme – terme inventé par le critique d’art Louis Vauxcelles après sa visite au Salon d’Automne de 1905, au Grand Palais. La salle VII qui expose les jeunes peintres est surnommée : « La cage aux Fauves » , allusion ironique aux couleurs et à la manière dont elles sont utilisées, orgie de tons purs et violents à l’extrême. Comme pour l’« impressionnisme » , le mot qui se veut critique est aussitôt revendiqué par les artistes concernés, Matisse en tête : « Le fauvisme secoue la tyrannie du divisionnisme. On ne peut pas vivre dans un ménage trop bien fait, un ménage de tantes de province. Ainsi on part dans la brousse pour se faire des moyens plus simples qui n’étouffent pas l’esprit. Il y a aussi l’influence de Gauguin et Van Gogh (…) Mon tableau La Musique était fait avec un beau bleu pour le ciel, le plus bleu des bleus. La surface était colorée à saturation, c’est-à-dire jusqu’au point où le bleu, l’idée du bleu absolu, apparaissait entièrement, le vert des arbres et le vermillon vibrant des corps. J’avais avec ces trois couleurs mon accord lumineux, et aussi la pureté dans la teinte. » (L’Intransigeant, 14 janvier 1929). André Gide et Guillaume Apollinaire approuvent, mais sur les murs de Montparnasse, on lit « Matisse rend fou, Matisse est plus dangereux que l’absinthe. »
Il signe en 1909 avec la célèbre galerie qui l’expose, il rencontre de grands collectionneurs américains, russes : Sergueï Chtchoukine lui commande deux toiles : La Danse et La Musique. Considérées comme deux chefs-d’œuvre, elles sont présentées au Salon d’automne (1910) et installées à Moscou en 1911. Sa vie niçoise, un paradis, commence pendant la Première Guerre mondiale. Il travaille avec acharnement, par variations et répétitions d’un même thème ou motif. Les premières études peuvent être très poussées, figuratives puis, de proche en proche, les formes se font plus stylisées, abstraites. Matisse photographie les différentes étapes de son travail. Les Américains appellent malicieusement cette période The Nice Period, la « période niçoise » ou la « jolie période » , par jeu de mots.
La couleur reste son obsession : « Je sens par la couleur, c’est donc par elle que ma toile sera toujours organisée (…) Le peintre choisit sa couleur dans l’intensité et la profondeur qui lui conviennent comme le musicien choisit le timbre et l’intensité de ses instruments (…) La couleur ne commande pas le dessin, elle s’accorde à lui (…) En peinture, les couleurs n’ont leur pouvoir et leur éloquence qu’employées à l’état pur quand leur éclat et leur pureté ne sont pas altérés, rabattus par des mélanges en opposition avec leur nature. »
Il voyage autour du monde, séjourne à New York et à Tahiti, mais il finit toujours par revenir sur la Côte d’Azur. Il se met à la sculpture, puis aux papiers découpés – handicapé, il peut encre jouer avec les formes et les couleurs, portant cette technique au rang des Beaux-Arts. Célèbre et partout célébré de son vivant, inventant à l’infini, il ne cessera d’influencer les artistes à venir. Matisse fut aussi l’ami de Picasso – son grand rival, aimait-il dire. Cela vous pose un peintre.
« Je ne cherche pas, je trouve. » « Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge. » 3142
Pablo PICASSO (1881-1973). Le Sens ou La Mort : essai sur Le Miroir des limbes d’André Malraux (2010), Claude Pillet
Le 8 avril 1973 meurt à Mougins le plus grand peintre du siècle, âgé de 91 ans et travaillant jusqu’au bout – il fut aussi dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste. Un mythe toujours vivant, même s’il fut ardemment contesté autant que passionnément prisé. Il révolutionne l’art en multipliant ses « périodes » : bleue, rose… mais aussi post-impressionniste, cubiste, surréaliste, moderniste. C’est un infatigable réinventeur de son art tout terrain (peinture, dessin, sculpture, gravure, poterie, céramique, tapisserie, estampe…).
En 1907, ses Demoiselles d’Avignon, rupture avec l’art figuratif et attentat contre la vraisemblance, provoquèrent stupeur et scandale. Malraux voit dans l’ensemble de son œuvre « la plus grande entreprise de destruction et de création de formes de notre temps. »
Les années 1970 et 1980 marquent une nouvelle explosion du marché de l’art, avec une inflation record des prix de vente : Yo Picasso (Moi Picasso, autoportrait) voit son prix décupler de 1981 à 1989 (310 millions de francs). En 2010, Nu au plateau de sculpteur (portrait de sa maîtresse et muse Marie-Thérèse Walter en 1932) bat le record de l’œuvre d’art la plus chère jamais vendue aux enchères : adjugée pour 106,4 millions de dollars chez Christie’s à New York.
« Vous aurez de l’encre noire, des tableaux noirs, des tabliers noirs. Le noir est, dans notre beau pays, la couleur de la jeunesse. »
Jean GIRAUDOUX (1882-1944), Intermezzo (1933)
C’est aussi la couleur passe-partout et du « bon goût » des voitures noires, des parapluies noirs, des tailleurs noirs… Avec le noir, on ne se trompe pas. La société bourgeoise, la morale bourgeoise s’en accommodent, mais pas la jeunesse que l’auteur – quoique très classique dans son inspiration et son écriture – se plaît toujours à défendre.
« Bleue, bleue, notre enfance fut un paradis :
On s’en aperçoit bien trop tard aujourd’hui. »Charles TRENET (1913-2001). L’École buissonnière (1933)
Le « Fou chantant » , complet-veston bleu et œillet rouge à la boutonnière, nous a légué un millier de chansons dont une vingtaine de « tubes » planétaires (La Mer, Je chante, Y’a d’la joie, Douce France…). La tonalité est à la gaieté, mais un fond de mélancolie nuance souvent la palette des sentiments.
À 20 ans, il associe l’enfance à la couleur bleue et au paradis. Élevé dans un collège religieux à Béziers, il confessera plus tard : « L’école était libre, pas moi » . Absence maternelle, homosexualité cachée. Le style « Fleur bleue » lui inspirera une autre chanson.
Pour Baudelaire, l’enfance fut aussi un paradis, mais peint en vert. C’est peu dire que le poète a toute liberté d’expression.
Blanche-neige et les Sept Nains, film d’animation en technicolor de Walt Disney (1937)
Cette œuvre mérite d’être à l’affiche pour deux raisons : son titre et le procédé technique.
Premier long-métrage d’animation et « classique d’animation » des studios Disney, sorti le 21 décembre 1937 au Carthay Circle Theater de Hollywood, le film est une adaptation du conte homonyme des frères Grimm paru en 1812, inspiré d’un conte germanique ancré dans la tradition de divers pays européens. En résumé…
Une bonne reine se désole de ne pas avoir d’enfant. Un jour d’hiver, assise près d’une fenêtre au cadre d’ébène, elle se pique le doigt en cousant. Quelques gouttes de sang tombent sur la neige : « Ah ! si j’avais une petite fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d’ébène ! » . Peu de temps après, elle meurt en accouchant d’une petite fille nommée Blanche-Neige. Les couleurs sont déjà bien exposées.
La suite de l’histoire doit être connue de tous, à commencer par les enfants. Le roi veuf se remarie avec une femme obsédée par sa beauté, rassurée par le miroir qui lui dit qu’elle est la plus belle. Mais Blanche-Neige grandit et un jour, c’est elle la plus belle ! Le miroir est formel. La marâtre ne peut le supporter. Trois fois, elle tente de tuer Blanche-Neige, mais chaque fois, les Sept Nains de la petite maison dans la forêt vont la sauver. La dernière fois, elle reste quand même endormie. L’amour d’un prince la réveille. Il l’épouse, la méchante reine invitée au mariage reconnaît Blanche-Neige. Terrifiée, la voilà condamnée à danser avec des souliers de fer chauffés au rouge, jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Les interprétations se suivent et se complètent : conte moral, initiatique, œdipien, féministe… Walt Disney en tire son premier film d’animation et profite d’un procédé nouveau, le technicolor qui va révolutionner l’art cinématographique. C’est un chef d’œuvre du genre, un triomphe commercial renouvelé à chaque génération. Des dizaines d’autres adaptations suivront.
SECONDE GUERRE MONDIALE
« S’il fallait l’étoile jaune pour reconnaître les Juifs sous l’Occupation, c’est donc qu’ils n’étaient pas si différents que le prétendait la propagande nazie. »
André FROSSARD (1915-1995), citation du Monde.fr, mais non sourcée
Avec une grand-mère maternelle juive et une grand-mère paternelle protestante, élevé dans l’agnosticisme parfait, « celui où la question de l’existence de Dieu ne se pose même plus » , il adopte à 20 ans, la religion catholique : « Dieu existe, je l’ai rencontré. » Titre d’un livre entre beaucoup d’autres consacrés à la foi.
Arrêté par la Gestapo de Lyon en 1943, interné dans la « Baraque aux juifs » de la prison Montluc, il sera l’un des sept rescapés, soixante-douze détenus sur soixante-dix-neuf ayant été massacrés à Bron le 17 août 1944. Après la guerre, il écrit dans L’Aurore, au Figaro, bientôt rédacteur en chef de l’hebdomadaire Temps présent. En 1990 il avait signé quelque 15 000 articles
Le statut discriminatoire des juifs, promulgué en septembre 1940 en zone occupée, est vite étendu à la zone sud, dite (momentanément) libre, et fortement aggravé en juin 1941. Le port de l’étoile jaune est imposé en juin 1942, les rafles se font systématiques dans les villes, les juifs sont parqués dans des camps, et déportés dans d’autres camps dont bien peu reviendront. Durant la grande rafle du Vel’ d’Hiv’ à Paris (nuit du 16 au 17 juillet 1942), 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants, sont arrêtés par la police française. Sur 8,3 millions de Juifs présents en 1939 dans les pays occupés par les nazis, 6 millions sont tués entre 1940 et 1945.
Dans certains camps, les homosexuels masculins allemands étaient marqués du triangle rose, les tsiganes d’un triangle rouge ou d’un triangle noir regroupant d’autres prisonniers « asociaux » – lesbiennes, prostituées, vagabonds, alcooliques, handicapés, malades mentaux.
« Ami, entends-tu
Le vol noir
Des corbeaux
Sur nos plaines ?
Ami, entends-tu
Ces cris sourds
Du pays
Qu’on enchaîne ? » 2798Joseph Kessel (1898-1979) et Maurice Druon (1918-2009), neveu de Kessel, paroles, et Anna Marly (1917-2006), musique, Le Chant des partisans (1943)
Chant de la Résistance, composé à Londres, sifflé par Claude Dauphin à la BBC, largué par la RAF (Royal Air Force, force aérienne royale) sur la France occupée, créé par Germaine Sablon (dans le film Pourquoi nous combattons) et repris par Yves Montand, entre autres interprètes. Marche au rythme lent, lancinant : « Ohé Partisans / Ouvriers / Et paysans / C’est l’alarme / Ce soir l’ennemi / Connaîtra / Le prix du sang / Et des larmes… / Ami si tu tombes / Un ami sort de l’ombre / À ta place. »
La Résistance, devenue un phénomène national, mêle tous les milieux, tous les courants d’opinion, toutes les régions, recréant une union sacrée contre l’ennemi dont la présence se fait de plus en plus insupportable, à mesure que ses « besoins de guerre » le rendent plus exigeant en hommes, en argent, en matières premières.
« Mon parti m’a rendu les couleurs de la France. » 2819
Louis ARAGON (1897-1982), La Diane française. « Du poète à son parti » (1945)
Littérature et politique : deux siècles de vie politique à travers les œuvres littéraires (1996), Michel Mopin, Robert Badinter.
« Mon parti mon parti, merci de tes leçons / Et depuis ce temps-là tout me vient en chansons / La colère et l’amour, la joie et la souffrance. »
Si le poète communiste rend ici nommément et servilement hommage au PCF, les autres œuvres de l’époque ont le ton d’une grande poésie nationale et patriote, ouverte à toutes les familles d’esprit : martyrs de la Résistance, communistes ou chrétiens y sont évoqués avec la même chaleur.
QUATRIÈME ET CINQUIÈME RÉPUBLIQUES
« Cette cage des mots, il faudra que j’en sorte
Et j’ai le cœur en sang d’en chercher la sortie
Ce monde blanc et noir, où donc en est la porte
Je brûle à ses barreaux mes doigts comme aux orties. » 2906Louis ARAGON (1897-1982), Le Roman inachevé (1956)
Dix ans après la guerre, ces vers reflètent le désarroi de l’intellectuel communiste, au lendemain du XXe Congrès et du rapport Khrouchtchev, en date du 25 février 1956. La vie et l’œuvre de Staline, le culte de la personnalité, tout a été remis en question. C’est le « dégel » en URSS.
En France, le PC prend acte avec mauvaise grâce. Staline était un Dieu vivant pour nombre d’écrivains français, ils sont à présent désarçonnés, déchirés.
La note bleue ou mystérieuse « blue note » .
« Revenir sur la question des blue notes, c’est revenir au blues, c’est-à-dire à l’invention même du jazz. » (Jean-François Baré, Des « notes bleues » , De la septième de dominante et de la musique en général).
Le dictionnaire Larousse n’en donne pas de définition. Mais en termes de solfège, c’est une altération de la gamme d’un demi ou d’un quart de ton. On la trouve, quoique rarement, dans la musique occidentale. Voir le Clavier bien tempéré de Bach. Il existe aussi des chromatismes chez Rameau.
La « blue note » est quand même associée au jazz. Quelques gammes africaines se superposent à la gamme européenne. Compositeurs et chanteurs de blues jouent de ce décalage à des fins expressives, pour illustrer à leur manière la nostalgie ou la tristesse – le blues renvoyant au Blue devils (littéralement diables bleus, autrement dit idées noires).
Le terme devenu magique de Blue note désigne un célèbre label de jazz, repris (en franchise commerciale) par des clubs de jazz à New York et dans d’autres grandes villes américaines, puis un fameux club de jazz parisien des années 1950 aujourd’hui disparu, une grande discothèque de Londres, un festival de jazz annuel à New York et bien d’autres manifestations.
Magie des notes, le blues fait toujours rêver, malgré le rock, le rap et la déferlante de vagues musicales presque toujours violentes : « Car toute la musique que j’aime / Elle vient de là, elle vient du blues » chantait Johnny Hallyday.
« Palsambleu, morbleu, ventrebleu, jarnibleu ! Dieu aussi a eu son époque bleue. »
Jacques PREVERT (1900-1977), Fatras (1966)
Et Prévert a eu son époque surréaliste. Créé en 1924 par André Breton, le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique né en France suite au choc monumental de la Première Guerre mondiale, dans la continuité du mouvement Dada (antibourgeois, antinationaliste et provocateur). Son but : créer une écriture plus spontanée dans laquelle on ne se plie pas aux règles formelles et esthétiques de l’époque, pour faire place à la création sans contrainte. Selon le chef de file du mouvement, le surréalisme est une recherche d’union entre le réel et l’imaginaire.
Jacques Prévert fera partie de ce mouvement littéraire de 1925 à 1929. Mais trop indépendant d’esprit, il supporte mal les exigences d’André Breton. Il opte alors pour la simplicité et les thèmes de la vie quotidienne – le travail, l’école. Ce qui fera sa popularité.
Du surréalisme, il garde pourtant l’idée que le rêve et la folie peuvent conduire à une autre réalité. Il aime aussi mêler le réel et le surréel : il introduit des éléments oniriques, fantastiques ou merveilleux dans un monde purement réaliste, ou bien quelques métaphores qui font basculer le lecteur dans un monde surréel.
« Un jour je peignais, le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans formes, sans contrastes, sans transparences. Dans cet extrême j’ai vu en quelque sorte la négation du noir (…) Mon instrument n’était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. »
Pierre SOULAGES (né en 1919), témoignage de 2005
Connu pour son usage des reflets de la couleur noire qu’il appelle « noir-lumière » ou « outrenoir » , Soulages est l’un des principaux représentants de la « peinture informelle » .
Saluons la longévité de nombreux peintres. Mais Soulages les bat sur ce terrain. À 101 ans, il continue d’œuvrer chaque jour à l’atelier, déclinant à l’infini SA couleur. « Enfant, j’aimais peindre, dessiner. On me donnait des couleurs mais je préférais tremper mon pinceau dans l’encrier. « Que dessines-tu ? » m’avait demandé ma mère, en me voyant peindre à l’encre noire. J’avais répondu « De la neige. » Tout le monde avait bien ri, mais j’avais saisi quelque chose, le contraste. »
Obsessionnel à l’évidence et toujours interrogé sur cette obsession, il a le mot de la fin tout provisoire : « Pourquoi le noir ? La seule réponse, incluant les raisons ignorées, tapies au plus obscur de nous-mêmes et du pouvoir de la peinture c’est : PARCE QUE. »
« Le drapeau tricolore est fait pour être déchiré, pour en faire un drapeau rouge. »
Daniel COHN–BENDIT (né en 1945), 21 mai 1968. Génération, tome I, Les Années de rêve (1987), Hervé Hamon, Patrick Rotman
Au cours d’un meeting fou, il lance cette déclaration. Pour insulte au drapeau national à l’étranger, le voilà interdit de séjour en France, le 22 mai. En réponse à cette interdiction de séjour, le 23 mai, un nouveau slogan s’affiche : « Nous sommes tous des juifs allemands. » Ce jeudi de l’Ascension, le mouvement de Mai 68 est relancé, manifs et bagarres redoublent, notamment au Quartier latin.
« Je vivais au jour le jour […] Je n’avais aucune idée de l’issue. Je ne savais pas où était la limite, s’il y avait une limite. Je me sentais isolé, coupé. J’étais déraciné politiquement, incapable de mener le débat avec les militants gauchistes qui avaient, eux, leurs certitudes. Je suis parti parce que j’étais dépassé. C’était une fuite. »
« C’est bonnet blanc et blanc bonnet. » 3111
Jacques DUCLOS (1896-1975), candidat communiste à la présidence, juin 1969. Histoire des présidentielles (2008), Olivier Duhamel
En 1969, le général de Gaulle démissionne de la présidence, suite à l’échec de son dernier référendum. D’où les nouvelles élections présidentielles.
Le Secrétaire général du Parti communiste a obtenu un bon score, plus de 21 % des voix. Il parle ici du choix entre Poher et Pompidou, les deux candidats de droite restant en lice pour le second tour de la présidentielle. L’abstention massive au second tour (31 %) aura une explication simple pour le PC : les électeurs n’ont pas voulu « avoir à choisir entre la peste et le choléra » , pour reprendre un mot de Thorez (en 1934). Autre façon d’exprimer un choix impossible ou dépourvu de signification.
Pompidou l’emporte confortablement, avec 58 % des suffrages exprimés. D’Irlande où il s’est volontairement exilé durant ces élections, le général de Gaulle lui envoie ce télégramme : « Pour toutes raisons nationales et personnelles, je vous adresse mes bien cordiales félicitations. »
« Dieu a créé les gens en technicolor. Dieu n’a jamais fait de différence entre un noir, un blanc, un bleu, un vert ou un rose. »
Bob MARLEY (1945-1981) Souvent cité, jamais sourcé
Robert Nesta Marley dit Bob Marley, auteur-compositeur-interprète jamaïcain, reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement rastafari de connaître une audience planétaire. Après une vie de galère et avant une mort précoce (à 38 ans), il a vendu plus de 200 millions de disques. Symbole mondial de la culture et de l’identité jamaïcaine, il plaide également pour le panafricanisme… et l’absurdité du racisme.
La France black blanc beur.3349
Slogan du 12 juillet 1998. Qu’est-ce que la France ? (2007), Alain Finkielkraut
Victoire ! Et divine diversion. Ce soir-là, ivre de joie, la France fête sa première Coupe du monde, gagnée par son équipe « black-blanc-beur » avec Zinédine Zidane en tête d’affiche, Zizou de légende comme le sport en crée toujours. Rappelons Michel Platini, au premier sacre européen, en 1984.
Que reste-t-il de ce moment de fraternité, les Champs-Élysées envahis par une foule bigarrée, cette France idéalement métissée ? « Ça n’a duré qu’un été » , selon Ludovic Lestrelin, maître de conférences en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives). « Un bel élan unanime a salué la victoire d’un État-nation, d’un modèle d’intégration, pas seulement d’une équipe. Ce sentiment venait d’ailleurs de toutes parts, du mouvement sportif, des politiques » , rappelle-t-il.
Les grands rendez-vous sportifs, tels les JO et les Coupes du monde, génèrent des mouvements collectifs très forts, mais éphémères. Et de tous les sports, le foot est celui dont la magie opère le plus spectaculairement.
« Génie de la Bastille qui culmine sur cette place, nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France. Nous sommes le drapeau rouge ! » 3474
Jean-Luc MÉLENCHON (né en 1951), Discours du 18 mars 2012 à Paris
À la Bastille, le tribun fait place comble ce dimanche et défie le temps à la pluie. Plus de 120 000 personnes ont défilé entre Nation et Bastille, dans la symbolique rue du Faubourg-Saint-Antoine, avant d’écouter le candidat du Front de gauche.
Porté par la vague rouge des drapeaux et l’enthousiasme de la foule, il dynamise une campagne sans thème majeur (sécurité en 2002, travail en 2007), plombée par le non-dit sur la crise et la perte de confiance dans le pouvoir du politique. Il appelle à prendre le pouvoir et donc à reprendre la Bastille. Ce jour doit marquer le début de « l’insurrection civique » et populariser sa « VIe République sociale, laïque et écologique » , avec le slogan : « Le vote Mélenchon, c’est le vote utile. » Autrement dit, il s’imagine en « dernier président de la Ve » et Marie-George Buffet fait chorus, au nom du PCF moribond.
Mélenchon va renouveler son exploit à Toulouse et à Marseille le 14 avril, rassemblant 100 000 fans sur la plage du Prado, avec des accents lyriques à la Hugo. Il redonne ce goût de la fête, ce bonheur d’être ensemble, unis par la même cause. Le drapeau rouge a des vertus civiques et citoyennes toujours vivantes.
Le dimanche précédant le premier tour, Sarkozy, place de la Concorde, et Hollande, face au Château de Vincennes, rassembleront chacun de son côté un nombre de manifestants non chiffré, mais inférieur.
« Ce qui s’est passé n’est pas l’affaire de la folie d’un homme, ce qui s’est passé est le début de l’avancée du fascisme vert dans notre pays. » 3478
Marine LE PEN (née en 1968), Meeting sous le chapiteau du Port Lavigne, 25 mars 2012
Le vert est censé être la couleur préférée de Mahomet. Le prophète de l’Islam porta un manteau et un turban verts. Le Coran décrit le paradis comme un endroit où les gens « porteront des vêtements verts en soie fine » . Un hadith (ou enseignement) précise : « Lorsque l’Apôtre d’Allah parvint au crépuscule de sa vie, il était couvert de l’Hibra Burd » , morceau de tissu vert. Le vert se retrouve dans la reliure du Coran, sur les dômes des mosquées, dans les campagnes politiques et sur les drapeaux de nombreux pays musulmans.
Trois jours après les tueries de Toulouse et Montauban, devant quelque 1 500 militants FN, la candidate, plus virulente que jamais, revient sur l’insécurité et l’immigration, ses thèmes favoris : « Combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d’immigrés ? […] Combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non-assimilés ? […] Mohamed Merah n’est peut-être que la partie émergée de l’iceberg ! »
Elle évoque des quartiers entiers soumis aux lois de la drogue et de l’islam radical, cette « gangrène […] conséquence de l’immigration de masse. » Des quartiers où l’on aurait « acheté la paix sociale à coups de milliards d’euros de politique de la ville […] pris dans la poche du contribuable honnête. » Et en réponse au mot de Mohamed Merah, elle lance : « Je mettrai l’islam radical à genoux ! »
Dans la salle survoltée, on scande « La France est chrétienne » , « Sarko collabo ! » .
En 2021, l’accusation portée contre l’université et la recherche « gangrenées » par l’islamo-gauchisme refait débat, mais ne fait pas l’unanimité au sein du gouvernement ni de la majorité. Le vert de l’écologie est heureusement beaucoup plus populaire.
« Quand les Verts voient rouge, ils votent blanc. »
Raymond DEVOS (1922-2006), La Bicyclette (1982)
Connu pour ses jeux de mots, l’humoriste ne pouvait pas rater le nouveau parti écolo qui accumule les faux pas politiques : « Les écolos sont capables du meilleur comme du pire ; mais c’est dans le pire qu’ils sont les meilleurs. » Parole de Gabriel Cohn-Bendit, frère aîné de Daniel, enseignant, libertaire et proche de l’écologiste Noël Mamère. Il sait donc de quoi il parle et durant la saison 2011-2012, les Verts vont se surpasser dans le pire, sans profiter d’un contexte favorable : l’écologie est le problème majeur pour l’avenir, et la cause écologique a la cote, dans une opinion de plus en plus sensible à l’environnement, alertée par les scientifiques et surinformée par les médias.
« Le « gilet jaune » a soudain changé de fonction. Il est devenu étendard de révolte. Pas de responsable, pas de chef, pas de structure, pas d’idéologie, ce qui a permis de rassembler les mécontentements, déceptions, frustrations, colères diverses et hétérogènes, du retraité au cultivateur, du membre du Rassemblement national au jeune urbain insoumis. »
Edgar MORIN (né en 1921), Le Monde, 4 décembre 2018
Le jaune, couleur mal aimée dans l’histoire, refait son apparition et le « peuple des ronds-points » rencontre une sympathie populaire, sans trouver de slogans dignes de ce nom comme en Mai 68. Les médias s’en emparent, les dérapages à Paris et dans d’autres villes sont repris en boucle sur les réseaux sociaux et les chaînes télé d’« info continue » : choc des images plus fortes que les mots sur BFMTV, Cnews, LCI… Mais cela ne fait pas sens, comme l’on dit.
Philosophe et sociologue, Edgar Morin analyse le mouvement des Gilets jaunes qui stupéfie la France. Peu d’analyses ont été aussi pertinentes… en même temps qu’impertinentes.
« La jaunisse est le signe d’une crise de foie. Les « gilets jaunes » sont le signe d’une crise de foi. Crise de la foi dans l’État, dans les institutions, dans les partis, dans la démocratie, dans ce que les partis appellent le système tout en faisant partie du système. »
Edgar MORIN (né en 1921), Le Monde, 4 décembre 2018
L’irruption soudaine de ce mouvement imprévu, son ampleur, ses désordres, puis les violences du samedi 1er décembre nous obligent à réviser les modes de penser prééminents sur notre société, sur sa civilisation, sur leurs carences et misères tant physiques que morales, sur notre République, sur notre présent, notre avenir et à repenser notre politique.
La longue apathie de nos concitoyens devant les multiples restrictions et suppressions appelées réformes donnait l’illusion de l’acceptation ou de la résignation. Alors qu’une fois de plus un feu couvait dans le sous-sol d’un édifice qu’on croyait stable, et la taxe carbone a fait la brèche qui l’a déchaîné.
Le « gilet jaune » a soudain changé de fonction. Il est devenu étendard de révolte. Pas de responsable, pas de chef, pas de structure, pas d’idéologie, ce qui a permis de rassembler les mécontentements, déceptions, frustrations, colères diverses et hétérogènes, du retraité au cultivateur, du membre du Rassemblement national au jeune urbain insoumis.
Mais cette force initiale est devenue un handicap au moment où il fallait annoncer sinon un programme du moins une orientation pour des réformes, et non des suppressions fiscales ou la démission du président. Certes des revendications multiples formulées à travers des voix diverses comportent des suggestions pertinentes mêlées à des idées farfelues. Mais il manque une pensée directrice et une telle pensée conduirait à un éclatement entre les composantes hétérogènes d’un mouvement où les colères unies contre le pouvoir, sont en fait antagonistes entre elles. Donc tout ce qui a fait la réussite du mouvement risque de le conduire à un échec final. » C’était bien vu.
… Et au final, le Bleu est le grand gagnant toute catégorie de l’Histoire.
L’historien contemporain Michel Pastoureau a commencé par écrire : Bleu. Histoire d’une couleur (Le Seuil, 2000). Encouragé par l’intérêt du grand public, il a enchaîné sur Noir (2008), Vert (2013), Rouge (2016), Jaune (2019).
Pour résumer cette success-story, le bleu entre dans l’Histoire pour détrôner le rouge au cœur du Moyen Âge très chrétien : il s’impose comme couleur du manteau de la Vierge, il éclate dans les vitraux gothiques. Il entre aussi en politique et devient royal : les armoiries familiales des Capet (fleurs de lys sur fond d’azur) deviennent l’emblème du roi de France vers 1130. Le rouge, première « couleur par excellence » , reste impérial et papal, mais le bleu devient royal. Vers 1400, il domine dans un tiers des armoiries.
Le bleu triomphe au XVIIIe et se diversifie : pastel européen contre indigo exotique. Une fraude commerciale donne naissance à un nouveau pigment, le bleu de Prusse. Les progrès techniques permettent d’étendre encore la gamme à l’infini entre le bleu vert (turquoise) et le bleu rouge (violet). Goethe lance le bleu romantique avec l’habit bleu de Werther (1774) et la « petite fleur bleue » de Novalis, couleur de la mélancolie et du rêve, aboutira un siècle après au blues anglo-américain.
Le bleu politique s’affirme en France avec la Révolution, passant des armoiries à la cocarde et au drapeau (tricolores) et aux uniformes. Il se mondialise en couleur de la paix et de l’entente (ONU, Europe). Côté vestimentaire, le noir se transforme en bleu marine autour de 1930 sur presque tous les uniformes (marins, policiers, pompiers, facteurs) et le bleu civil s’impose avec le célèbre blue jean. Petite histoire dans l’Histoire, inventé aux États-Unis en 1853 par un émigré venu d’Allemagne et marron à l’origine, suite à une rupture du stock en 1860, Oscar Levi Strauss s’est rabattu sur une autre toile de coton : le bleu de Gênes. Vêtement de travail solide et peu salissant pour les ouvriers, c’est devenu une mode indémodable et mondiale.
Selon divers sondages, le bleu est aujourd’hui la couleur préférée des Français. C’est la couleur nationale dans les sports d’équipe, les plus populaires et médiatisés : football, rugby, handball, basketball, volley-ball et même le tennis (en Coupe Davis).
Le bleu règne aussi en musique : rappelons la mystérieuse blue note ou note bleue (liée au blues du jazz), sa prédominance dans les chansons pour la simple raison que le mot est plus facile à prononcer que vert, jaune, rouge… plus évocateur aussi et propice au rêve.
Sur la Terre, le vert l’emporte – avec les forêts et toute la végétation. Mais au niveau planétaire (et malgré la pollution), le bleu domine avec le ciel infini et la mer couvrant près des trois quarts de la surface du globe.