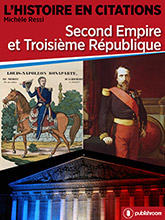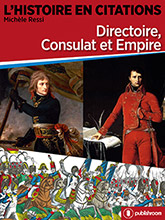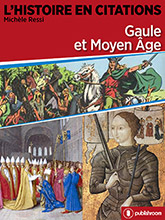Depuis 1901, six domaines sont récompensés : Prix Nobel de la paix (10 lauréats français), de littérature (15), de physique (17), de chimie (10), de physiologie ou médecine (13), d’économie (4). Au total 69 lauréat(e)s.
Les femmes sont très sous-représentées, mais bien présentes dans la famille Curie qui bat tous les records, au fil d’une saga passionnante (voir nos éditos : Femmes, Panthéon).
Dans cette sélection de 30 noms, L’Histoire en citations apparaît en bonne place avec Romain Rolland, Anatole France, Aristide Briand, Roger Martin du Gard, André Gide, François Mauriac, Albert Camus, cités pour leur rôle politique plus que littéraire.
Trois cas particuliers : Jean-Paul Sartre refuse le prix, la CEE le reçoit en des circonstances chaotiques, MSF (Médecins sans frontières) est associé au nom de son co-fondateur, Bernard Kouchner.
Sont exclus de cet édito des lauréats peu connus et peu médiatiques, avec une majorité de scientifiques dont les travaux restent difficilement accessibles au public.
Dernière catégorie qui nous tient à cœur, les « Nobel de l’Histoire en citations ».
Voici 10 grands noms, absents de la liste officielle, mais candidats légitimes au Nobel de la paix : « hors-jeu » mort avant 1901 et mondialement connu, le scientifique Louis Pasteur, l’incontournable général de Gaulle (présent en 1963 sur la liste des 80 candidats en… Littérature !) et un « outsider » de renommée internationale, l’Abbé Pierre, héros de film en 1989 et 2023.
Restent sept autres noms connus à divers titres : Émile Zola, Jean Jaurès, Charles Péguy, André Malraux, Paul Valéry, Pierre Mendès France, Joséphine Baker.
À vous de juger s’ils méritaient de figurer sur la liste des Nobel… et de suggérer d’autres noms.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
11. Frédéric Joliot-Curie (1935)

En 1935, Frédéric Joliot-Curie et sa femme obtiennent le prix Nobel de chimie « en reconnaissance de leur synthèse de nouveaux éléments radioactifs ». La grande famille scientifique est de retour… et s’engage en politique. Sujet doublement explosif et cas de conscience dramatique.
« Je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir. »2643
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958). La Politique en citations : de Babylone à Michel Serres (2006), Sylvère Christophe
Position radicale – et radicalement différente d’Anatole France et Romain Rolland, Nobels de littérature. Ce grand scientifique, membre actif du Parti communiste à partir de 1942, fait partie des intellectuels du milieu du XXe siècle au carrefour entre recherche pure, applications sociales et combat politique.
Pour diverses raisons, c’est l’âge d’or du communisme en France, avec les cas de conscience que cela entraîne – voir Gide et Sartre. Rappelons aussi ces deux adages : « Celui qui n’est pas communiste à vingt ans n’a pas de cœur ; celui qui l’est encore à quarante ans n’a pas de tête. » Et mieux ou pire encore : « Un communiste, c’est quelqu’un qui a lu Marx, et un anti-communiste, c’est quelqu’un qui l’a compris. »
L’inconditionnalité de Joliot-Curie peut s’expliquer simplement. Il veut consacrer tout son temps de « cerveau humain disponible » à ses recherches et aux postes importants qu’il occupera - professeur au Collège de France, directeur de l’Institut du radium, membre de l’Académie des sciences, directeur général du CNRS, premier Haut-Commissaire du CEA (Commissariat à l’Énergie atomique). Mais certains éléments de sa biographie laissent penser qu’une telle attitude n’allait pas sans problème de conscience.
« Ce fut certainement une grande satisfaction pour notre regrettée Maître Marie Curie d’avoir vu ainsi se prolonger cette liste des radioéléments qu’elle avait eu, en compagnie de Pierre Curie, la gloire d’inaugurer. »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958), Conférence Nobel (1935)
Il a pris ce nouveau patronyme sur le conseil de Paul Langevin, éminent scientifique proche des deux couples, Pierre et Marie Curie, puis leur gendre Frédéric Joliot épousant leur fille Irène Curie : leurs travaux portent aussi sur la radioactivité et le nom de Curie est une référence inestimable dans le domaine scientifique.
Dans son discours, il rend un hommage ému à Marie Curie, morte de leucémie suite à ses expériences sur la radioactivité naturelle. En janvier 1934, elle eut le temps d’assister à la découverte de la radioactivité artificielle par sa fille et son gendre. Ils disposaient de sources importantes de corps radioactifs comme le polonium, issu du radium D, soigneusement conservées à l’Institut du Radium par Marie Curie.
Le nouveau couple a finalement démontré la possibilité de rendre radioactif un élément qui ne l’est pas ou de transformer un élément stable en un élément radioactif. L’homme est capable de maîtriser ce phénomène extraordinaire ouvrant la voie à une nouvelle ère scientifique et technique.
Le Nobel les récompense aussitôt – le marathon scientifique se transformant en sprint, vu l’enjeu vital et mondial pour la paix - et la guerre qui s’annonce.
« Si, tournés vers le passé, nous jetons un regard sur les progrès accomplis par la science à une allure toujours croissante, nous sommes en droit de penser que les chercheurs construisant ou brisant les éléments à volonté sauront réaliser des transmutations à caractère explosif, véritables réactions chimiques à chaînes. »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958), Conférence Nobel (1935)
Évoquant les nouveaux « neutrons », il se fait littéralement prophétique en recevant le prix, un an après cette découverte fondamentale qui aboutira à la « bombe atomique ».
Mais le climat de l’entre-deux guerres est en lui-même explosif, les chercheurs se précipitent pour déposer brevet sur brevet. L’Allemagne fasciste a une longueur d’avance, les États-Unis, plus puissants, sont les mieux « armés » pour éviter le pire, de grands scientifiques passant dans leur camp par peur du fascisme menaçant.
La Seconde Guerre mondiale commence mal, en 1939. Après la « drôle de guerre », la France subit l’Occupation allemande. Frédéric Joliot-Curie s’engage dans la Résistance, comme nombre de camarades communistes.
« Nous autres, savants français, passionnément attachés à notre pays, devons avoir le courage moral de tirer la leçon de notre défaite. »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958), 15 février 1941, interview au journal collaborationniste Les Nouveaux Temps
Résistant, mais communiste et mal vu par les États-Unis qui ont l’argent, le pouvoir, les matériaux nécessaires à leur projet nucléaire et les plus grands savants, à commencer par Oppenheimer (bientôt baptisé « le père de la bombe atomique ») et Einstein, apatride devenu « helvético-américain » en 1940, fervent pacifiste et pourtant associé à la conception de la bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Joliot-Curie est seul en France, sans ses collaborateurs, Hans von Halban et Lew Kowarski réfugiés en Angleterre, sans argent, alors qu’il lui faudrait des tonnes de matériaux pour continuer ses expériences ! Il doit attendre la fin de la guerre. Et la victoire a un goût amer, après l’explosion de la bombe atomique.
« Il fut très déprimé par la nouvelle et avait l’impression d’avoir été pris au piège, et d’être en partie responsable à cause de ses travaux d’avant-guerre. Pour lui, l’utilisation de l’énergie nucléaire ne pouvait se justifier que pour le bienfait de l’humanité. »8
Michel PINAULT (né en 1951) citant Victor Henri, élève de Joliot-Curie apprenant le bombardement sur Hiroshima. Association Française pour l’Information Scientifique, Frédéric Joliot-Curie et l’arme atomique, publié en ligne le 10 juillet 2004
Pendant l’été 1945 et pour la première fois depuis l’été 1939, les Joliot se reposaient en Bretagne, quand ils apprirent la nouvelle. Rappelons les faits. Le Japon, écrasé par les bombardements (dits) conventionnels, résiste encore, trois mois après la capitulation allemande. La caste militaire refuse une telle issue et l’amiral Onishi, initiateur des « kamikazes », envisage froidement la mort de 20 millions de Japonais… Harry Truman, président des États-Unis, décide le 6 août 1945 de lancer la première bombe atomique. Hiroshima : près de 100 000 morts des suites de l’explosion. Le 9 août, à Nagasaki, deuxième bombe atomique. Hiro-Hito l’empereur impose alors au pays sa volonté : le Japon capitule.
Il faut rappeler que sans ce recours à l’arme atomique, les plans les plus optimistes prévoyaient un débarquement qui aurait coûté dix-huit mois de préparation et un million de morts. La coopération des savants américains, anglais, canadiens, français, italiens et danois, permit également de devancer les « ingénieurs » allemands, près de trouver l’arme absolue. L’issue de la guerre et la face du monde en auraient été changées.
Dans L’Humanité du 10 août, Joliot déclara : « Personnellement, je suis convaincu qu’en dépit des sentiments provoqués par l’application à des fins destructrices de l’énergie atomique, celle-ci rendra aux hommes, dans la paix, des services inestimables ». Pourtant, la nouvelle l’atteint brutalement.
Et une autre guerre commence dont on n’imagine pas aujourd’hui la violence, entre les deux blocs, Ouest et Est, plus précisément les deux grandes puissances, USA et URSS. C’est la guerre froide de 1947 à 1991 ! « Dans une démocratie, tous les communistes sont des espions et des traîtres en puissance. » Si les Américains le disent et l’écrivent sans nuance, la situation des communistes n’est pas plus simple en France.
« Nous ne nous réunissons pas ici pour demander, mais pour imposer la paix aux partisans de la guerre. Si demain on nous demande de faire du travail de guerre, de faire la bombe atomique, nous répondrons : non ! »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958) à l’ouverture du Congrès des Partisans de la Paix à Paris, 20 au 23 avril 1949
Il s’impose désormais en pacifiste absolu. Il persiste et signe – pas question de juger s’il a tort ou raison, compte tenu du contexte littéralement explosif. Mais sa position extrême va entraver sa carrière scientifique, cependant que toutes les grandes puissances à venir voudront tôt ou tard avoir la bombe atomique.
Dans les coulisses de l’Histoire, les scientifiques perdront contre les politiques qui ont un argument imparable, en parlant de l’élite diplômée des Mines ou de Polytechnique : « Quand ils en sortent, il savent tout, mais ils ne savent que ça. » (mot attribué au maréchal Pétain)
« Les savants communistes et progressistes ne donneront pas une miette de leur savoir pour la bombe atomique. »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958) au cours d’un meeting d’avril 1950, Les dossiers du Canard, La force de frappe tranquille, 1984
Dans cette nouvelle guerre froide, la France veut sa bombe et les Français aussi (sondage de 1946). Mais Joliot-Curie persiste… et signe plus que jamais toutes les pétitions, manifeste à toutes les occasions qui lui sont données, vu son nom médiatique et son aura scientifique.
« Le peuple français ne veut pas faire et ne fera jamais la guerre à l’Union soviétique […] Les savants progressistes et communistes ne donneront pas une miette de leur savoir [dans ce but]. »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958), Un mois plus tard, au cours d’un grand meeting du parti communiste, mai 1950
En mars 1950, à Stockholm, le savant français fut le premier à signer « l’appel de Stockholm » pour l’interdiction des armes nucléaires. Signé par des millions de personnes dans le monde, ce texte devient le cheval de bataille des communistes français faisant campagne contre la bombe et multipliant les grèves, les sabotages, les déclarations…
« Si le gouvernement ne me sacque pas après ça, je ne sais pas ce qu’il leur faut ! »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958), Les Barons de l’atome, Peter Pringle, James Spigelman (1982)
Lucide malgré tout et bien trop intelligent pour ne pas savoir qu’il va perdre ce combat « pour l’honneur »…
En 1945, il avait fondé le CEA (Commissariat à l’énergie atomique), nommé haut-commissaire par le général de Gaulle. Bien décidé à réussir en dépit des obstacles, il fouillait les poubelles des surplus de guerre américains en Europe. Ses collaborateurs toujours motivés parvenaient à lui fournir du matériel radio, s’appropriant aussi des machines-outils trouvées dans la zone d’occupation française en Allemagne.
Mais Joliot-Curie perd son poste stratégique en 1950 : révoqué sans explication par Georges Bidault, le président du Conseil cédant aux pressions des députés de droite et du centre qui le somment de débarrasser le pays de son plus célèbre homme de science.
« Jamais je ne me suis senti aussi libre. »
Frédéric JOLIOT-CURIE (1900-1958), Le Monde, 23 juillet 1956
En juillet 1956, le XIVe congrès du PC au Havre a élu le savant au Comité central du parti. Selon certaines sources proches et bien informées, mais discrètes vu le sujet, il ne s’est pas senti si « libre ».
Un autre intellectuel engagé inconditionnellement à gauche a dit son mal être à ce sujet : « Cette prison des mots, il faudra que j’en sorte ! » Mais ce n’était qu’un poète, Louis Aragon. Il aurait pu avoir un Nobel de Littérature, mais la concurrence (internationale) était rude.
Joliot-Curie meurt peu après, d’une maladie du foie imputée à une surexposition aux radiations – comme la leucémie de sa femme, morte deux ans avant.
« En hommage au grand savant dont chaque homme doit garder en mémoire les avertissements solennels sur le péril atomique. »
Le Mouvement de la paix français (1959), légende sous le portrait de Joliot-Curie
Cette organisation pacifiste française en relation avec l’ONU lui rend hommage en éditant une carte postale avec son portrait dessiné par Picasso, accompagné de ce texte. Frédéric Joliot-Curie est mort le 14 août 1958, à 58 ans. C’est l’année où de Gaulle revient triomphalement au pouvoir.
Malgré la vive opposition de ses fidèles, le général lui fait des funérailles nationales. Dans la mort, la gloire de Joliot transcende les querelles politiques. Et deux ans après…
« Hourra pour la France ! Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. »2991
Charles de GAULLE (1890-1970), Télégramme, 13 février 1960. De Gaulle : le souverain, 1959-1970 (1986), Jean Lacouture
Première explosion de la bombe A française à Reggane (Sahara). C’est une étape dans la politique d’indépendance militaire du général qui se refuse à la « docilité atlantique » et veut doter le pays des « moyens modernes de la dissuasion ». La France entre ainsi dans le club encore très fermé des puissances atomiques. Elle refusera de signer le traité de Moscou du 3 août 1963, sur la non-prolifération nucléaire. Le 28 août 1968, c’est l’explosion de la première bombe H dans le Pacifique. Peut-on, doit-on parler d’une défaite de Frédéric Joliot-Curie et de son pacifisme absolu ?
Le cas de sa femme et co-équipière est différent. Son combat politique tout aussi tenace porte sur un sujet malgré tout plus consensuel (ou moins clivant que la bombe) quoiqu’on en dise : la cause des femmes.
12. Irène Joliot-Curie (1935)

Prix Nobel de chimie en 1935, pour la découverte de la radioactivité artificielle avec Frédéric Joliot-Curie.
« Il y avait des questions sur lesquelles ma mère avait des opinions d’une intransigeance absolue. Par exemple, elle estimait que les femmes devaient avoir les mêmes droits, et d’ailleurs les mêmes devoirs que les hommes… Je subissais fortement l’influence de ma mère. »2
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), « Marie Curie, ma mère », article publié en décembre 1954, commandé par la revue Europe à l’occasion des 20 ans de la mort de Marie Curie
La dernière remarque en forme d’aveu est évidente, vu la proximité des deux femmes et la forte personnalité de Marie qui ne pouvait qu’impressionner sa fille.
« Une femme de science doit renoncer aux obligations mondaines… Les obligations familiales, elle peut les accepter à condition d’en assumer la charge en surcroît. C’est alors très lourd mais ce n’est pas impossible à concilier (…) Pour ma part, je considère la science comme l’intérêt primordial de ma vie. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), Le Quotidien, 31 mars 1925, article de Denise Moran, Archives Curie
Elle s’exprime après sa soutenance de thèse. À 27 ans, elle a déjà ses deux enfants : Hélène née en 1927, future physicienne qui « parlait de particules à six ans », et Pierre né en 1932, biologiste, chercheur CNRS à l’Institut de biologie physico-chimique (IBPC).
Le couple assumera leur éducation avec une alternance parentale rare à l’époque, Irène étant parfois plus occupée (et fatiguée) que Frédéric.
« Pour que la femme conquière l’égalité avec les hommes, il est nécessaire, indispensable qu’elle ait le droit de participer à la vie politique du pays. Le droit de vote des femmes, c’est une question de principe et les questions de principe ont une très grande importance. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956) en 1925, article d’Heures Claires en mai 1954, interview à l’occasion du 10e anniversaire de l’acquisition du droit de vote par les femmes
Classée « femme politique française », elle se revendique à la fois « suffragiste » et féministe. Le terme souvent péjoratif ou « folklorique » de suffragette est réservé aux Anglaises de la Women’s Social and Political Union (WSPU), pionnières dans ce combat en 1903. On comptait quand même 350 000 suffragettes françaises en 1927, menant des actions parfois spectaculaires pour la bonne cause – leur droit de vote.
« Si, aujourd’hui, la distinction flatteuse qu’il plut à l’Académie des Sciences [de Stockholm] de m’accorder, a mis mon nom, le nom d’une femme, un peu plus en lumière qu’à d’autres jours, je sens le devoir d’affirmer certaines idées que je crois utiles à toutes les femmes françaises. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), 1935. Le Journal de la Femme, 23 novembre 1935, article de George Sinclair intitulé « Pour les femmes ! »
Suite au prix Nobel, sa notoriété nouvelle, sa filiation prestigieuse, son accomplissement personnel de femme, mère, enseignante et chercheuse, suscitent un regain d’intérêt pour la place des femmes dans la société. En digne fille de sa mère Marie Curie, Irène va s’attacher à démontrer que la science n’a pas de sexe.
« Parmi les conquêtes du féminisme, il n’en est pas de plus importante que le droit pour la femme d’obtenir les emplois pour lesquels elle est qualifiée par ses connaissances et ses aptitudes. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), « Sur le travail des femmes », France Vivante, 1935
Les droits économiques priment alors sur les droits politiques – rappelons que la France subit avec retard la grande crise de 1929. En fait, les deux types de droits sont également essentiels – mais parfois dissociés. De nos jours, l’égalité économique n’est pas encore acquise.
« Je ne me suis jamais enfermée dans les travaux scientifiques sans conserver le souci et la curiosité de la vie. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), à Marie-Jeanne Viel pour l’hebdomadaire Le Journal de la femme. juin 1936
Elle vient d’entrer dans le ministère Blum du Front national, naturellement en vedette (mais ce rôle lui déplaît). Éternel dilemme pour la femme plus que le mari, même si les habitudes changent lentement et sûrement – alors qu’un droit fait loi, sitôt que voté.
« Pierre et Marie Curie d’une part, Irène et Frédéric Joliot-Curie d’autre part, viennent nous donner un symbole frappant, une démonstration décisive de cette fécondité de la collaboration des deux sexes dans le domaine scientifique que nous pouvons considérer comme étant un des plus élevés. »
Paul LANGEVIN ( 1872-1946), dîner du Cercle de l’Union interalliée en l’honneur du couple nobélisé, 1936
Ce choix du double patronyme, qui va à l’encontre des habitudes de l’époque, entend signifier une relation égalitaire et couronne davantage le couple de savants que chacun des deux. Le prestige du nom de Curie satisfait un besoin de reconnaissance chez Frédéric Joliot ; mais l’association des deux noms ne traduit pas moins l’aspiration d’Irène à l’égalité. « Joliot-Curie », pour la vie courante, consacre donc à la fois la référence scientifique et la référence féministe égalitaire.
« Pour faire avancer la cause des femmes. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), Mai 1936, devenue ministre sous le Front populaire (plus exactement sous-secrétaire d’État à la recherche scientifique dans le gouvernement)
Elle ne semble pas l’avoir vraiment désiré, mais elle accepte le poste comme « un sacrifice pour la cause féministe en France ». Elle ne restera que trois mois, c’était semble-t-il décidé au départ et pour diverses raisons, personnelles et politiques – ajoutons que son ministre de tutelle Jean Zay (panthéonisé à justes titres au pluriel) lui interdit quand même de prendre la parole à l’Assemblée nationale !
« Trois hirondelles ne font pas un printemps ! »
Louise WEISS (1893-1983), Des manifestations féministes aux premières femmes sous-secrétaires d’État (1932-1936), Site du Sénat
Louise Weiss qui a toujours son franc-parler peut envier l’hirondelle la plus célèbre du trio… Elle reste néanmoins une féministe engagée sous tous les fronts et une européenne infatigable.
Mais pour certaines militantes, l’arrivée de ces trois ministres est un leurre qui ne va pas changer la situation politique des femmes. Elles accusent même Léon Blum de vouloir endormir le combat féministe… Le seul combat politique qui vaille, c’est le droit de vote.
« Ceux qui ont cette peur maladive du communisme sont les mêmes que vous trouverez toujours essayant d’étouffer les idées nouvelles : vous trouverez parmi eux les ennemis d’une coopération internationale sincère, aussi bien que les ennemis des véritables démocraties, les ennemis du féminisme et les ennemis de la paix. »
Irène JOLIOT-CURIE (1897-1956), citée par Michel Pinaut, Frédéric Joliot-Curie (2000)
Entrée de plain-pied dans « la guerre froide » qui commence en 1947 et dont elle ne verra pas la fin, elle est influencée par l’adhésion inconditionnelle de son mari à la cause : « Je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir. » Cette lutte idéologique entre progrès et réaction, cette radicalisation concerna nombre d’intellectuels et scientifiques engagés : elle est née des désillusions d’après-guerre.
Le féminisme d’Irène Joliot-Curie devient l’expression de son engagement citoyen, celui d’une scientifique pétrie de valeurs républicaines qui idéalise ce qu’elle croit comprendre de l’URSS… ou ce qu’on lui en a donné à voir.
À la différence de sa mère qui s’est tenue à l’écart de l’arène politique, elle appartient à cette génération mêlée à la crise, à la politique et à la guerre, confrontée à la défense de la démocratie et à l’espérance du communisme. Tout en se différenciant de son mari, plus nuancée dans l’action comme dans la réflexion, elle a toujours poursuivi l’objectif politique : faire avancer la cause des femmes.
On pourra discuter à l’infini et l’on ne s’en est pas privé : droits économiques (travail) ou droits politiques (vote). Mais Irène Joliot-Curie reste avant tout comme une grande scientifique. De 1946 à 1956, professeur titulaire de la chaire de physique générale et radioactivité de la Faculté des sciences de Paris, directrice du laboratoire Curie, commissaire à l’énergie atomique jusqu’en 1951. Le 17 mars 1956, elle meurt des suites d’une leucémie, comme sa mère. Quatre jours après, elle aura droit à des funérailles nationales – comme son mari, deux ans plus tard. La similitude de leur destin combattant est frappante, frère et sœur jusque dans leur ressemblance photographique.
13. Roger Martin du Gard (1937)

Prix Nobel de Littérature « pour le pouvoir artistique et la vérité avec laquelle il a décrit les conflits humains et certains des aspects fondamentaux de la vie contemporaine dans son roman Les Thibault. »
« Quand la vérité est libre et l’erreur aussi, ce n’est pas l’erreur qui triomphe. »3
Roger MARTIN du GARD (1881-1958), Jean Barois (1913)
Sur le fond, l’action est située historiquement : on voit les rebondissements de l’Affaire Dreyfus, parfaitement documentée, clairement exposée. Avec des mots en situation que tous les grands dreyfusards auraient pu dire, à commencer par Zola :
« L’intelligence doit vivifier l’action ; sans elle, l’action est vaine. Mais sans l’action, comme l’intelligence est stérile ! »
« L’existence toute entière est un combat ; la vie, c’est de la victoire qui dure. »
Jean Barois a passionné des générations de lecteurs : le jeune écrivain aborde frontalement les problèmes généraux concernant la libre pensée, l’avenir de la science, la Vérité et la justice.
Ses personnages illustrent quelques-unes des positions vitales entre lesquelles il faut choisir. Mais ce sont des personnages de chair et de sang. Il peint aussi le vieillissement tragique de l’homme, dans son corps, son cœur et son intelligence, l’angoisse devant la maladie et la mort.
Mais d’un point de vue purement littéraire, l’auteur invente le découpage cinématographique à une époque où le cinéma en est à ses balbutiements. On voit même en lui un écrivain d’avant-garde qui annoncerait le Nouveau roman – Claude Simon sera prix Nobel en son temps (1985).
« Ce qui me séduisit tout de suite dans Jean Barois, ce fut la forme, si neuve et si imitée depuis, la sécheresse de ce découpage de film… Puis je fus conquis plus profondément par l’ouvrage, ce panorama de l’intelligence française. »
Paul MORAND (1888-1976), cité dans les rééditions de Jean Barois
Albert Camus va lire et approuver pour d’autres raisons qui lui sont personnelles : « Dans Jean Barois, les individus sont intacts et la douleur de l’histoire toute fraîche. »
Après la publication d’un roman et d’une nouvelle à compte d’auteur, Roger Martin du Gard attire l’attention du milieu littéraire en proposant au comité de lecture de Gaston Gallimard ce « roman dialogué ». Il lui vaut l’amitié complice d’André Gide, véritablement importantes et enrichissantes dans sa carrière.
Puis c’est la guerre et le départ sur divers fronts. Démobilisé, il établit le plan de son œuvre maîtresse, Les Thibault L’Histoire s’invite à nouveau dans l’œuvre de Martin du Gard.
« Vois-tu, je pense à ceci que nous sommes deux frères. Ça n’a l’air de rien, et pourtant c’est une chose toute nouvelle pour moi, et très grave. Frères ! Non seulement le même sang, mais les mêmes racines depuis le commencement des âges, exactement le même jet de sève, le même élan ! Nous ne sommes pas seulement deux individus, Antoine et Jacques : nous sommes deux Thibault, nous sommes les Thibault. (…) C’est en nous que l’arbre Thibault doit s’épanouir : l’épanouissement d’une lignée ! »
Roger MARTIN du GARD (1881-1958), Les Thibaud, Le Cahier gris (1922)
C’est à partir de ces deux personnages que se battit la fresque magistrale, initialement intitulée Deux frères.
Le cycle se compose de huit volumes, huit romans où les personnages se retrouvent et se perdent : Le Cahier gris (1922), Le Pénitencier (1922), La Belle Saison (1923), La Consultation (1928), La Sorellina (1928), La Mort du Père (1929), L’Été 1914 (1936), Épilogue (1940).
Pour cette histoire d’une famille, véritable panorama de la vie française, l’auteur reçoit le Prix Nobel en 1937 et le Grand Prix littéraire de la Ville de Paris, avant même que la fin soit éditée au début de la Seconde Guerre mondiale.
« On ne peut pas demander au capitalisme de se détruire lui-même en sapant ses propres assises ! Quand il se trouve par trop acculé aux désordres qu’il a créés, il emprunte aux idées socialistes quelques réformes devenues indispensables. »2551
Roger MARTIN du GARD (1881-1958), Les Thibault, La Sorellina (1928)
La série des Thibault est aussi un grand document sociologique, histoire minutieuse de la crise politique et sociale de la France avant la guerre de 1914-1918.
L’analyse de l’auteur est parfaitement confirmée par les faits. À la question sociale, problème majeur de la République à cette époque, quelles sont les réponses apportées ? Faute d’un programme social digne de ce nom, quelques lois : uniformisation de la journée de travail, 11 heures, puis 10 heures dans un délai de quatre ans (loi Millerand du 30 mars 1900) ; préparation du Code du travail (1902) ; hygiène dans les ateliers (11 juillet 1903) ; repos hebdomadaire (3 juillet 1906) ; retraites ouvrières et paysannes, à 60 ans (9 avril 1910).
« Le courage, le vrai, ça n’est pas d’attendre avec calme l’événement ; c’est de courir au-devant, pour le connaître le plus tôt possible, et l’accepter. »
Roger MARTIN du GARD (1881-1958), Les Thibault
Comment donner une idée de cette saga historique ? Le plus simple est de choisir quelques citations qui donnent le ton, forme et fond, et parlent pour l’auteur témoin de son temps :
« La vie serait impossible si l’on se souvenait, le tout est de choisir ce qu’on doit oublier. »
« Le difficile n’est pas d’avoir été quelqu’un, c’est de le rester. »
« Tous les gestes engagent ; surtout les gestes généreux. »
« J’ai horreur du dimanche : tous ces gens qui encombrent les rues, sous prétexte de se reposer. »
« Dans chaque Français, il y a un sceptique qui ne dort jamais que d’un demi-œil. »
« Dans chaque existence humaine, il vient un jour, une heure, un bref instant où Dieu, tout à coup, daigne apparaître dans toute son évidence et nous tend brusquement la main. »
« Les « comment » m’intéressent assez pour que je renonce sans regret à la vaine recherche des « pourquoi ». »
« Il n’y a pas d’ordre véritable sans la justice. »
« Si l’on ne fait pas le bien par goût naturel, que ce soit par désespoir ; ou du moins pour ne pas faire le mal. »
« La vie, on sait bien ce que c’est : un amalgame saugrenu de moments merveilleux et d’emmerdements. »
« Les soussignés […] somment les pouvoirs publics, au nom de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de condamner sans équivoque l’usage de la torture qui déshonore la cause qu’elle prétend servir. »2917
Protestation solennelle adressée au président de la République, avril 1958. Signée Roger Martin du Gard (1881-1958), André Malraux (1901-1976), François Mauriac (1885-1970), Jean-Paul Sartre (1905-1980), parue dans la presse et appelant les Français à se joindre à eux. Les Porteurs de valise : la résistance française à la guerre d’Algérie (1979), Hervé Hamon, Patrick Rotman
Un des derniers actes politiques de Roger Martin du Gard. L’année même de sa mort, il tient à cosigner cette pétition contre la torture dans la guerre d’Algérie qui ne dit pas encore son nom. L’occasion est donnée par le livre d’Henri Alleg, La Question, récit d’un torturé, saisi par la police le 25 mars. Tous les intellectuels engagés s’expriment sur cet insupportable et insoluble problème.
14. André Gide (1947)

« Le prix Nobel de littérature a été attribué à M. André Gide pour l’importance et la valeur artistique d’une œuvre dans laquelle il a exposé les problèmes de la vie humaine avec un intrépide amour de la vérité et une grande pénétration psychologique. »
« Familles je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur. »4
André GIDE (1869-1951), Les Nourritures terrestres (1897)
Cette œuvre de jeunesse est (déjà) un hymne panthéiste mêlant son amour de la vie et le rejet de son éducation puritaine. Il mêle tous les genres : notes de voyages, fragments de journal intime, rondes et ballades, dictionnaire poétique, dialogues de théâtre. Tout est bon à l’auteur pour dire l’ardeur avec laquelle il veut exister par tous les moyens. Il rend hommage à la Création toute entière et prône une vie nomade, sans attaches. Son style est à l’image de ses aspirations : libre, sauvage, poétique.
« Rien n’est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta chambre, que ton passé. »
« Que l’importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée ! »
« Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s’étonne de tout. »
« Ce que j’ai connu de plus beau sur la terre, Ah ! Nathanaël ! C’est ma faim. Elle a toujours été fidèle à tout ce qui toujours l’attendait. Est-ce de vin que se grise le rossignol ? L’aigle de lait ? ou non point de genièvre les grives ? L’aigle se grise de son vol. Le rossignol s’enivre des nuits d’été. La plaine tremble de chaleur. Nathanaël, que toute émotion sache te devenir une ivresse. Si ce que tu manges ne te grise pas, c’est que tu n’avais pas assez faim. »
« Ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelque autre. »
« Mon bonheur est d’augmenter celui des autres. J’ai besoin du bonheur de tous pour être heureux. »
« Ne souhaite pas trouver Dieu ailleurs que partout. »
« Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur ! »
Nathanaël est un personnage fictif au prénom biblique, en lien avec une des influences des Nourritures. Ménalque, l’autre personnage, est un sage dangereux, à la fois initiateur et tentateur qui n’apparaît jamais directement. Jusqu’à la conclusion lyrique.
« Nathanaël, à présent jette mon livre… »
André GIDE (1869-1951), Les Nourritures terrestres, Hymne final (1897)
« … Émancipe-t’en. Quitte-moi. Quitte-moi ; maintenant tu m’importunes ; tu me retiens ; l’amour que je me suis surfait pour toi m’occupe trop. Je suis las de feindre d’éduquer quelqu’un d’autre. Quand ai-je dit que je te voulais pareil à moi ? — C’est parce que tu diffères de moi que je t’aime ; je n’aime en toi que ce qui diffère de moi. Éduquer ! — Qui donc éduquerais-je, que moi-même ? Nathanaël, te le dirai-je ? je me suis interminablement éduqué. Je continue. Je ne m’estime jamais que dans ce que je pourrais faire. Nathanaël, jette mon livre. »
« Pour ma part, mon choix est fait, j’ai opté pour l’athéisme social. »
André GIDE (1869-1951), Les Caves du Vatican (1914), épigraphe
Gide a choisi comme profession de foi une citation de Georges Palante, philosophe et sociologue français, nietzschéen et libertaire.
Dans ce roman burlesque publié à la veille de la guerre, Gide expose sa fameuse théorie de l’acte gratuit.
L’intrigue plus que bizarre tourne autour de la libération du pape, soi-disant séquestré dans les caves du Vatican. Son héros Lafcadio, en soif d’aventure, va commettre un « crime sans motif » : il pousse du train Amédée Fleurissoire venu à Rome pour libérer le pape. Nulle raison à ce geste assassin. C’est l’absence de causalité qui est la cause même du crime : « Rien ne se passe jamais tout à fait comme on aurait cru… C’est là ce qui me porte à agir… Je me sentais d’étreinte assez large pour embrasser l’entière humanité ; ou l’étrangler peut-être… »
Restent nombre de pensées valant préceptes et de réflexions originales.
« La connaissance ne fortifie jamais que les forts. »
André GIDE (1869-1951), Les Caves du Vatican (1914)
La quête du moi est sans fin chez l’auteur inspiré qui maîtrise son art et fascine son public tout en jouant des mots à profusion et on osant (presque) tout dire.
« Ce n’est pas tant des événements que j’ai curiosité, que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d’agir, recule… Qu’il y a loin, entre l’imagination et le fait ! … Et pas plus le droit de reprendre son coup qu’aux échecs. Bah ! qui prévoirait tous les risques, le jeu perdrait tout intérêt ! »
« Voici ma thèse : Savez-vous ce qu’il faut pour faire de l’honnête homme un gredin ? Il suffit d’un dépaysement, d’un oubli ! Oui, Monsieur, un trou dans la mémoire, et la sincérité se fait jour ! »
« Parfois, au sein même de l’abjection, tout à coup, se découvrent d’étranges délicatesses sentimentales, comme croît une fleur azurée au milieu d’un tas de fumier. »
« Ma conversion ne regarde personne. C’est affaire entre Dieu et moi. »
« Que tout ce qui peut être soit ! »
« Tant de gens qui écrivent et si peu de gens qui lisent ! C’est un fait : on lit de moins en moins… si j’en juge par moi, comme disait l’autre. Ça finira par une catastrophe ; quelque belle catastrophe, tout imprégnée d’horreur ! on foutra l’imprimé par-dessus bord ; et ce sera miracle si le meilleur ne rejoint pas au fond le pire. »
« Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant. »
André GIDE (1869-1951), Les Faux Monnayeurs (1925)
Ce roman d’apprentissage dénonce les apparences mensongères. Au centre du récit, trois personnages : Bernard et Olivier, deux amis lycéens et l’oncle d’Olivier, Édouard, écrivain désireux de créer un roman unique et innovant – le rêve de tout auteur :
« Il songe à sa nouvelle règle de vie, dont il a trouvé depuis peu la formule : Si tu ne fais pas cela, qui le fera ? Si tu ne le fais pas aussitôt, quand sera-ce ? »
« Plutôt que de répéter sans cesse à l’enfant que le feu brûle, consentons à le laisser un peu se brûler : l’expérience instruit plus sûrement que le conseil. »
« Les bourgeois honnêtes ne comprennent pas qu’on puisse être honnête autrement qu’eux. »
« Les bons travailleurs ont toujours le sentiment qu’ils pourraient travailler davantage. »
« Si on pouvait recouvrer l’intransigeance de la jeunesse, ce dont on s’indignerait le plus c’est de ce qu’on est devenu. »
« Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. »
André GIDE (1869-1951), Si le grain ne meurt (1926 et 1936)
Le titre fait allusion aux versets de l’Évangile selon Jean. Et la « morale de l’histoire » pourrait être : « Toute chose appartient à qui sait en jouir. »
Premier récit autobiographique de Gide, depuis sa première enfance à Paris jusqu’à ses fiançailles avec sa cousine Madeleine en 1895, le texte fait l’objet de publications partielles hors commerce au début des années 1920.
En première partie, il raconte ses souvenirs : ses précepteurs, sa fréquentation épisodique de l’École alsacienne, sa famille, son amitié avec Pierre Louÿs (poète symboliste et parnassien), sa vénération soudaine pour sa cousine, ses premières tentatives d’écriture : « J’aime les compliments, mais ceux des maladroits m’exaspèrent. »
En seconde partie, il retrace sa découverte du désir et de sa pédérastie lors d’un voyage en Algérie avec un jeune garçon, Ali : « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées. »
Gide fera le récit de l’échec total de sa vie conjugale avec Madeleine dans un autre récit autobiographique, écrit en 1938 peu après la mort de sa femme, publié en 1951 et intitulé : Et nunc manet in te.
« Il est bien plus difficile qu’on ne croit de ne pas croire à Dieu. »
André GIDE (1869-1951), Les Nouvelles nourritures (1935)
Un récit en continuité et en rupture avec Les Nourritures terrestres. L’écriture navigue toujours entre fiction romanesque, poésie vagabonde et chronique, avec une dimension nouvelle d’ordre moral. L’auteur montre qu’il a suffisamment mûri et assimilé pour conseiller le lecteur. Au lieu d’exhortations au voyage et au plaisir, il donne des conseils réfléchis. Ponctué d’aphorismes, le récit devient dénonciateur des ascètes portés sur la pénitence, bien loin du goût de Gide pour les Évangiles.
Moins véhémente et sauvage dans le ton, la volonté de liberté est toujours présente et en quête du meilleur chemin pour éprouver la vie :
« La peur du ridicule obtient de nous les pires lâchetés. »
« Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. »
« Ce n’est pas seulement le monde qu’il s’agit de changer ; mais l’homme. »
Le fameux proverbe qui conclut le livre met en garde les lecteurs : « Ne sacrifiez pas aux idoles. » Il rappelle la maxime des premières Nourritures : « Nathanaël, à présent, jette mon livre ». La pensée de l’auteur a clairement évolué.
« Catholicisme ou communisme exige, ou du moins préconise, une soumission de l’esprit […] Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. »2835
André GIDE (1869-1951), Journal, 24 février 1946 (publié en 1950)
Les honneurs pleuvent sur le Gide d’après-guerre, prix Nobel de littérature en 1947 pour son « intrépide amour de la vérité » - et la formule est juste ! Il a rompu avec le communisme en 1937 et vécu la Seconde Guerre comme une apocalypse. Il ne songe plus qu’à sauver la culture de toute menace de totalitarisme et contrairement à Sartre, il ne croit pas que la littérature doive être politiquement engagée.
Son Journal en forme d’anthologie de 1889 à 1949 sera publié à la veille de sa mort. Des citations à profusion, des paradoxes brillants et une philosophie de la vie parfois désabusée, mais l’essentiel de son œuvre avait déjà vocation et valeur de « Journal », avec ou sans complaisance, talent toujours et parfois génie :
« Un bon maître a ce souci constant : enseigner à se passer de lui. »
« Il faut de l’esprit pour bien parler, de l’intelligence suffit pour bien écouter. »
« Une chose ne vaut que par l’importance qu’on lui donne. »
« Se passer de Dieu… n’y parvient pas qui veut. »
« Conquérir sa joie vaut mieux que de s’abandonner à sa tristesse. »
« Il faut déjà passablement d’intelligence pour souffrir de n’en avoir pas davantage. »
« Les adolescences trop chastes font les vieillesses dissolues. »
« Le nombre de choses qu’il n’y a pas lieu de dire augmente chaque jour. »
« Assurément les sentiments aussi vieillissent ; il est des modes jusque dans la façon de souffrir ou d’aimer. »
« La personnalité ne s’affirme jamais plus qu’en se renonçant. »
« Dieu, le dépotoir de tous les concepts mal définis. »
« Il est certaine façon d’adorer Dieu qui me fait l’effet d’un blasphème. Il est certaine façon de nier Dieu qui rejoint l’adoration. »
« Le catholicisme est inadmissible. Le protestantisme est intolérable. Et je me sens profondément chrétien. »
« Tout est bien. »
André GIDE (1869-1951), son mot de la fin
Repris officiellement en titre par Roger Stéphane pour sa chronique éditée en 1989 : « Tout est bien ». On peut commenter à l’infini.
Reste un faux en écriture post mortem, l’un des plus savoureux du microcosme littéraire…
« Enfer n’existe pas. Stop. Donne-toi du bon temps. Stop. Préviens Claudel. »7
André GIDE (1869-1951), télégramme reçu par Roger Nimier qui l’envoie à François Mauriac après la mort de son « auteur ». Dieu est humour, tome 2 (2011) Bernard Peyrous, Marie-Ange Pompignoli
Rappelons que Gide et Mauriac vécurent douloureusement le conflit entre la morale religieuse et leur penchant homosexuel (plus caché, côté Mauriac toujours inquiet de son propre salut). Quant à Claudel, lui aussi chrétien et torturé de nature (mais génial), c’est un autre Cas (majuscule).
En fait, ce télégramme mis en vente à l’hôtel Drouot et qui fit beaucoup parler… est un canular dû à Roger Nimier ou à Anne-Marie Cazalis (journaliste et poète, vedette des nuits parisiennes à Saint-Germain-des-Prés).
15. Albert Schweitzer (1952)

Prix Nobel de la Paix pour la création de l’hôpital de Lambaréné au Gabon.
« En 1896, aux vacances de la Pentecôte, par un rayonnant matin d’été, je m’éveillai à Gunsbach, et l’idée me saisit soudain que je ne devais pas accepter mon bonheur comme une chose toute naturelle et qu’il me fallait donner quelque chose en échange. »15
Albert SCHWEITZER (1875-1965), Ma vie et ma pensée (1960)
Cette « épiphanie » quasi mystique a frappé ses biographes. Se référant à la vie de Jésus (au cœur de ses études théologiques), le jeune pasteur conclut qu’il a le droit de vivre pour la science jusqu’à sa trentième année, avant de se consacrer à un « service purement humain ». Il sera tout simplement « un homme au service d’autres hommes », infatigablement dans l’action jusqu’à 90 ans ! Au final, la vie de ce personnage exceptionnel est un véritable roman.
Elle commence par une intimité artistique et spirituelle avec le musicien adoré des musiciens, Jean-Sébastien Bach.
« La richesse de son langage ne consiste pas dans l’abondance de thèmes différents, mais dans les différentes inflexions que prend le même thème suivant les occasions. Sans cette variété de nuances, on pourrait reprocher à son langage une certaine monotonie. C’est en effet la monotonie du langage des grands penseurs qui, pour rendre la même idée, ne trouvent toujours qu’une expression unique, parce qu’elle est la seule vraie. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), J. S. Bach Le Musicien-Poète (1905)
(Madame Colette à la vocation musicale avérée définissait Bach comme : « l’admirable machine à coudre »)
Musicien allemand (comme Schweitzer né en Alsace-Lorraine après la guerre de 1870), inspiré par une profonde foi chrétienne, compositeur de plus d’un millier d’œuvres, admiré de ses contemporains, oublié après sa mort en 1750, Bach fut redécouvert au XIXe siècle. Il fait l’objet d’un culte de la part des musiciens et musicologues - à commencer par Albert Schweitzer.
La musique fut sa première passion et à neuf ans, il maîtrise parfaitement le jeu des claviers et des pédales de l’orgue, lors des offices religieux. Cette vocation sera bientôt contrariée par ses autres activités, mais il s’affichera comme concertiste réputé de 1892 à 1955 : près de 500 récitals dans 11 pays. Il considérait ce don musical comme « une grande chance » qui lui permit de financer à plusieurs reprises son hôpital de Lambaréné.
« Quelquefois l’universalité de mon esprit me fait peur […] Je le porte comme un poids, mais ensuite je suis fier d’être plus universel que les autres et je me sens capable de rester à la hauteur pour tout. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), lettre de 1906 adressée à sa future femme Hélène, Correspondance entre Albert Schweitzer et Hélène Bresslau, 3 volumes (publication posthume)
Hélène Schweitzer-Bresslau (1879-1957), éducatrice et infirmière allemande (puis française après la Première Guerre mondiale) épousa Albert Schweitzer en 1912 et partagea son engagement humanitaire en Afrique. Elle fut toujours sa confidente et son soutien – ils sont tous deux enterrés à Lambaréné, ville du Gabon devenue mondialement célèbre pour son hôpital.
« Chaque matin, en descendant à l’hôpital, je me rends compte que je jouis d’un inestimable privilège en pouvant faire du bien à mon prochain et conserver des vies humaines. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), A l’orée de la forêt vierge (1923)
Lambaréné est surtout connue pour l’hôpital Albert-Schweitzer, créé en 1913 par le docteur qui y passera l’essentiel de son temps, ne retournant en Europe que pour assurer ses concerts d’organiste et assumer son « devoir médiatique » avec ses conférences, surtout après le Prix Nobel de la paix en 1952.
« Que chacun s’efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d’autres une véritable humanité. C’est de cela que dépend l’avenir du monde. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), À l’orée de la forêt vierge (1923)
C’est son premier récit en forme de journal où il s’exprime avec autant de foi que de passion : « Puissions-nous être bientôt plusieurs médecins envoyés aux quatre coins de l’horizon par la confrérie de ceux que la douleur a marqués de son sceau. » Ce vœu prémonitoire accompagne la fondation, en 1913, du « village-hôpital » de Lambaréné sur les bords du fleuve Ogooué au Gabon.
Pionnier de la médecine humanitaire et des ONG (Organisations non gouvernementales) au secours des pays en détresse, ce récit demeure un classique de l’aventure humaine qui fit rêver des générations entières d’écoliers en France et dans le monde.
Au-delà du contexte politique et culturel dans lequel est née l’œuvre d’Albert Schweitzer, l’extraordinaire force d’âme de ce jeune pasteur ayant abandonné une brillante carrière de théologien et de musicien pour aller soulager la souffrance humaine loin de son Alsace natale force notre admiration. L’élévation spirituelle de sa pensée, son inflexible volonté et sa philosophie centrée sur la nécessité de l’engagement éthique font de son témoignage un message toujours d’actualité – d’autant plus qu’aujourd’hui, nous savons…
« La misère physique est partout immense en Afrique. Avons-nous le droit de fermer les yeux devant elle et de l’ignorer, parce que les journaux d’Europe n’en parlent pas ? Nous sommes des privilégiés. Quand, chez nous, quelqu’un tombe malade, on appelle immédiatement le médecin. Est-il nécessaire d’opérer ? Les portes d’une clinique s’ouvrent aussitôt. Mais que l’on se représente ces millions d’êtres humains qui souffrent là-bas, sans espoir de secours. Chaque jour, des milliers et des milliers de pauvres créatures sont livrées à d’intolérables souffrances dont l’art médical pourrait les affranchir. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), À l’orée de la forêt vierge (1923)
Le couple Schweitzer fut amicalement accueilli par les missionnaires. Le tam-tam annonça l’arrivée du médecin et, malgré le délai de trois semaines demandé aux indigènes pour laisser le temps au « grand docteur » de s’installer, le succès fut si rapide que Schweitzer dut utiliser sa maison comme pharmacie et installer la salle d’opération dans un vieux poulailler.
Le docteur Schweitzer et sa femme infirmière trouvèrent un précieux auxiliaire en Joseph, un Africain ancien cuisinier de l’explorateur Savorgnan de Brazza. Il servait aussi de traducteur pour les différents idiomes parlés dans la région. Son langage de cuisinier donnait de surprenants résultats tel le célèbre : « Elle a mal dans le gigot droit ».
Poussé par l’urgence, Schweitzer fut à la fois médecin et bâtisseur, puis directeur, patron, chef du nouvel hôpital.
Dans ce même état d’improvisation forcée et avec les « moyens du bord » naît la formule originale du « village-hôpital » qui fera la renommée de son fondateur.
Trop à l’étroit, Schweitzer décide en 1925 de le déplacer à trois kilomètres en amont. Au bord du fleuve, le site est plus accessible. L’hôpital se développe. Au début des années 1950, il compte 45 bâtiments. Trois médecins, huit infirmières européennes et dix infirmiers locaux y travaillent. C’est la grande époque. Celle de l’essor de la légende.
« Le plus grand homme du monde. »
« The greatest man in the world. »Magazine Life, titre à la une rendant hommage au Docteur Schweitzer, 6 octobre 1947
Il a décliné plusieurs invitations, avant de se rendre pour la première et la dernière fois aux États-Unis. Le 8 juillet 1949 ; il prononce deux conférences sur Goethe (l’une en français, l’autre en allemand) à Aspen (Colorado). Le 11 juillet, on le retrouve à la une du magazine Time.
Les années d’après-guerre sont celles de la consécration avec le prix Nobel de la paix en 1952. La dotation liée au prix lui permet d’achever (en 1955) la construction du « village de lumière », destiné aux lépreux. Très occupé sur place, Schweitzer met deux ans pour venir chercher son prix et user de cette tribune médiatique. C’est peu dire s’il a pesé ses mots… Ce beau discours « généraliste » qui remonte aux origines du Nobel est d’une portée très actuelle et d’une confondante clarté. Chaque phrase a valeur de citation.
« Pour sujet de la conférence que l’attribution du prix Nobel de la Paix m’impose comme un honneur redoutable, j’ai choisi le problème de la paix, tel qu’il se pose aujourd’hui. Je crois agir ainsi dans l’intention du fondateur de ce prix, qui s’était préoccupé de ce problème, tel qu’il se posait à son époque, et qui attendait de sa fondation qu’elle entretienne la réflexion et la recherche sur les possibilités de servir la cause de la paix. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), Conférence Nobel à Oslo, l4 novembre 1954
« Osons faire face à la situation. L’homme est devenu un surhomme. Il est un surhomme parce qu’il ne dispose pas seulement des forces physiques innées, mais parce qu’il commande, grâce aux conquêtes de la science et de la technique, aux forces latentes dans la nature et qu’il peut les mettre à son service. Pour tuer à distance, l’homme réduit à lui-même ne disposait que de sa force physique, grâce à laquelle il tendait l’arc ; il la faisait agir sur la flèche par la brusque détente de l’arc. Le surhomme en est arrivé à utiliser, grâce à un engin inventé à cet effet, l’énergie dégagée par la déflagration d’un mélange déterminé de produits chimiques. Ceci lui permet d’employer un projectile beaucoup plus efficace et de l’envoyer à une distance beaucoup plus grande. »
Les horreurs de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde, ont nourri la réflexion d’Albert Schweitzer (né Allemand) et sa correspondance avec ses amis Albert Einstein et Robert Oppenheimer reflétait son inquiétude croissante devant la montée du péril nucléaire, mais il préférait se tenir à l’écart des débats et s’en tenir à ses devoirs de médecin. L’attribution du Nobel de la Paix lui impose cette nouvelle attitude militante.
« Le surhomme souffre d’une imperfection funeste de son esprit. Il ne s’est pas élevé au niveau de la raison surhumaine qui devrait correspondre à la possession d’une force surhumaine. Il en aurait besoin pour mettre en œuvre cette énorme puissance uniquement à des fins raisonnables et utiles, et non destructrices et meurtrières. Pour cette raison, les conquêtes de la science et de la technique devinrent funestes plutôt que profitables pour lui. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), Conférence Nobel à Oslo, l4 novembre 1954
« A cet égard ne faut-il pas considérer comme un fait significatif que la première grande découverte, celle d’utiliser la force résultant de la déflagration de la poudre, s’est d’abord offerte uniquement comme un moyen de tuer à distance ? »
« Nous devenions inhumains à mesure que nous devenions des surhommes. Nous avons toléré qu’au cours des guerres les hommes aient été tués en masses - environ vingt millions dans la seconde guerre mondiale - que des villes entières avec leurs habitants aient été réduites à néant par la bombe atomique, que des hommes aient été transformés en torches vivantes par les bombes incendiaires. Nous prenions connaissance de ces faits par la radio ou par les journaux, et nous les jugions selon qu’ils signifiaient un succès pour le groupe de peuples auquel nous appartenions, ou pour nos adversaires. Quand nous nous avouâmes que ces faits étaient les résultats d’une action inhumaine, cet aveu s’accompagnait de la réflexion que le fait de guerre nous condamnait à les accepter. En nous résignant sans résistance à notre sort, nous nous rendons coupables d’inhumanité.
Ce qui importe, c’est reconnaître, tous ensemble, que nous sommes coupables d’inhumanité. L’horreur de cette expérience doit nous arracher à notre torpeur, pour que nous tendions nos volontés et nos espoirs vers l’avènement d’une ère dans laquelle la guerre ne sera plus. »
Certains militants pacifistes sont déçus – que pouvait-il dire de plus ? Les États-Unis et la France (de Gaulle) qui optent pour la bombe prendront ses distances – devait-il dire moins ? Mais l’enthousiasme populaire est considérable. Un journal norvégien recommande à ceux qui voudraient serrer la main du lauréat de donner plutôt une couronne pour l’hôpital de Lambaréné : message bien reçu. Pas par tout le monde. Citons une exception, parmi les intellectuels français toujours prompts à la critique.
« C’est le plus grand filou qui soit. Il a bâti Lambaréné grâce au pognon de la mère Éléonor Roosevelt. Il lui a fait le coup du saint ermite qui joue de l’orgue sous les palmiers. »
Jean-Paul SARTRE (1905-1980). Cité par Jean Cau, Croquis de mémoire (1985)
Dans les années 1950 il dresse le portrait au vitriol du « bon docteur »… qui est d’ailleurs son cousin - la mère de Sartre est née Schweitzer. Et « l’oncle Albert » promenait le nourrisson Jean-Paul dans sa voiture au Bois de Boulogne.
Albert Schweitzer n’était pas un saint ni même un prophète. Il a eu ses détracteurs – avant et après son Nobel. Il aurait pu faire plus ou mieux ou autrement, il en a eu lui-même conscience, mais il a fait, il a agi et payé de sa personne, financé son action par les concerts et les conférences qu’il donnait régulièrement en Europe et sauvé des millions de vie. Il fut l’ami de Romain Rolland, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Théodore Monod, l’Abbé Pierre, Gilbert Cesbron – « Il est minuit, docteur Schweitzer ! »
Certains commentaires ne déshonorent que leur auteur, si grand intellectuel et maître à penser que soit Jean-Paul Sartre, célèbre aussi pour son refus du prix Nobel.
Reste que le mythe (excessif ?) du bon docteur Schweitzer a engendré un contre mythe dont il faut parler.
« La mémoire du colonialisme est encore vive en Occident : c’est l’image d’un certain Schweitzer distribuant des médicaments aux gens dépourvus de soins médicaux. »
Jonathan SADOWSKI, « The Long Shadow of Colonialism : Why We Study Medicine in Africa » (2010)
Historien contemporain de la médecine, il s’interroge sur l’identification de la mémoire de Schweitzer avec celle du colonialisme et la relégation de son travail médical à une simple distribution des pilules, sans réel exercice de la profession médicale. En vertu de quoi le docteur Schweitzer demeure un sujet de controverse opposant l’idéal du bon chrétien occidental et l’idée du méchant colonialiste paré du manteau de philanthrope.
De fait, son action fut controversée. Il était réellement médecin, ayant tous les diplômes et la pratique – réalité indiscutable. Mais il refusa de moderniser son village-hôpital où les malades amènent leur famille quand ils viennent se faire soigner. Ses adversaires lui reprochent cette vision traditionnelle et passéiste de l’Africain. Ses partisans rétorquent qu’en maintenant un lieu semblable aux villages de la brousse, il permet à des gens qui ne supporteraient pas l’univers propre à l’hôpital d’être quand même pris en charge et soignés.
Avec l’indépendance et les promesses de développement, les Africains peuvent vouloir des hôpitaux modernes et par comparaison, ils pourront juger « primitifs », comme étant un reliquat du colonialisme, les installations et le mode de fonctionnement de l’Hôpital Schweitzer. Mais… l’esprit du temps change vite. Certaines illusions se trouvant dissipées, l’extension d’une certaine modernisation, sur le modèle occidental, est mise en cause et l’on reconnaît mieux l’originalité « africaine » de l’œuvre de Schweitzer à Lambaréné, son adaptation à la situation, aux besoins et aux coutumes de ce pays, « entre eaux et forêt vierge ».
On l’a aussi accusé d’autoritarisme, de paternalisme et de colonialisme, voire de brutalité, on a critiqué la manière dont il avait conçu et dirigé son hôpital. Il ignorait ces critiques, soutenu par une équipe soignante compétente et dévouée. Quant aux malades de Lambaréné, ils apprécient l’humanité de ce « Blanc bizarre » qui met en pratique le mot d’ordre : « Vous serez tous frères… » Et reste avec eux jusqu’à sa mort, choisissant d’être (modestement) enterré à Lambaréné, au côté de sa femme Hélène.
Le nouvel hôpital, inauguré en 1981, bien plus étendu qu’à l’origine et répondant aux normes, intègre des départements de médecine interne, chirurgie, pédiatrie, une maternité, une clinique dentaire et une unité de recherche médicale sur la malaria. Autrement dit, l’hôpital vit toujours et c’est la plus belle reconnaissance post mortem du Docteur Schweitzer.
« Lorsqu’on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds qu’en moi la connaissance est pessimiste, mais le vouloir et l’espoir sont optimistes. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), Ma vie et ma pensée (1960)
Il livre à ses lecteurs une autobiographie et un « testament spirituel », au soir de sa vie. Il évoque son enfance, les années où il était étudiant et pasteur à Strasbourg, son travail de musicien et le philosophe qu’il restera, avec une attention extrême à ce qui reste malgré tout essentiel dans la vie : « Occupés par leur désir d’atteindre la lune, les hommes ont échoué à voir les fleurs qui s’épanouissent à leurs pieds. »
Il fonde son éthique sur le respect de la vie. Il plaide pour une religion mystique, débarrassée de spéculations dogmatiques. Il déplore le manque de spiritualité du monde moderne qui se dégrade et devient inhumain. Il appelle au respect de la vie, traduction en langage moderne de ce qui se trouve au cœur du message de Jésus.
« Je suis Allemand, je n’ai jamais cessé de l’être par mon identité la plus profonde et ma façon d’être au monde. Toutefois, j’aime la France, j’ai pour elle le respect que lui doit tout homme épris de progrès et de paix »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), interview de Claude Bourdet, France-Observateur, 16 mars 1961
Ses origines alsaciennes le placent d’emblée à la croisée de deux cultures dont il se réclame. Il est conscient de ce « beau privilège » et de cet « héritage fatal » - qui lui vaut d’être prisonnier au Gabon, colonie française lors de la Première Guerre mondiale. Ruiné en 1918, très malade et près de devoir renoncer à son rêve africain, il repartira en 1924.
Guidé par une vision universaliste des cultures, il choisit finalement de n’en renier aucune : double loyauté qui ne fut pas toujours comprise. La plupart de ses ouvrages ayant été écrits en allemand et traduits tardivement, c’est au début des années 1950 que « la France découvre qu’il est citoyen français ». Mais il est plus que tout citoyen du monde.
« Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre. Chaque jour et à chaque heure cette conviction m’accompagne. Le bien, c’est de maintenir et de favoriser la vie ; le mal, c’est de détruire la vie et de l’entraver. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), La Civilisation et l’éthique, (posthume, 1976)
Précurseur de l’écologie (voire de l’antispécisme), penseur visionnaire salué par son ami Théodore Monod, respectueux de toutes les vies, accueillant les chats dans son hôpital de Lambaréné, hésitant à tuer les moustiques et s’enchantant du spectacle de la nature sous toutes ses formes.
« Celui qui, devant un tableau représentant un paysage de bruyère, n’entend pas la vague musique du bourdonnement des abeilles, ne sait pas voir ; de même que celui pour lequel la musique n’évoque aucune vision, ne sait pas entendre. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), Respect et responsabilité pour la vie (recueil de textes, posthume, 2019)
Il fut le premier à utiliser la formule du « respect de la vie » pour fonder une éthique qu’il voulait élémentaire et universelle : « Le respect de notre propre vie et de celle des autres sont deux choses absolument inséparables, telle est la prise de conscience qui devrait s’imposer de façon claire et immédiate à chacun d’entre nous. »
Théodore Monod présentait son ami Schweitzer, « tour à tour musicien, théologien, penseur et médecin… l’un de ces hommes qui aujourd’hui empêchent quand même de désespérer tout à fait de l’humanité. »
« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. »
Albert SCHWEITZER (1875-1965), Respect et responsabilité pour la vie (recueil de textes, posthume, 2019)
Cette phrase toute simple pourrait être la clé du bonheur.
Pour finir, voici un florilège de citations à méditer ou à partager :
« Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats. »
« L’enfant qui sait se pencher sur l’animal souffrant saura un jour tendre la main à son frère. »
« L’idéal est pour nous ce qu’est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais il demeure un guide. »
« La tragédie de la vie est ce qui meurt à l’intérieur d’un homme pendant qu’il vit. »
« L’humanité consiste dans le fait qu’aucun homme n’est sacrifié à un objectif. »
« La vérité n’a pas d’heure, elle est de tous les temps, précisément lorsqu’elle nous paraît inopportune. »
« Les gouvernements s’entendent lorsque les peuples les obligent à s’entendre. »
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.