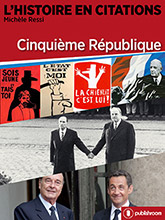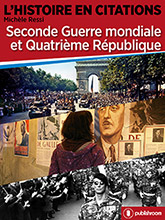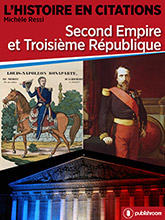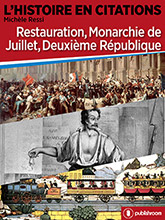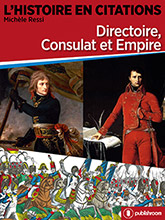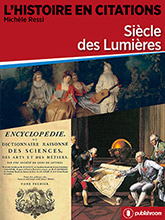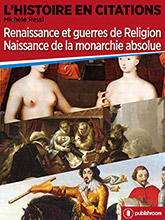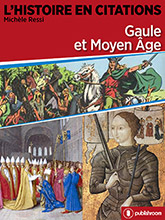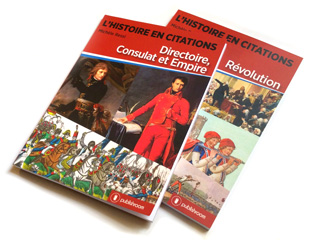« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »
Albert CAMUS (1913-1960), Sur une philosophie de l’expression, revue Poésie 44
Et en d’autres mots : « Sans savoir ou sans dire encore comment cela est possible, la grande tâche de l’homme est de ne pas servir le mensonge. »
L’Histoire nous donne des repères – encore faut-il qu’ils soient clairs… et historiquement exacts.
À l’époque de toutes les confusions, approximations, exagérations et autres fake-news, voici donc 55 repères historiques : points fondamentaux ou détails anecdotiques, amusants ou tragiques… à méditer et partager à l’occasion.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
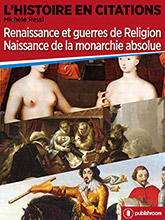 RENAISSANCE
RENAISSANCE
22. Christophe Colomb n’a pas « découvert l’Amérique » en 1492 – et il cherchait l’Inde.
« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où on va. »13
Christophe COLOMB (1451-1506), 1492 – Journal. Le nouveau monde et ccitavérifiées.fr
Phrase prémonitoire, vu la suite de l’aventure. Et presque trop belle pour être vraie, quoique souvent citée. On la trouve dans Le Dictionnaire amoureux de l’entreprise et des entrepreneurs (2021) du journaliste Christophe Barbier. Mais une petite enquête sémantique l’attribuerait en réalité à Cromwell, en passant par le témoignage du cardinal de Retz… avant de remonter jusqu’à Rivarol et Robespierre.
Quoiqu’il en soit, Colomb parti pour découvrir l’Inde en naviguant vers l’ouest… tombe sur l’Amérique… déjà découverte par les Vikings et qu’il prend pour l’Inde.
« Bien entendu, l’Amérique avait été découverte avant Colomb, mais le secret en avait été bien gardé. »
Oscar WILDE ( 1854-1900)
Parole de dandy, poète irlandais, homosexuel et provocateur qui ne respecte rien sous l’ère victorienne. Fasciné par sa propre image, célèbre pour son Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde meurt dans la misère à Paris. Il sera très vite reconnu comme un génie, même s’il appliquait ce mot à sa vie, pour ne donner à ses œuvres que son talent.
Prémonition ou provocation, il s’exprime plus d’un demi-siècle avant la découverte scientifique d’un couple d’archéologues norvégiens qui confirme.
Après avoir cartographié une partie des colonies vikings, les Ingstad (Anne Stine et son mari) trouvent en 1960 les restes d’une colonie à L’Anse aux Meadows sur l’île de Terre-Neuve (province canadienne). Ils sont ainsi les premiers à prouver que des Vikings venus du Groenland ont traversé l’océan Atlantique pour atteindre l’Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb.
« Les vikings avaient découvert l’Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. La science est désormais unanime à ce sujet : l’actuel Canada fut exploré pour la première fois en 1021 par des vikings. L’île de Terre-Neuve rassemble les premières traces de présence européenne sur le continent américain. »
Margot HINRY, National Geographic. Histoire, 30 septembre 2022
Selon l’étude parue en 2021 dans la revue scientifique Nature, « les vikings étaient présents à Terre-Neuve en 1021. On savait déjà – grâce aux vestiges archéologiques – que les vikings étaient arrivés aux Amériques. Mais on ne savait pas vraiment quand. Pour obtenir des datations précises, une équipe de chercheurs néerlandais s’est appuyée sur d’anciens prélèvements réalisés des années plus tôt. Des dizaines de datations au carbone 14 réalisées sur des artefacts en bois mis au jour à L’Anse aux Meadows dans les années 1960 avaient révélé que le site avait environ 1 000 ans.
Malgré tout, le mythe demeure : « Christophe Colomb a découvert l’Amérique » : contre-vérité tellement ancrée dans la culture collective que la date de 1492 sert de charnière historique entre le Moyen Âge et l’Époque Moderne.
« La mer apportera à chaque homme des raisons d’espérer, comme le sommeil apporte son cortège de rêves. »
Christophe COLOMB (1451-1506), La découverte de l’Amérique : I. Journal de bord 1492-1493
Navigateur et commerçant en Méditerranée au service de négociants génois, Christophe Colomb poursuit sa carrière au Portugal à partir de 1476. Alors que les navigateurs portugais longent les côtés d’Afrique pour atteindre les Indes (l’Asie de l’est) par l’océan Indien, il projette au contraire d’atteindre les Indes en naviguant vers l’ouest à travers l’océan Atlantique (la « mer Océane »).
Parti en août 1492 de Palos de la Frontera (Andalousie) avec trois navires - la Santa María, la Pinta, la Niña - il atteint en octobre des îles qu’il croit proches de son but, nommant leurs habitants « Indiens » (Indios), alors qu’il se trouve sur l’archipel américain des Caraïbes. De retour en mars 1493, c’est la gloire : nommé « amiral de la mer Océane, gouverneur et vice-roi des Indes », il devient l’égal des grands d’Espagne.
Dès son deuxième voyage en septembre 1493, il s’engage dans la colonisation d’Hispaniola dont il est gouverneur. Mais cette colonisation se passe mal…
À sa mort, Colomb est persuadé d’avoir atteint les Indes. Un autre navigateur, Amerigo Vespucci, popularisera le concept d’un « Nouveau Monde » (1503) nommé en son honneur « America » par des cartographes allemands en 1507.
Reste le bilan d’explorateur de Colomb : il a découvert un grand nombre des îles des Caraïbes et nommé plusieurs d’entre elles : la Guadeloupe, Marie-Galante, la Trinité, la Dominique, etc. Le nom de Colomb sera ensuite attribué à plusieurs territoires d’Amérique : la Colombie, la Grande Colombie, la Colombie-Britannique.
23. La Palice encore en vie en 1525, mais chansonné plus tard à contre sens.
« Hélas, La Palice est mort
Il est mort devant Pavie
Hélas ! s’il n’était pas mort
Il serait encore en vie. »454La Mort de La Palice, chanson de 1525. Revue de la Renaissance, volume IV (1903), Léon Séché
Cette chanson populaire a une longue histoire.
À l’origine, elle célèbre la vaillance de Jacques II de Chabannes, seigneur de La Palice, chambellan du roi, maréchal de France, héros de toutes les grandes batailles des guerres d’Italie depuis Fornoue avec Charles VIII. Parcours comparable à celui de Bayard, mort un an plus tôt, couvrant la retraite de l’armée française, honoré et pleuré même par ses ennemis.
Bravoure égale de La Palice, chantée par les Français : « Un quart d’heure avant sa mort / Il faisait encore envie », ou bien, autre version : « Un quart d’heure avant sa mort / Il était encore en vie », c’est-à-dire plein de courage, jusqu’à sa dernière heure.
Ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’on déforme le sens de ces vers, pour n’en retenir que la naïveté et en faire une « lapalissade », injustement associée au nom du seigneur de La Palice.
24. Les mignons d’Henri III… n’étaient pas du tout ce que l’on croit.
« Ce sont eux [les mignons] qui à la guerre ont été les premiers aux assauts, aux batailles et aux escarmouches, et s’il y avait deux coups à recevoir ou à donner, ils en voulaient avoir un pour eux, et mettaient la poussière ou la fange à ces vieux capitaines qui causaient [raillaient] tant. »559
BRANTÔME (1540-1614). Lexique des œuvres de Brantôme (1880), Ludovic Lalanne
Homme de cour autant que de guerre, il défend ici, en témoin, la réputation des mignons du roi, comme le fera l’autre chroniqueur bien connu, Pierre de l’Estoile, dans ses Mémoires relatifs à l’histoire de France, Journal de Henri III (posthume). Le roi couvrait ses favoris de biens et d’honneurs, les appelant « mes enfants » et pleurant d’abondance leur trépas. Ils furent en retour très fidèles au roi et vaillants au combat.
Michelet confirme, dans son Histoire de France : « Puisque ce mot de mignon est arrivé sous ma plume, je dois dire pourtant que je ne crois ni certain ni vraisemblable le sens que tous les partis, acharnés contre Henri III, s’acharnèrent à lui donner […] Plusieurs des prétendus mignons furent les premières épées de France. »
Un poème de Ronsard brocarde pourtant le roi et ses mignons.
« Le roi comme l’on dit, accole, baise et lèche
De ses poupins mignons le teint frais, nuit et jour ;
Eux pour avoir argent, lui prêtent tour à tour
Leurs fessiers rebondis et endurent la brèche. »Pierre de RONSARD (1524-1585), Historia.fr
Le roi des poètes – et poète des rois - se fait volontiers libertin et même érotique à ses heures.
Cependant que la propagande des Ligueurs ultra-catholiques s’acharne à discréditer le roi « sodomite » avec ses « mignons de couchette ».
Henri III finira assassiné par un moine ligueur, Jacques Clément, son successeur étant également victime d’un catholique fanatique - Henri IV ayant une solide réputation de Vert-Galant avec les femmes.
Reste le contexte, la mode italienne (à l’image de la reine mère, Catherine de Médicis) et les mœurs du temps qui peuvent prêter à confusion, si l’on se fie aux apparences restituées par les tableaux. Costumes raffinés à l’extrême, bijoux portés par des hommes prompts à sortir leurs pendentifs endiamantés aussi bien que leurs dagues, travestissement mettant en valeur une minceur efféminée. La complexité du personnage d’Henri III prête également à confusion.
Finalement, qu’importe sa liberté de mœurs et sa sexualité réelle ou supposée ! Seule certitude, ses Mignons surent se battre et mourir comme les plus vaillants guerriers du temps.
 XVIIè et SIÈCLE DE LOUIS XIV
XVIIè et SIÈCLE DE LOUIS XIV
25. « Est-il heureux ? » Un mot bien connu de Mazarin, mais mal entendu.
« Est-il heureux ? »756
MAZARIN (1602-1661). Mémoires de madame la duchesse d’Orléans, princesse Palatine (1832), Busoni
Mot du ministre, rapporté en ces termes par la Palatine, mère du régent : « Le cardinal Mazarin ne pouvait souffrir autour de lui des gens malheureux. Quand on lui proposait quelqu’un pour entrer à son service, sa première question était celle-ci : « Est-il heureux ? » »
Cela signifie en réalité : « La chance est-elle avec lui ? »
Mazarin saura s’entourer des meilleurs collaborateurs au gouvernement, à tel point que Louis XIV, prenant le pouvoir à sa mort, les garde à son service – notamment Colbert, Le Tellier, Lionne. Seul le surintendant des Finances Fouquet, devenu richissime, est éliminé et condamné pour avoir été « trop heureux » dans ses affaires personnelles.
26. Galilée n’a pas été condamné à mort pour avoir soutenu que la Terre était ronde.
« Et pourtant elle tourne ! » « Eppur si muove ! »
GALILÉE (1564-1642), citation apocryphe
Acculé par les inquisiteurs le 22 juin 1633, Galilée aurait, selon la légende, prononcé cette phrase pour lui-même après avoir été forcé d’abjurer sa théorie mettant le soleil au cœur de notre Système solaire : héliocentrisme opposé au géocentrisme, représentation du monde où la Terre se trouve immobile, au centre de l’Univers. Cette révolution majeure avait été formulée par Copernic en 1543 : Des révolutions des sphères célestes.
Galilée, convaincu par l’héliocentrisme, ne s’engage dans le débat qu’en 1609-1610, époque où il devient le mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane. La lunette astronomique vient de naître et il peut répondre à certaines objections faites à l’héliocentrisme. C’est le sujet de Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, publié en 1632. Suivi du procès l’année suivante.
Vingt ans avant, Galilée avait rédigé ce qui allait devenir une des plus lourdes pièces dans sa condamnation : une lettre de sept pages à son ami mathématicien Benedetto Castelli, où il détaille sa théorie et malmène la Bible et les Saintes Écritures. Il ajoute que les références de la Bible à des faits astronomiques ne doivent pas être prises à la lettre et que les autorités religieuses n’ont pas les compétences pour juger ces choses.
Si cette abjuration lui a sauvé la vie, elle n’aura pas suffi à lui éviter le châtiment : l’astronome italien est condamné pour hérésie, condamnation commuée par le pape Urbain VIII (qui fut son mécène) en une peine d’exil et de de résidence surveillée jusqu’à sa mort. Avec interdiction d’aborder à nouveau le sujet ! Pour l’époque, cette condamnation peut être considérée comme modérée – la mort eut été plus logique…
« Le problème de Galilée c’est qu’il exposait sa théorie sans preuve réelle… Même s’il avait raison, il était impossible au XVIe siècle de prouver que la Terre tournait bien autour du Soleil. »
Yael NAZE (née en 1976), astrophysicienne belge travaillant à l’Université de Liège. Citée dans Le Figaro, 26/09/2018
Spécialiste des étoiles massives et de leurs interactions avec leur environnement, elle explique : « Le système héliocentrique était en fait plus logique. Il rendait l’ensemble des calculs astronomiques plus simples. »
Galilée ne disposant pas des outils permettant de prouver sa théorie, il n’hésitait pas à tordre les faits ou à en inventer pour convaincre ses interlocuteurs. « Galilée était un génie qui avait compris que le système aristotélicien ne fonctionnait pas. Mais c’était aussi un être humain qui avait ses défauts et n’hésitait pas à mentir lorsqu’il se sentait acculé. »
27. « Ultima ratio regum », devise gravée sur les canons de Louis XIV : encore un contresens.
« Ultima ratio regum. » « Dernier argument des rois. »817
LOUIS XIV (1638-1715), devise gravée sur ses canons
Concise et précise, la devise est une bonne citation historique. Celle-ci donne une clé de la politique extérieure du règne et du personnage. La guerre est l’une des passions du roi, comme l’amour, la chasse, les bâtiments, la danse, les spectacles… et par-dessus tout le métier de roi.
La victoire est ce qui peut le mieux servir sa gloire. D’où trente-trois années de guerre sur un règne personnel de cinquante-quatre ans. Ses contemporains sont du même avis : un roi guerrier fait son métier de roi.
Louis XIV va poursuivre trois buts qu’on nommerait aujourd’hui géopolitiques : prééminence de la France dans le monde, frontière stratégique assurée au nord-est, visées sur la prochaine succession d’Espagne.
Il se donnera les moyens de sa politique : grands diplomates (Lionne, Pomponne, de Torcy, le neveu de Colbert), réorganisation militaire conduite par Louvois, effectifs considérables pour une armée de métier (passant de 72 000 hommes en 1667 à 400 000 en 1703), marine de guerre développée par Colbert (La Royale a 18 vaisseaux en 1661, 276 en 1683), places fortes créées ou renforcées par Vauban.
L’opposition se manifestera pourtant à la fin du règne : le peuple est épuisé, ruiné, lassé d’une gloire dont il voit les faiblesses, cependant que la guerre de Succession d’Espagne tourne au drame avec des troupes moins combatives, sous des chefs militaires médiocres. Le roi se pose alors en père de son peuple, en appelant pour la première fois et directement à ses sujets, persuadé qu’ils s’opposeraient eux-mêmes à recevoir la paix assortie de conditions contraires à la justice et à l’honneur du nom français. Cet appel émouvant et solennel est lu dans toutes les églises du royaume, le 12 juin 1709. L’adhésion populaire est évidente. Et la guerre continue. La situation va peu à peu se redresser. Villars, maréchal de France à la tête de l’armée de Flandre, redonne confiance aux troupes.
« S’il faut faire la guerre, j’aime mieux la faire à mes ennemis qu’à mes enfants. »937
LOUIS XIV (1638-1715), Manifeste au peuple, juillet 1710. Histoire de France depuis l’avènement de Charles VIII (1896), Frédéric Mane.
Les alliés, Hollande en tête, exigent cette fois que Philippe V renonce au trône d’Espagne et, en cas de refus, que Louis XIV le fasse détrôner par ses armées. Le roi de France rend public l’outrage.
Un sursaut national permet un redressement franco-espagnol. Encore quelques années d’une succession de défaites et de victoires (signées Villars). Tous les pays sont épuisés, le pacifisme gagne du terrain en Angleterre, et l’issue de cette guerre ne peut être que diplomatique.
28. « Tu trembles Carcasse… » Mot de Turenne à double sens.
« Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener ! »868
TURENNE (1611-1675) se parlant à lui-même, en 1667. Nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral (1834), Pierre Maine de Biran
Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, s’apprête à reprendre du service, vingt ans après sa brillante guerre de Trente Ans.
La guerre de Dévolution, dite aussi de Flandre ou des Droits de la Reine, première guerre de conquête de Louis XIV, se prépare depuis le début du règne par un jeu d’alliances.
À la mort de Philippe IV d’Espagne (1665), Louis XIV, invoquant le traité des Pyrénées (1659), entend faire valoir les droits de sa femme sur les Pays-Bas (espagnols) : fille du roi d’Espagne, elle y a renoncé en épousant le roi de France, mais en échange d’une dot considérable, toujours impayée…
Les victoires se succèdent, Louvois et Vauban ont bien préparé l’armée. En trois mois, cette année 1667, Turenne enlève la Flandre (dont Lille) à l’Espagne.
Autre version du mot de Turenne : il parlerait à son cheval Carcasse, avant sa dernière bataille en 1675. De toute manière, c’est le mot d’un très courageux soldat de Louis XIII et Louis XIV, promu maréchal de France à 32 ans et qui se battra donc jusqu’à cette dernière bataille.
« Il est mort aujourd’hui un homme qui faisait honneur à l’homme. »883
Prince MONTECUCOLLI (1609-1680), rendant hommage à son ennemi Turenne, Salzbach (ou Sasbach), 27 juillet 1675. L’Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 (1875), François Guizot
Après Turckheim, la foule avait accueilli Turenne à Paris comme le libérateur du royaume. Comblé d’honneurs et toujours modeste, il souhaite se retirer à l’Oratoire, mais Louis XIV lui donne le commandement de la nouvelle campagne de 1675. Et à 64 ans, le maréchal de France retrouve son vieil adversaire Montecucolli : généralissime des troupes de l’empereur germanique, âgé de 66 ans et toujours combattant.
Deux mois durant, ils déploient leurs armées en grands tacticiens. Turenne semble avoir l’avantage et va passer à l’offensive, quand il est mortellement blessé par un boulet de canon, au cours d’une opération de reconnaissance. Il sera enseveli à la basilique de Saint-Denis – et transféré en 1800 aux Invalides, par Bonaparte admiratif.
29. Molière, cible de toutes les rumeurs imaginables : de son vivant, mourant… et jusqu’à nos jours.
« Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leurs maladies. »879
MOLIÈRE (1622-1673), Le Malade imaginaire (1673)
Malade d’une tuberculose que les médecins du temps sont impuissants à guérir, affecté par la mort de son fils et de sa vieille amie Madeleine Béjart, épuisé de travail à la tête de sa troupe et supplanté par l’intrigant Lully auprès de Louis XIV, Molière, 51 ans, est pris d’une défaillance sur la scène de son théâtre du Palais-Royal, où il joue pour la quatrième fois le rôle du Malade. Il meurt chez lui, quelques heures plus tard, crachant le sang. Armande, sa femme (Mlle Molière), fait intervenir personnellement Louis XIV pour obtenir de l’archevêque de Paris des funérailles (nocturnes) et une sépulture chrétienne, le 21 février 1673.
« Tout le monde sait les difficultés que l’on eut à faire enterrer Molière comme un chrétien catholique. »
Jean-Léonor LE GALLOIS, sieur de GRIMAREST (1659-1713, auteur de la première biographie de Molière (1705)
Il s’inspire des souvenirs de Michel Baron, élève, puis camarade de scène et grand ami de Molière, témoin de sa mort et de tout ce qui s’ensuivit. Ceci pour démentir la légende : Molière mort en scène et son cadavre jeté à la fosse commune.
Il n’est pas non plus mort dans la misère. Son train de vie et sa fortune personnelle en attestent, quoiqu’en rien comparables à ceux de Lully.
Star de son temps, naturellement jalousé des confrères, Molière fut l’objet de toutes les rumeurs. On l’accuse de plagier les auteurs italiens et espagnols - mais en l’absence de droit d’auteur, on s’inspirait librement de tel ou tel. La Fontaine réécrit en mieux les fables d’Ésope et le Don Juan de Tirso de Molina, repris par la commedia dell arte, va devenir un mythe sans fin repris.
D’autres accusations portent sur sa vie privée. Cocu et dangereux libertin… mais les coulisses théâtrales n’ont jamais été des couvents modèles.
Plus grave, le crime d’inceste, suite au mariage avec sa propre fille Armande, fruit de sa liaison avec Madeleine Béjart, comédienne de sa troupe depuis les origines. Accusation publiquement portée par Montfleury, vedette de l’Hôtel de Bourgogne, troupe rivale. Molière, créateur du naturel en scène, s’est moqué de son jeu emphatique (parodié dans l’Impromptu de Versailles). En fait, la naissance de la future Mlle Molière reste un mystère d’état-civil et le dossier à charge est vide.
« Corneille est-il l’auteur d’Amphitryon ? »
Pierre LOUŸS (1870-1925 ), « Molière auteur des œuvres de Molière. L’apparition de la théorie Corneille. » huma-num.fr
Parmi les autres fake-news colportées sur l’auteur français le plus joué au monde… voici la plus étonnante. Il n’aurait pas écrit ses pièces !!! À l’appui de cette thèse, on n’a retrouvé aucun manuscrit de Molière (ni même aucune trace de son écriture dans le fameux Registre de la troupe, tenu par le comédien La Grange). Mais à l’époque, les auteurs ne gardaient pas leurs brouillons, après publication.
L’auteur caché, autrement dit le nègre, serait tout simplement… le vieux Corneille, écarté de la scène par le succès du jeune Racine et ex-collaborateur de Molière dans Psyché (1671), tragédie-ballet de cinq heures où les noms de Quinault et Lully apparaissent aussi au générique. Cette rumeur fut lancée il y a un siècle par Pierre Louÿs, poète parnassien adepte du canular - ayant fait passer ses très érotiques Chansons de Bilitis pour la traduction d’une poétesse de la Grèce antique. Il publie un premier article titré : « Corneille est-il l’auteur d’Amphitryon ? »
Rumeur relancée très « sérieusement » en 2003 par un linguiste, Dominique Labbé, trouvant une forte uniformité lexicale entre les deux répertoires (nombre de rimes réduit et constructions syntaxiques uniformes).
La majorité des acteurs et des connaisseurs de Molière s’insurgent contre cette thèse qui fait beaucoup parler, comme toute « bonne » rumeur. Des controverses s’ensuivent. Aux dernières nouvelles, la rumeur fait partie des fake-news. Deux chercheurs du CNRS ont fait une analyse statistique approfondie des habitudes d’écriture et des tics de langage au siècle classique : tout le théâtre présente certaines similitudes et Molière est bien l’auteur de ses pièces.
Shakespeare, l’homme de théâtre le plus illustre au monde, connut une mésaventure comparable pour le 400e anniversaire de sa mort, en 2016. Un groupe d’universitaires anglais démontra que sur 44 pièces, 17 sont coécrites par son grand rival, Christopher Marlowe. L’honneur est sauf et l’histoire d’Angleterre reste la plus passionnante, juste après notre histoire de France.
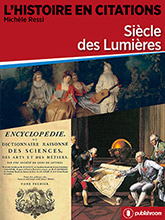 SIÈCLE DES LUMIÈRES
SIÈCLE DES LUMIÈRES
30. Petite histoire de l’opéra-comique créé à Paris en 1714 : un genre musical populaire, mais pas comique .
« J’ai vu ce que je n’avais jamais vu, des opéras comiques. »22
VOLTAIRE (1694-1778), Lettre à d’Argental, 19 sept. 1766. « opéra », définition dans le dictionnaire Littré
Le grand philosophe des Lumières appartient au siècle de la « théâtromanie » qu’il incarne lui aussi. N’oublions pas qu’il a écrit pour le théâtre et connut son grand succès avec Zaïre (1732)… même si ses tragédies sont aujourd’hui injouables…
Les Parisiens sont fous de spectacles, les salles qui s’ouvrent par dizaines font le plein, des genres nouveaux s’imposent. Aux antipodes du genre noble de la tragédie, l’opéra comique (sic, en deux mots), ce genre mixte qui tient de la comédie par le dialogue et de l’opéra par le chant.
« Je suis affligé de la Martinique [prise par les Anglais] et de mon roué [Calas] ; nous sommes bien sots et bien fanatiques ; mais l’opéra comique répare tout. »
VOLTAIRE (1694-1778), Voltaire, Lettre à Damilaville, 13 déc. 1762. « opéra », définition dans le dictionnaire Littré
Notre infatigable auteur qui pratique avec bonheur tous les genres se distingue par son abondante Correspondance (quelque 40 000 lettres – il nous en reste 14 000, petit trésor consultable en ligne et cité à l’envi dans d’innombrables sources, dont les dictionnaires). Le théâtre en général et en particulier l’opéra comique est un thème inépuisable.
« Joue-t-on encore Éponine ? L’opéra comique soutient-il toujours la gloire de la France ? »
« Il ne fallait aux Romains que panem et circenses ; nous avons retranché panem, il nous suffit du circenses, c’est-à-dire de l’opéra comique. »
« Je puis dire qu’en relevant le caractère de l’opéra comique, j’en créais un genre nouveau. »
Jean-François MARMONTEL (1723-1799), Mémoires IX
Autre polygraphe contemporain, écrivain, encyclopédiste, historien, conteur, romancier, grammairien, poète, philosophe… et dramaturge.
Lié à Voltaire par une amitié de plus de trente ans et « naturellement » ennemi de Rousseau (qui déteste le théâtre, mais écrit quand même), il se lance dans la tragédie, le genre noble : Denys le Tyran (1748) et Aristomène (1749) remportent le même succès. Les deux tragédies qui suivent sont un échec et la dernière, Egyptus, n’a qu’une seule représentation.
Marmontel va prendre sa revanche en ajoutant de la musique à ses prochaines œuvres destinées à la scène. Sollicité par le compositeur André Grétry, il écrit le livret du Huron, adapté de L’Ingénu de son ami Voltaire, créé au Théâtre-Italien de Paris le 20 août 1768 : le succès est au rendez-vous.
Il enchaîne avec Lucile, le 5 janvier 1769, Silvain, le 19 février 1770, L’Ami de la maison, donné à Fontainebleau le 26 octobre 1771 et à Paris le 24 mai 1772, Zémire et Azor, adaptation du conte de La Belle et la Bête, jouée à Fontainebleau le 9 novembre 1771 et à Paris le 16 décembre 1771. Concernant cette œuvre, Rétif de La Bretonne écrit dans Les Nuits de Paris : « Marmontel, je te remercie de cette scène délicieuse ! C’est presque la seule comédie-ariette que je te pardonne ! »
« Vous embellissez tout ce que vous touchez. »
VOLTAIRE (1694-1778), Lettre à Charles-Simon Favart, 3 octobre 1775
Très juste hommage à Charles Simon Favart (1710-1792), d’abord connu pour Les Trois Sultanes ou Soliman second (1761) : « Point d’esclaves chez nous ; on ne respire en France / Que les plaisirs, la liberté, l’aisance / Tout citoyen est roi sous un roi citoyen. »
Marié à Justine Favart, comédienne et chanteuse de talent, considéré comme le créateur de la comédie musicale et du vaudeville dramatique, il fait du « théâtre aux armées », attaché au service du maréchal de Saxe. Ce célèbre séducteur s’éprend de Mme Favart qui s’enfuit pour lui échapper, la mésaventure tourne mal et le couple ne retrouvera sa liberté qu’à la mort du maréchal (1750).
En 1750, le couple rallie la Comédie Italienne, rivale de l’Opéra-Comique créé en 1714. De danseuse, Justine devient actrice chantante ainsi que co-auteure de la plupart des pièces de son époux : 42 créations sur presque 27 ans de carrière.
Quand l’Opéra-Comique fusionne avec la Comédie Italienne en 1763, ils peuvent enfin déployer tous leurs talents. Remarquable par son art de la métamorphose, Mme Favart impose sur la troisième scène du royaume la réforme du costume et la vérité scénique, avant Mlle Clairon et Lekain à la Comédie Française. Pionnière en France de l’art moderne de l’interprétation, elle engage l’opéra-comique dans la peinture authentique des mœurs et des sentiments. Le nom de (des) Favart reste aujourd’hui encore attaché à l’Opéra-Comique, théâtre national toujours situé place Boieldieu, 2eme arrondissement. Mais la mort de sa femme brise l’homme et sa carrière.
On appelle désormais opéra-comique le genre de spectacle représenté par l’Opéra-Comique où le théâtre parlé s’intègre aux morceaux chantés. L’opéra-comique français le plus mondialement connu est un drame, Carmen (1875), musique de Georges Bizet, sur un livret de Meilhac et Halévy, adapté de la nouvelle de Prosper Mérimée, Carmen. Les autres titres du répertoire sont également dramatiques : Faust, Manon, Roméo et Juliette, Werther, Louise. Un opéra littéralement comique est un opéra-bouffe (de l’italien, opera buffa) : chef d’œuvre du genre, Le Barber de Séville de Rossini, d’après la comédie de Beaumarchais. Cas particulier des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, qualifié à juste titre d’opéra fantastique. Reste l’opérette, à l’origine plus modeste : livret court et peu de personnages, mais devenue plus ambitieuse et « à grand spectacle ».
Si le genre est « en déclin », faute de créations, les salles toujours vouées à l’opéra-comique sont pleines, y compris à l’Opéra de Paris (Garnier ou Bastille)
31. « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! » : réplique tactique loin du mythe de la « guerre en dentelles ».
« Messieurs les Anglais, tirez les premiers. »1122
Comte d’ANTERROCHES (1710-1785), à Lord Charles Hay, Fontenoy, 11 mai 1745. Précis du siècle de Louis XV (1763), Voltaire
Ce mot célèbre, cité par ailleurs dans une Histoire de l’armée d’Adrien Pascal (1847), résume le bref dialogue rapporté par Voltaire, suite de la guerre de Succession d’Autriche, lors d’un siège mené par les Français près de Tournai. Le commandant de la compagnie de tête des gardes anglaises a lancé : « Messieurs des gardes françaises, tirez ! » Le commandant des gardes françaises lui répondit : « Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers. Tirez vous-mêmes. »
Cette réplique, plus tactique qu’il n’y paraît, est moins l’illustration d’une guerre en dentelle que l’expression d’un impératif militaire : quand une armée a tiré, le temps qu’elle recharge ses armes, l’ennemi peut attaquer avec profit. C’est pourquoi le maréchal de Saxe dénonçait les « abus de tirerie ».
32. « Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer. » : Voltaire n’était pas du tout athée, mais déiste.
« Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer. »1024
VOLTAIRE (1694-1778), Épîtres
Déiste fervent, il s’oppose aux encyclopédistes athées (Diderot, d’Holbach). Il croit à « l’éternel géomètre », l’« architecte du monde » qu’il ne cesse d’évoquer : « L’univers m’embarrasse et je ne puis songer / Que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger. »
À l’origine de la création du monde, Voltaire reconnaît un Dieu qui garde une influence dans son fonctionnement, mais il rejette entre Lui et les hommes tout intermédiaire, comme les religions et leur tradition
« Dieu ? Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. »1129
VOLTAIRE (1694-1778), à un ami s’étonnant de le voir se découvrir devant le Saint-Sacrement à une procession en 1750, Correspondance (posthume)
Notre philosophe trouve par ailleurs une grande utilité à Dieu qui fonde la morale : « Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets croient en Dieu ; et je m’imagine que j’en serai moins volé. » En revanche, il s’en prend à la religion qui crée l’intolérance et en France, au catholicisme qui bénéficie de l’appui du pouvoir civil. Tout l’inverse de ce qui se passe outre-Manche.
« S’il n’y avait en Angleterre qu’une religion, le despotisme serait à craindre ; s’il y en avait deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses. »1025
VOLTAIRE (1694-1778), Lettres philosophiques, ou Lettres anglaises (1734)
L’auteur admire le régime anglais, qu’il eut tout loisir d’étudier en trois ans d’exil. Il expose les leçons que la France peut en tirer en maints domaines (religion, économie, politique).
La Révolution qui s’empressera de panthéoniser son grand homme juste avant son confrère ennemi Rousseau, avait bien compris Voltaire.
« Il combattit les athées et les fanatiques
Il inspira la tolérance
Il réclama les droits de l’homme contre la servitude de la féodalité.
Poète, historien, philosophe, il agrandit l’esprit humain, et lui apprit à être libre. »Épitaphe entourée de deux anges sur le tombeau en pierre de Voltaire au Panthéon.
33.« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche » : réplique faussement attribuée à Marie-Antoinette, pour nuire à la reine.
« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche. »1217
Mot attribué (sans doute à tort) à MARIE-ANTOINETTE (1755-1793), et incontestablement emprunté à Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778). La Grande Peur de 1789 (1932), Georges Lefebvre
Le mot se trouve dans les Confessions (rédigées de 1765 à 1770, édition posthume). Scène plaisante, par son souci du détail autobiographique : le narrateur a envie de boire un petit vin blanc d’Artois, mais il n’a jamais pu boire sans manger, il songe à un morceau de pain, mais il n’ose pas en demander au maître de maison, ni aller en acheter lui-même, cela ne se fait pas, quand on est un Monsieur trop bien habillé… « Enfin, je me rappelais le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain et qui répondit : « Qu’ils mangent de la brioche ! » J’achetai de la brioche » (livre VI des Confessions).
Le mot reflète une réalité sociologique : l’ignorance (ou l’insouciance) des privilégiés face à la misère du peuple. Le temps n’est plus aux famines, mais les disettes sont périodiques en cas de mauvaise récolte, surtout aux périodes de soudure. En mai 1775 à Paris, la hausse du prix du pain, denrée vitale, entraîne une vague d’émeutes. C’est la « guerre des Farines », prémices de la Révolution. C’est aussi une révolte contre la libéralisation du commerce des grains, par édit de Turgot (13 septembre 1774). La concurrence devait faire baisser les prix, en vertu du « Laissez faire, laissez passer » cher aux physiocrates. C’est compter sans la spéculation. D’autres édits vont rendre le contrôleur général des finances Turgot plus populaire aux pauvres.
C’est un journaliste qui attribue pour la première fois cette phrase à la reine déchue. « On se rappelle quelle indignation on excita, dans le temps, contre la malheureuse reine Marie-Antoinette, en faisant courir le bruit que, entendant dire que le peuple était malheureux et qu’il n’avait pas de pain, elle avait répondu : Eh bien ! Qu’il mange de la brioche », écrit ainsi Alphonse Karr dans un numéro du journal satirique Les Guêpes publié en 1843. Depuis, la croustillante anecdote est entrée dans la culture populaire.
La rumeur est tenace. En février 2023, lors de la réforme des retraites, la députée insoumise Elisa Martin convoquait encore cette citation de Marie-Antoinette pour dénoncer la politique du gouvernement sur les retraites.
 RÉVOLUTION
RÉVOLUTION
34.« 14, rien. » Mot noté dans un carnet de chasse : interprétation à charge contre Louis XVI.
« 14, rien. »1331
LOUIS XVI (1754-1793), note ces deux mots dans son carnet avant de se coucher, château de Versailles, le soir du 14 juillet 1789. Histoire des Français, volume XVII (1847), Simonde de Sismondi
L’histoire lui a beaucoup reproché cette indifférence à l’événement, mais il faut préciser à sa décharge que le fameux carnet consigne surtout ses tableaux de chasse.
Le roi a été prévenu de l’agitation à Paris, par une députation de l’Assemblée. Le 11 juillet, il a malencontreusement renvoyé Necker, ministre des Finances jugé trop libéral, l’homme le plus populaire du royaume, et il le rappellera le 16. En attendant, le mal est fait : manifestations le 12 juillet, municipalité insurrectionnelle à l’Hôtel de Ville, milice et foule armées le 13 (avec 28 000 fusils et 20 canons pris aux Invalides). À la Bastille, on est allé chercher la poudre et les munitions.
La forteresse est avant tout le symbole historique de l’absolutisme royal : la révolution parlementaire est devenue soudain populaire, et parisienne, en ce 14 juillet 1789.
Contrairement à ce que l’on croit trop souvent, ce jour n’est pas l’origine de notre fête nationale. Il faut attendre l’année suivante, la Fête de la Fédération.
35. La prise de la Bastille libère « les victimes d’un joug détesté » : sept embastillés, quatre faussaires, deux fous, un débauché !
« Le bourgeois et le marchand
Marchent à la Bastille
Et ran plan plan […]
Sortez de vos cachots funèbres
Victimes d’un joug détesté
Voyez à travers les ténèbres
Les rayons de la Liberté ! »1330La Prise de la Bastille (1790), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Chanson vaudeville, genre en vogue à la fin du XVIIIe siècle.
L’événement se joue en deux actes : « Départ pour le siège », puis « Délivrance des captifs ». Le style est typique de l’époque. Les « victimes d’un joug détesté », ce sont les prisonniers libérés.
Mais l’inventaire est dérisoire. Ils sont sept : quatre escrocs ayant falsifié une lettre de change, deux malades mentaux et un jeune gentilhomme prodigue, le comte de Solanges, embastillé pour inceste. À quelques jours près, on trouvait le marquis de Sade – transféré à Charenton.
36.« Ah ça ira ! » : le même mot change de sens à un an d’intervalle et en deux carmagnoles.
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Le peuple en ce jour sans cesse répète,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira.
Malgré les mutins tout réussira […]
Pierre et Margot chantent à la guinguette :
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira.
Réjouissons-nous le bon temps viendra. »1371LADRÉ (XVIIIe siècle), paroles, et BÉCOURT (XVIIIe siècle), musique, Le Carillon national, chanson. Chansons nationales et populaires de France (1846), Théophile Marion Dumersan
Le chant est plus connu sous le nom de son refrain : « Ah ! ça ira ». Ladré, chanteur des rues, en a écrit les paroles sur Le Carillon national, musique de contredanse signée Bécourt, violoniste de l’orchestre au théâtre des Beaujolais. La reine Marie-Antoinette la jouait volontiers sur son clavecin.
Le texte, innocent à l’origine, reprend l’expression de Benjamin Franklin venu en mars 1777 pour défendre la cause des Insurgents américains contre l’Angleterre. La simplicité de mise et le franc-parler de cet ambassadeur septuagénaire, envoyé du Nouveau Monde, contrastent avec les airs de la cour et séduisent d’emblée les Parisiens. Voltaire et Turgot l’admirent également.
Résolument optimiste, il répétait au plus fort de la guerre d’Indépendance, à qui lui demande des nouvelles : « Ça ira, ça ira. » Le mot est connu, le personnage populaire et dans l’enthousiasme des préparatifs de la fête, le peuple chante : « Ça ira, ça ira. »
« Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates on les pendra. »1381Ah ! ça ira, couplet anonyme, sur une musique de BÉCOURT (XVIIIe siècle), chanson
Le plus célèbre « refrain de la Révolution française », né bon enfant, se durcit et se radicalise, quand une main anonyme ajoute ce couplet vengeur. Toujours sur le même air de contredanse populaire du Carillon national.
37. La première élection au « suffrage universel » : très peu d’électeurs et femmes exclues… jusqu’en 1944.
« Le peuple français est invité à former une Convention nationale […] Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions. »1424
Législative, 10 août 1792. Collection générale des lois : décrets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du Conseil d’État et règlements d’administration publiés depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814, Assemblée législative : mai- septembre 1792, volume III, n° 2 (1818)
Ces deux mesures sont prises par l’Assemblée qui ne fait que se survivre jusqu’à la prochaine Convention. Juridiquement, ce n’est qu’une suspension de plus ; politiquement, la Législative se saborde et le roi est déchu, le pouvoir est à la Commune de Paris : la « Première Terreur » va durer six semaines, préfigurant la dictature de la gauche jacobine et montagnarde.
« L’assemblée nationale décrète que, pour la formation de la convention nationale prochaine, tout Français âgé de vingt et un ans, domicilié depuis un an, vivant du produit de son travail, sera admis à voter dans les assemblées de commune et dans les assemblées primaires, comme tout autre citoyen actif. »
Décret relatif à la formation de la convention nationale du 10 août 1792
Finalement, trois à quatre millions de « passifs » obtiennent une nationalité à laquelle ils ne sont pas préparés et une proportion infime se rend dans les assemblées primaires le 26 août 1792 : à peine 700 000 sur sept millions de votants potentiels, chiffres proches de la monarchie censitaire.
Malgré tout, le petit peuple s’y manifeste pour la première fois, même si le nombre ne peut être clairement évalué.
L’effondrement électoral constaté à l’occasion des élections législatives de 1791 se confirme, malgré l’instauration du « suffrage universel ». L’élargissement du corps électoral n’a pratiquement aucun effet sur le niveau de la participation ! À Paris (pourtant particulièrement « politisé), moins de 10 % des inscrits se rendent aux urnes. Au total, 3 360 000 voix (sur une population de 28,1 millions d’habitants en 1790).
Quant aux femmes… Ce sont les grandes absentes de ce « suffrage universel ». Une infime minorité d’entre elles revendiquent pourtant le droit de vote sous la Révolution.
« La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune. »1397
Olympe de GOUGES (1755-1793), Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, septembre 1791. Le XIXe siècle et la Révolution française (1992), Maurice Agulhon
Le préambule du texte est dédié à la reine. Cette féministe, l’une des premières de l’histoire, mourra guillotinée en 1793, après bien d’autres provocations.
Comme Condorcet qui finira Girondin, se suicidant pour échapper à la guillotine, Olympe de Gouges plaide pour l’égalité entre les sexes, ce qui inclut le droit de vote et l’éligibilité (permettant de monter à la tribune en tant que député). Mais c’est impossible aussi longtemps que la femme est considérée comme juridiquement mineure, soumise au père ou à l’époux.
Les femmes seront finalement la « minorité » la plus durablement brimée, dans l’histoire.
Les premières « suffragettes » apparaîtront en 1903 en Grande-Bretagne, pour désigner les militantes d’un mouvement nouveau fondé à Manchester par Emmeline Pankhurst : l’Union politique et sociale des femmes. Le terme apparaît dans The Daily Mail en 1906 : utilisé pour railler les femmes et dénigrer leur engagement (le suffixe -ette à valeur de diminutif visait à minorer tant les femmes que leur engagement).
Les suffragettes décidèrent de s’approprier le terme et de et le revendiquer. Le terme désignera toutes celles qui se sont engagées dans un combat aux méthodes plus radicales, voire plus violentes. Aux États-Unis, ce mot a revêtu une connotation péjorative, pour se moquer des femmes engagées dans la lutte et les discréditer, en insinuant notamment que les Américaines suivaient les égarements violents des Britanniques.
En France, l’évolution est plus tardive, y compris dans les mentalités féminines.
« Les paysannes restaient bouche bée quand je leur parlais du vote. Les ouvrières riaient, les commerçantes haussaient les épaules, les bourgeoises me repoussaient horrifiées. »2665
Louise WEISS (1893-1983) évoquant une de ses conférences de 1934. Ce que femme veut (1946), Louise Weiss
Née en 1893 (année où la loi accordait à la femme séparée de corps la pleine capacité civile), morte en 1983 (année où la loi du 13 juillet instaure l’égalité professionnelle entre les sexes), cette militante féministe et européenne sera témoin de tous les progrès dans la condition féminine.
En 1944, le droit de vote des femmes fait partie des évolutions nécessaires pour tourner la page du régime de Vichy et renouer avec la République. Le 18 mars 1944, le général de Gaulle, alors président du Comité français de libération nationale, déclare devant l’Assemblée consultative provisoire que « le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous ».
Le 21 avril 1944, l’ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération dispose que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes » (article 17). Les premières élections auxquelles les femmes participent seront les municipales d’avril-mai 1945.
Rédigé et adopté en 1946, le préambule de la Constitution de la IVe République rappelle que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
38. Le « sang impur » de la Marseillaise n’est pas le sang ennemi (sang bleu des nobles), mais celui du peuple français.
« Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchez, marchez,
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons ! »1417ROUGET DE L’ISLE (1760-1836), Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin, refrain (1792)
« Trouvé à Strasbourg […] il ne lui fallut pas deux mois pour pénétrer toute la France. Il alla frapper au fond du Midi, comme par un violent écho, et Marseille répondit au Rhin. Sublime destinée de ce chant ! », écrit Michelet, lyrique et romantique, dans son Histoire de la Révolution française.
Mystérieusement arrivé à Marseille, le chant plaît au bataillon des Marseillais, qui l’adopte comme hymne de ralliement et le chante le 29 juin 1792, en plantant dans la ville un arbre de la Liberté. Son histoire ne fait que commencer.
Il est toujours chanté avec la même conviction, fait d’autant plus étonnant que le « sang impur » est l’objet d’un contresens quasi général, même chez les intellectuels les plus respectés.
« Ces paroles ignobles de la Marseillaise où on parle du sang impur des ennemis, qui est un mot d’un racisme tel qu’on devrait avoir honte de l’enseigner aux enfants. »
Michel SERRES (1930-2019 ), 9 mai 2008, France Culture, « Vendredis de la philosophie »
« Quels que soient les ennemis, qu’ils aient un sang impur, c’est quand même d’un racisme, j’aurais honte de l’enseigner à mes étudiants, ils ont tous un sang pur et l’impureté du sang est quelque chose qui me fait horreur. […] Ce n’est pas seulement un imaginaire raciste, c’est une tradition qui a été si longue qu’elle a fondé beaucoup de traditions politiques, beaucoup de philosophies du droit . »
Rétablissons la vérité en puisant à une bonne source. https://resistance-44.fr
« À l’époque, ce qu’on appelait le sang pur, c’était le sang des nobles qui, seuls, pouvaient prétendre au Pouvoir et à des fonctions d’officiers dans l’Armée. »
Joseph FOUCHÉ (1759-1820), mi-janvier 1804. Fouché (1903), Louis Madelin
Lors de la Révolution – et notamment de l’attaque des autrichiens – les nobles se sont enfuis et il ne restait donc que des « Sang impur » (Républicains), par opposition aux « Sang pur » (Royalistes).
Au cri de « La nation est en danger », c’étaient des gens du peuple qui prenaient les armes pour combattre l’envahisseur et qui étaient disposés à verser leur propre sang pour la liberté. C’est dans le même esprit qu’a été composé le « Chant du départ » …
Et les sillons sont des tranchées creusées un peu partout dans la campagne et les champs, lors des sanglantes batailles. Ainsi, « Qu’un sang impur abreuve nos sillons » signifie donc que c’est notre « Sang impur » à NOUS, le peuple, qui nourrira nos terres. En aucun cas il ne s’agit du sang de l’ennemi.
Ce serait bizarre et incohérent quand même, de chanter que le sang de l’ennemi nourrit nos terres, nos sillons. On peut reprocher beaucoup de choses à la Marseillaise, notamment son esprit guerrier, mais pas le « Sang impur ».
39. « Sans-culottes » contre « culottes dorées » : Robespierre les oppose, oubliant ses origines.
« Celui qui a des culottes dorées est l’ennemi de tous les sans-culottes. Il n’existe que deux partis, celui des hommes corrompus et celui des hommes vertueux. »1502
ROBESPIERRE (1758-1794), au club des Jacobins, 8 mai 1793. Œuvres de Maximilien Robespierre (posthume, de 1912 à 1967)
Sans les nommer, l’Incorruptible dans son discours dénonce les Girondins qui seront bientôt les victimes de la Terreur qu’il fera décréter le 5 septembre 1793 : « La Terreur est à l’ordre du jour. ».
Rappelons que les Girondins sont issus de la même classe bourgeoise que les amis de Robespierre et que l’ex-avocat d’Arras est toujours très élégamment vêtu (perruqué et poudré sur ses portraits).
Ce manichéisme est donc simpliste, mais efficace. Il oppose les riches aux pauvres – les « sans-culottes », nom donné au début de la Révolution et par mépris aux manifestants populaires qui portent des pantalons à rayures et non des culottes (hauts-de-chausses), symbole vestimentaire de l’aristocratie d’Ancien Régime.
40. « L’insurrection est le plus sacré des droits… » : notre première Constitution est inapplicable.
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »1514
Constitution du 24 juin 1793, article 35
C’est la Constitution de l’an I, jamais appliquée du fait de la Terreur décrétée le 5 septembre et qui instaure un régime révolutionnaire.
Constitution mémorable à divers titres, approuvée par référendum au suffrage universel (toujours masculin), texte très démocratique et décentralisateur, proclamant de nouveaux droits économiques et sociaux (dont l’instruction), consacrant la souveraineté populaire, le recours au référendum… et le droit à l’insurrection, considéré comme un devoir.
Cet article est en tout cas inapplicable. L’explication juridique est très claire et (pour une fois) aisée à comprendre.
« Le droit à l’insurrection, incontestable en théorie, est en fait dépourvu d’efficacité. La loi constitutionnelle d’un pays ne peut le reconnaître sans jeter dans ce pays un ferment d’anarchie. »
Léon DUGUIT ( 1859-1928), Traité de droit constitutionnel (1911)
Et d’ajouter… « C’est ce qui faisait dire à Boissy d’Anglas que la Constitution de 1793 avait organisé l’anarchie. » Ce Traité de droit constitutionnel propose une vision nouvelle de la théorie de l’État et du droit. Il occupe une place singulière parmi les ouvrages de la doctrine et joue un rôle important dans la construction du droit public.
Quant à la Constitution de l’An I, elle s’inspire des idées de Rousseau et du Contrat social, livre de chevet de Robespierre.
41. Marat, « l’Ami du Peuple » : sitôt panthéonisé… et vite dépanthéonisé.
« Il y a une année que cinq ou six cents têtes abattues vous auraient rendus libres et heureux. Aujourd’hui, il en faudrait abattre dix mille. Sous quelques mois peut-être en abattrez-vous cent mille, et vous ferez à merveille : car il n’y aura point de paix pour vous, si vous n’avez exterminé, jusqu’au dernier rejeton, les implacables ennemis de la patrie. »1380
MARAT (1743-1793), L’Ami du peuple, décembre 1790. Histoire politique et littéraire de la presse en France (1860), Eugène Hatin
Déjà populaire auprès du petit peuple parisien, mais détesté de toute la classe politique, Marat joue au « prophète de malheur » dans le journal quotidien qu’il publie et qui est pour l’heure sa seule tribune. Ici, c’est un véritable appel au meurtre, alors que la guillotine n’est pas encore entrée en scène et que la Terreur est une notion inconnue.
« C’est par la violence que doit s’établir la liberté, et le moment est venu d’organiser momentanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. »1495
MARAT (1743-1793), L’Ami du peuple, 13 avril 1793. La Révolution française (1989), Claude Manceron, Anne Manceron
Dans son journal presque quotidien et très populaire, il justifie le Tribunal révolutionnaire qu’il a contribué à rendre plus expéditif, pour s’opposer à la contre-révolution qu’il dénonce au sein même de la Convention nationale : « Levons-nous, oui, levons-nous tous ! Mettons en état d’arrestation tous les ennemis de notre Révolution et toutes les personnes suspectes. Exterminons sans pitié tous les conspirateurs, si nous ne voulons pas être exterminés nous-mêmes. »
Plus encore que la rhétorique et la rigueur d’un Robespierre, ce genre de phrase et le personnage de Marat révoltent les modérés. On parlerait aujourd’hui et sans exagération de « paranoïa ». Hugo écrit, dans son roman Quatre-vingt-treize : « Les siècles finissent par avoir une poche de fiel. Cette poche crève. C’est Marat. »
Trop, c’est trop ! Et l’accusateur se retrouvera bientôt accusé, devant le Tribunal révolutionnaire. Mais sa popularité est telle auprès du peuple qu’il est pratiquement intouchable et porté par la foule, il retrouve sa place à l’Assemblée. C’est Charlotte Corday, jeune normande digne du grand Corneille dont elle descend, qui « monte » à Paris pour poignarder Marat dans sa baignoire – souffrant d’une maladie de peau qui contribuait à sa laideur repoussante, il n’éprouvait de soulagement qu’au contact de l’eau.
« Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais républicaine bien avant la Révolution. »1522
Charlotte CORDAY (1768-1793), à son procès devant le Tribunal révolutionnaire, 17 juillet 1793. Les Grands Procès de l’histoire (1924), Me Henri-Robert
En un jour, la jeune fille devient une héroïne et reste l’une des figures de la Révolution. Le poète André Chénier la salue par ces mots : « Seule, tu fus un homme », ce qui contribuera à le perdre. Le député de Mayence, Adam Lux, qui la vit dans la charrette l’emmenant à l’échafaud, s’écria : « Plus grande que Brutus », et ce mot lui coûta la vie.
Lamartine la baptise l’Ange de l’assassinat et Michelet retrouve les accents qu’il eut pour Jeanne d’Arc : « Dans le fil d’une vie, elle crut couper celui de nos mauvaises destinées, nettement, simplement, comme elle coupait, fille laborieuse, celui de son fuseau. »
Mais pour les sans-culottes de Paris qui lui vouent un véritable culte, c’est un héros qu’il convient d’honorer.
« Ici repose Marat, l’Ami du Peuple, assassiné par les ennemis du peuple, le 13 juillet 1793. »1520
Épitaphe sur la tombe de Marat. Marat, l’ami du peuple (1865), Alfred Bougeart
Double rappel : son journal s’intitulait L’Ami du peuple et l’homme haï (et redouté) de ses confrères était idolâtré des sans-culottes. Sa gloire posthume fut éclatante, mais brève.
Le 25 juillet 1793, la rue des Cordeliers, où a été assassiné Marat à son domicile, est baptisée rue Marat, en même temps que l’on renomme la rue de l’Observance : place de l’Ami du Peuple. De nombreuses manifestations eurent lieu en son honneur, 58 localités changèrent leur nom en celui de Marat et le 21 septembre 1794, son corps fut transféré au Panthéon. Bref séjour et gloire éphémère. Après la Terreur, Marat n’était plus un modèle républicain !
« Des enfants ont promené un buste de Marat en l’accablant de reproches [et] l’ont ensuite jeté dans l’égout, en lui criant : ‘Marat, voilà ton Panthéon !’ »
Le Moniteur du 16 pluviôse an III (4 février 1795)
Le monument élevé à sa mémoire sur la place du Carrousel est détruit. Et le 8 février 1795, un décret le dépanthéonise en précisant que l’image d’aucun citoyen ne figurera plus dans l’Assemblée ou en un lieu public quelconque que dix ans après sa mort – prudence pour éviter toute précipitation ! Rappelons que Mirabeau « l’Orateur du peuple » avait subi le même sort, après la découverte de la fameuse armoire de fer du roi qui contenait la preuve de son double jeu, autrement dit sa trahison bien monnayée.
Reste heureusement une « valeur sûre » comparable à Voltaire déjà au Panthéon, un Nom resté célèbre pour de bonnes raisons républicaines, Rousseau. Et les deux confrères ennemis se retrouveront côte à côte pour l’éternité.
42 .« La Tragédie court les rues. » : 2 639 morts à Paris, mais 600 000 morts dans la guerre de Vendée. Les malentendus sémantiques et statistiques compromettent souvent le récit historique.
« Que parles-tu, Vallier, de faire des tragédies ? La Tragédie court les rues. »1596
Jean-François DUCIS (1733-1816), Correspondance, au plus fort de la Terreur. Essais de Mémoires, ou Lettres sur la vie, le caractère et les écrits de J.-F. Ducis (1824), François Nicolas Vincent Campenon
Poète tragique et traducteur (très libre) de Shakespeare, il répond à l’un de ses amis. Et témoigne, dans cette lettre : « Si je mets les pieds hors de chez moi, j’ai du sang jusqu’à la cheville. »
Certes… mais les spectacles sont florissants (hors les jours et les quartiers tragiques), on joue beaucoup d’œuvres « de circonstance », la Révolution n’ayant inspiré aucune œuvre théâtrale jouable par la suite. On se rabat sur les tragédies de Voltaire, qui ne sont pas non plus des chefs-d’œuvre.
Deux noms d’artistes resteront : Talma, tragédien de la Comédie-Française, et David, peintre politiquement inspiré. On les retrouvera, au service de l’empereur Napoléon.
Dans le flot des chants et chansons révolutionnaires, il reste deux chefs d’œuvre, La Marseillaise de Rouget de l’Isle et Le Chant du départ de Chénier (Marie-Joseph) et Méhul. Et toute une série de chansons populaires.
C’est la Grande Terreur : plus de 1 300 exécutions à Paris, du 10 juin au 27 juillet (9 thermidor). Selon une étude de Donald Greer qui fait référence, 16 600 victimes sont exécutées en France après condamnation par une cour de justice révolutionnaire – avec près de 500 000 arrestations, de mars à juillet 1794.
Ces statistiques certes terribles… sont sans commune mesure avec le bilan de la guerre civile en province.
« Pays, Patrie, ces deux mots résument toute la guerre de Vendée, querelle de l’idée locale contre l’idée universelle, paysans contre patriotes. »1489
Victor HUGO (1802-1885), Quatre-vingt-treize (1874)
Dernier roman historique, situé en 1793, année charnière et riche en événements, il met en scène trois personnages : un prêtre révolutionnaire, un aristocrate royaliste et vendéen et son petit-neveu rallié à la Révolution. Ce choc des extrêmes rappelle la Commune (1871) et ses drames, vécus par Hugo. Les guerres civiles se suivent et se ressemblent tragiquement.
Les insurgés vendéens (les Blancs) vont réunir jusqu’à 40 000 hommes et remporter plusieurs victoires contre les patriotes (les Bleus), en ce printemps 1793 : prise de Cholet, Parthenay, Saumur, Angers, avant d’échouer devant Nantes (29 juin).
La Convention envoie des troupes républicaines dès juillet, mais les grands combats suivis de massacres seront organisés sous la Terreur, à partir d’octobre. Au total, la guerre de Vendée et la guerre des Chouans (mêmes causes, mêmes effets, en Bretagne et Normandie) feront quelque 600 000 morts, dont 210 000 civils exécutés, 300 000 morts de faim et de froid (100 000 enfants).
Ce génocide (mot employé par certains historiens) est, sans conteste, le plus lourd bilan à porter au passif de la Révolution.
Vous avez aimé ces citations commentées ?
Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.