« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »
Albert CAMUS (1913-1960), Sur une philosophie de l’expression, revue Poésie 44
Et en d’autres mots : « Sans savoir ou sans dire encore comment cela est possible, la grande tâche de l’homme est de ne pas servir le mensonge. »
L’Histoire nous donne des repères – encore faut-il qu’ils soient clairs… et historiquement exacts.
À l’époque de toutes les confusions, approximations, exagérations et autres fake-news, voici donc 55 repères historiques : points fondamentaux ou détails anecdotiques, amusants ou tragiques… à méditer et partager à l’occasion.
Revivez toute l’Histoire en citations dans nos Chroniques, livres électroniques qui racontent l’histoire de France de la Gaule à nos jours, en 3 500 citations numérotées, sourcées, replacées dans leur contexte, et signées par près de 1 200 auteurs.
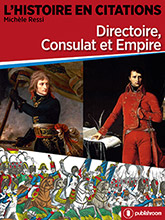 PREMIER EMPIRE
PREMIER EMPIRE
43. Le « Petit caporal » ou Napoléon le Petit (vu par les Anglais) : c’est une légende. L’empereur était de taille moyenne et « le Petit » c’est l’autre (Napoléon III vu par Hugo).
« Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur : ce qui est grand est toujours beau. » 27
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), Jean Tullard, Napoléon ou le mythe du sauveur.
Personnage politique mondialement célèbre, il fut particulièrement visé par la caricature. Irrévérencieuse, sacrilège, perverse, elle attaque de front l’image de l’Empereur avec des variantes nationales. Le public prend goût à ce genre satirique et contestataire. Les Anglais (nos principaux ennemis) sont les maîtres incontestés du genre, jusqu’à la fin de l’Empire.
Représenté comme un personnage de taille plus petite que nature (jusqu’à devenir nain), Napoléon porte un chapeau, des bottes et un sabre trop grand pour lui. Avec ces plumes souvent accrochées au chapeau, ce personnage fantaisiste ne ressemble guère à un chef d’État et les Anglais ne le reconnaissent pas pour tel : ce parvenu arrivé au pouvoir après un coup d’État ne fait pas partie d’une grande famille, comme les autres monarchies européennes.
L’allusion au « petit Caporal » qui entretient le malentendu a une tout autre raison ! En contradiction avec l’idée que Napoléon se faisait de lui-même.
« Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. » 1766
Napoléon BONAPARTE (1769-1821), Discours de Lyon, 1791
Ce sont les premiers mots que l’histoire a retenus du futur empereur. Bonaparte, 22 ans, lieutenant d’artillerie, participe au concours ouvert par l’Académie de Lyon. Le thème : l’éducation à donner aux hommes pour les mettre sur le chemin du bonheur – d’où l’autre nom du « Discours sur le bonheur » .
Le « petit Caporal » (avec un C majuscule) sera le surnom donné à Napoléon Bonaparte (alors Premier Consul) par ses soldats, pendant la campagne d’Italie (1799-1800). Ils avaient imaginé décerner à leur nouveau chef un grade nouveau pour chacune de ses victoires, en partant du plus bas. Et ce surnom lui est resté. L’expression prendra ensuite un sens péjoratif : dans l’armée ou l’administration, petit Caporal est synonyme de petit chef et désigne celui qui a l’allure autoritaire, la prétention de faire autorité (sans en avoir toujours la fonction officielle).
On parle aussi du « Petit tondu » . La raison est simple. Dès le Consulat (1799), Bonaparte abandonne ses cheveux mi-longs à la mode révolutionnaire pour une coiffure plus en lien avec son temps et la fonction occupée… Il commençait aussi à perdre ses cheveux et pour cacher une calvitie naissante, il choisit de rabattre une mèche sur le front. Dans cet univers riche en surnoms et autres sobriquets, Bonaparte est devenu « le Petit tondu » .
Petit, petit !? En réalité, Napoléon mesurait 1,69 mètre – plus grand que la moyenne de l’époque. Mais il était souvent entouré de gardes du corps ou de hussards athlétiques, d’où cette impression qui corrobore l’image du « petit Caporal » ou du « Petit tondu » .
Et voilà que Victor Hugo accroît le malentendu avec un pamphlet, Napoléon le Petit qui ne vise évidemment pas Napoléon Ier dont il entretient le culte… mais l’autre qui s’est servi du Nom et le déshonore, avec le coup d’État qui lui donne tout pouvoir.
« Qu’importe ce qui m’arrive ? J’ai été exilé de France pour avoir combattu le guet-apens de décembre […] Je suis exilé de Belgique pour avoir fait Napoléon le Petit. Eh bien ! je suis banni deux fois, voilà tout. Monsieur Bonaparte m’a traqué à Paris, il me traque à Bruxelles ; le crime se défend, c’est tout simple. » 2221
Victor HUGO (1802-1885), Pendant l’exil (écrits et discours de 1852-1870)
Hugo a fui le 11 décembre 1851, pour éviter d’être arrêté. L’exil commence. Il va durer près de vingt ans, avant le triste retour au lendemain de l’abdication de l’empereur, en pleine guerre, à la veille de la défaite et de la Commune.
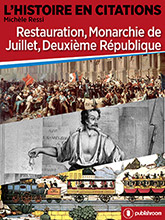 RESTAURATION
RESTAURATION
La Chambre « introuvable » : vite retrouvée sous la Restauration, pour le bonheur des ultras et le malheur de l’opposition.
« Cette Chambre, que dans les premiers temps le roi qualifia d’introuvable, se montra folle, exagérée, ignorante, passionnée, réactionnaire, dominée par des intérêts de caste. » 1963
Comtesse de BOIGNE (1781-1866), Mémoires (posthume)
Charlotte Louise Adélaïde d’Osmont a vécu sous onze règnes et régimes différents, tenant salon sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, époques fort bien vues par cette royaliste libérale. Et le qualificatif d’« introuvable » est passé dans l’histoire.
Les élections des 14 et 21 août 1815 font à Louis XVIII ce cadeau empoisonné d’une assemblée « plus royaliste que le roi » . Avec 350 députés ultras sur 402, cette fameuse Chambre n’est pas si « introuvable » , puisqu’elle sera « retrouvée » lors de prochaines élections (en 1824).
La raison en est simple : l’étroitesse du pays légal par rapport au pays réel. Le régime censitaire donne le droit de vote aux hommes de plus de 30 ans, payant au moins 300 francs d’impôts directs. Soit 110 000 électeurs sur 9 millions d’adultes en 1817, avec 80 % de propriétaires fonciers. Pour être député, il faut avoir au moins 40 ans et payer 1 000 francs d’impôts directs : 15 000 Français seulement sont éligibles.
Cette Chambre royaliste et ne représentant que ses intérêts s’oppose aux ministres modérés, les empêche de gouverner, et provoque la seconde Terreur blanche de notre histoire. La haine des royalistes contre les hommes de la Révolution et de l’Empire est encore exaspérée après les Cent-Jours. « Ils finiraient par m’épurer moi-même ! » , dit Louis XVIII avec son humour royal. Mais le tsar de Russie menace de laisser ses troupes d’occupation en France, si le roi ne renvoie pas de tels députés ! D’où la dissolution du 5 septembre 1816.
« Le règne du roi est fini, celui de son successeur commence. » 1979
Duc de BROGLIE (1785-1870), après la chute du ministère Decazes, fin février 1820. Le Comte de Serre : la politique modérée sous la Restauration (1879), Charles de Mazade
C’est un constitutionnel modéré qui s’exprime. Il a compris que c’en est fini de la période libérale voulue par Louis XVIII : les ultras vont avoir le pouvoir, avec à leur tête le futur Charles X.
Le duc de Richelieu, rappelé à la présidence du Conseil par le roi, prend trois ultras dans son cabinet et tente une réaction modérée face à l’opposition libérale : suspension des lois de Serre sur la liberté de la presse, loi électorale du double vote encore plus élitiste.
Grand seigneur honnête, excellent administrateur, Richelieu n’a pas l’art de manœuvrer une assemblée, et sa politique est vite jugée trop modérée par les ultras. Vainqueurs aux élections de décembre 1820, ils auront définitivement gain de cause, quand le comte de Villèle va devenir chef du gouvernement, en décembre 1821.
« En somme, le roi a voulu voir de son vivant comment cela irait après sa mort, et il a constitué le premier cabinet de Monsieur ! » 1988
Marquis de SÉMONVILLE (1759-1839). Le Retour à la monarchie, 1815-1848 (1943), Jules Bertaut
Le marquis entra en politique comme jeune révolutionnaire, fut diplomate et juriste, et finira en « vieux chat » , aux dires de Talleyrand saluant ainsi sa ruse et son intelligence. Il prend acte du fait et juge fort bien : Louis XVIII vient d’accepter le cabinet ministériel que lui propose Monsieur, son frère le comte d’Artois. Villèle en est le chef, il n’y aura plus que des ultras au pouvoir, du 14 décembre 1821 jusqu’en janvier 1828.
Les élections de 1824 (25 février et 6 mars) donnent plus de 400 députés aux ultraroyalistes et à leurs alliés, contre seulement 15 libéraux. C’est bien la Chambre « retrouvée » .
45. Avec l’Algérie en 1830, la colonisation entre en scène : un malentendu historique qui n’a pas de fin ni de frontière.
« Vous êtes un méchant, un infidèle, un traître ! » 2006
HUSSEIN DEY d’Alger (vers 1765-1838), 30 avril 1827. La Restauration et la Monarchie de Juillet (1929), Jean Lucas-Dubreton
Joignant le geste à la parole, il frappe trois fois de son chasse-mouches Pierre Deval le consul de France, dont le gouvernement refuse de payer des fournitures de blés qui datent du Consulat et de l’Empire.
Le Dey refuse de présenter des excuses. Ce qui pourrait n’être qu’un fait divers va déboucher sur la guerre. L’incident venant aggraver des relations déjà tendues avec l’Algérie sert de prétexte à l’intervention de la France.
« Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas traiter l’affaire diplomatiquement. Vous en trouverez la preuve dans les termes que je vais employer : la France se f… de l’Angleterre ! » 2017
Baron Lemercier d’HAUSSEZ (1778-1854), ministre de la Marine, à Lord Stuart, 4 février 1830. Mémoires du Baron d’Haussez, dernier ministre de la Marine sous la Restauration (posthume, 1897)
Pour résumer une affaire algérienne qui se complique et s’envenime, l’Angleterre a désapprouvé l’intention de la France de venger l’honneur du consul contre le Dey d’Alger. Charles X, en accord avec son ministre Polignac, ordonne un blocus naval, avant l’expédition militaire décisive, avec l’amiral Duperré et de Bourmont, ministre de la Guerre : débarquement français en Algérie le 14 juin 1830.
« Vingt jours ont suffi pour la destruction d’un État dont l’existence fatiguait l’Europe depuis trois siècles. » 2019
Comte de BOURMONT (1773-1846), ordre du jour du ministre de la Guerre, après la reddition du Dey d’Alger, 5 juillet 1830. L’Europe et la conquête d’Alger (1913), Edgard Le Marchand
Prise d’Alger et reddition sans condition du Dey Hussein, suite à l’expédition militaire de l’amiral Duperré et du ministre de Bourmont, qui ont débarqué en Algérie, le 14 juin.
De Bourmont y gagne son bâton de maréchal de France et Chateaubriand dira, apprenant la prise d’Alger : « Cette nouvelle me ravit sans me rassurer. La Providence peut du même coup agrandir un royaume et renverser une dynastie. »
« Soldats, ils sont six mille, vous êtes trois cents. La partie est donc égale. Regardez-les en face et tirez juste. » 2092
Général CHANGARNIER (1798-1877), Première expédition de Constantine, 24 novembre 1836. Le Crapouillot (1958)
Le général commande l’arrière-garde, lors de la retraite. Au lendemain de la prise d’Alger en 1830, Louis-Philippe se contenta de l’occupation d’une frange côtière. Mais la résistance s’organise autour d’Abd el-Kader, devenu l’« émir des croyants » , tandis que le bey de Constantine, Ahmad, contraint le maréchal Clausel, gouverneur de l’Algérie, à la retraite – et bientôt Bugeaud à la négociation avec Abd el-Kader (convention de la Tafna en mai 1837). La trêve sera de courte durée.
« Ou la conquête, ou l’abandon. » 2104
Thomas Robert BUGEAUD (1784-1849), Chambre des députés, 15 février 1840. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux
La politique algérienne de la France est trop hésitante, aux yeux du futur maréchal.
Le traité signé en 1837 entre Bugeaud et l’émir Abd el-Kader a été violé. La France y faisait pourtant d’importantes concessions, reconnaissant la souveraineté de l’« émir des croyants » sur près des deux tiers de l’Algérie et se contentant d’une occupation du littoral. Abd el-Kader a profité de la trêve pour se constituer une armée, proclamant en 1839 la guerre sainte contre les Français qui occupent l’Algérie depuis 1830. Le militaire met donc les politiques face à leurs responsabilités.
Bugeaud considère pourtant l’Algérie comme « le plus funeste des présents que la Restauration ait fait à la Révolution de juillet » , prônant l’occupation restreinte de quelques bases stratégiques, pour empêcher les raids barbaresques. Victor Hugo balaie ses réticences, entraînant la France sur la voie de la colonisation par l’émigration civile massive.
« Je crois que notre nouvelle conquête est chose heureuse et grande. C’est la civilisation qui marche sur la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde, c’est à nous d’illuminer le monde. Notre mission s’accomplit. Vous pensez autrement que moi, c’est tout simple. Vous parlez en soldat, en homme d’action. Moi je parle en philosophe et en penseur. »
Victor HUGO (1802-1885), Choses vues, 1847-1848 (posthume)
Impossible de juger sans commettre le péché d’anachronisme, trop fréquent en matière historique.
Le colonialisme est sans doute la source des plus grands malentendus historiques dans le monde – rappelons l’exception à la règle d’une colonisation heureuse, celle de la Gaule par les Romains après la victoire de César contre Vercingétorix.
À l’inverse, les problèmes liés à la colonisation de l’Algérie perdureront bien après la guerre d’Algérie et son indépendance (5 juillet 1962). Un exemple parmi tant d’autres dans le monde, l’Afrique restant le continent malheureusement exemplaire.
« Lorsque les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient la Bible et nous, la terre. Ils nous ont demandé de prier. Alors, nous avons fermé les yeux pour prier. Quand nous les avons rouverts, la situation s’était inversée. Nous avions la Bible et eux la terre. »
Jomo KENYATTA (1894-1978), premier président du Kenya et « père du peuple »
7 avril 1498 : le navigateur Vasco de Gama fait escale à Mombasa. Première présence européenne en Afrique de l’Est, sur les rivages maritimes de l’actuel Kenya. Au fil de l’histoire, la région côtière africaine bordant l’Océan Indien verra pousser et prospérer, sous l’influence des peuples navigateurs et commerçants (arabes, indiens, persans), des cités qui ont bâti leurs richesses à partir du trafic avec l’Inde, l’Asie mineure et l’Extrême-Orient.
Vasco de Gama fut chargé par son souverain de nouer des alliances avec les autorités swahilies pour soustraire aux Arabes le commerce lucratif des épices et des esclaves. Pendant les siècles, le commerce côtier sera dominé successivement par les Portugais et les Arabes omanais. Ces derniers vont passer la main à l’Angleterre, la puissance maritime montante du XIXe siècle dont les navires croisaient dans l’océan Indien depuis deux cents ans.
Le Kenya, devenu protectorat britannique, puis colonie anglaise en 1890, vécut une colonisation particulièrement brutale, marquée par des expropriations et des asservissements des populations locales. La résistance anticoloniale se radicalisa face à la lenteur des réformes politiques promises par les Britanniques, avec l’insurrection Mau-Mau en 1952-1956 et sa brutale répression. Le pays, indépendant depuis le 12 décembre 1963, est devenu une République en 1964. Jomo Kenyatta, ex-chef de l’opposition, est resté le « père du peuple » . Crise économique, corruption généralisée, stabilité politique bancale, guerres tribales, attaques terroristes, taux de criminalité particulièrement élevé dans les grandes villes… Le Kenya doit affronter tous ces problèmes, à commencer par la « génération Z » , jeunes gens plus éduqués mais devant recourir au « secteur informel » (plus de 80% des emplois, mal rémunérés, sans sécurité ni prestige social).
46. Charles X, dernier roi de France… oui mais remplacé par le « roi des Français » , Louis-Philippe sous la Monarchie de juillet.
« Mettez en note que le 29 juillet 1830, à midi cinq minutes, la branche aînée des Bourbons a cessé de régner sur la France ! » 2029
TALLEYRAND (1754-1838). L’Esprit de M. de Talleyrand : anecdotes et bons mots (1909), Louis Thomas
Travaillant à ses Mémoires, il entend les troupes de Marmont qui refluent sous ses fenêtres, rue de Rivoli – le Louvre est pris par les insurgés, les soldats se débandent. Le vieux pair de France, qui a vécu tous les tournants de l’histoire depuis la Révolution et survécu à tant d’épreuves, s’interrompt et dicte cette note à son secrétaire.
Ce même jour, les députés font cause commune avec le peuple. C’est la « Troisième Glorieuse » de cette brève Révolution.
« Charles X a essayé de sauver la légitimité française et avec elle la légitimité européenne : il a livré la bataille et il l’a perdue […] Napoléon a eu son Waterloo, Charles X ses journées de juillet. » 2030
François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
Le 30 juillet, Charles X retire les ordonnances. Trop tard. Thiers et Mignet font placarder un manifeste orléaniste. Louis-Philippe attend son heure, patiemment, prudemment réfugié à Neuilly, puis au Raincy. Tandis que La Fayette, septuagénaire actif, est de retour pour son dernier rendez-vous avec l’Histoire, de nouveau à la tête de la garde nationale rétablie, qui occupe l’Hôtel de Ville : on hisse le drapeau tricolore.
« Habitants de Paris ! Charles X a cessé de régner sur la France ! » 2031
Proclamation de la Commission municipale, 30 juillet 1830. Bulletin des lois et ordonnances : publiées depuis la Révolution de juillet 1830, volume I (1849), Dupont éd
C’est un véritable gouvernement provisoire qui a été constitué par le banquier Laffitte et Casimir Périer. Seul suspense, qui va l’emporter, de la République ou de la branche orléaniste ?
« L’opposition […] peut perdre autant de batailles qu’elle en livre, il lui suffit, comme les alliés en 1814, de vaincre une seule fois. Avec « trois glorieuses journées » , enfin, elle détruit tout. » 2032
Honoré de BALZAC (1799-1850), Le Député d’Arcis (posthume, 1854)
La crainte d’un régime vraiment démocratique va pousser la majorité des députés de l’opposition, représentants d’une bourgeoisie libérale, aisée, éclairée, mais pas vraiment révolutionnaire, à « escamoter » la République et opter pour l’ordre. Le National propose de nommer roi le duc d’Orléans, « prince dévoué à la cause de la Révolution » . Toute l’ambiguïté du nouveau régime est déjà là, dans ce recours à un « roi citoyen » .
« La Charte sera désormais une vérité. » 2033
LOUIS–PHILIPPE (1773-1850), Proclamation aux habitants de Paris, 31 juillet 1830. Révolution française : histoire de dix ans, 1830-1840 (1846), Louis Blanc
Le texte de la proclamation est de Guizot. Celui qui est encore le duc d’Orléans prend le même jour le titre de lieutenant général du royaume. Mais il lui faut l’aval du peuple. Il se rend donc à l’Hôtel de Ville où l’attend La Fayette, redevenu populaire comme aux grandes heures de la Révolution.
« Voilà ce que nous avons pu faire de plus républicain. » 2034
LA FAYETTE (1757-1834), Hôtel de Ville, 31 juillet 1830. La Fayette et la révolution de 1830 : histoire des choses et des hommes de Juillet, volume I (1832), Bernard Alexis Sarrans
Rallié à la cause du duc d’Orléans, il lui donne l’accolade et fait de lui le futur « roi des Français » .
« Puisqu’ils ne veulent pas de moi, qu’ils se débrouillent ! » 2035
Duc d’ANGOULÊME (1775-1844), dernier dauphin de l’histoire de France, château de Rambouillet, 2 août 1830. La Duchesse de Berry (1963), André Castelot
Charles X, replié à Rambouillet, vient d’accepter la nomination du duc d’Orléans comme lieutenant général du royaume et régent. Plus ou moins forcé, il abdique en faveur de son petit-fils (10 ans), le duc Henri de Bordeaux. Il signe l’acte, tend la plume à son fils aîné, Louis de France, devenu Louis XIX le temps du règne le plus court de l’histoire de France – quelques secondes d’hésitation, car il pourrait tenir pour nulles les décisions de son père et garder la couronne.
Il choisit d’abdiquer à son tour en faveur de son neveu, le duc de Bordeaux, qui devient Henri V pour les légitimistes – et attendra 1871 pour faire valoir ses droits à la couronne.
« Le Dey. — Je conviens que Charles Dix
Des guerriers est le phénix,
Il combat les Algériens
En mêm’ temps qu’les Parisiens.
Charles X. — Pour rentrer dans mon Paris
Si nous n’étions pas enn’mis,
J’aurais réclamé d’tes soins
Une patrouill’ de Bédouins.
Refrain
Ça va mal, sort fatal,
Adieu le trône royal,
C’est égal,
Nous vivons, c’est l’principal. » 2036Auguste JOUHAUD (1806-1888), À ton tour Paillasse (1830), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
La chanson, incluse dans une pièce en trois journées, en vers et en prose, réunit en un duo ironique les deux souverains qui perdent leur trône en même temps.
Le 3 août, Charles X fuit, épouvanté par le bruit que fait courir le maréchal Marmont (commandant l’armée royale, désormais acquis à Louis-Philippe) : 100 000 Parisiens armés seraient à ses trousses. En fait, partis 30 000, ils arrivent moins de 1 000 à Rambouillet, mais l’armée royale (près de 13 000 hommes) se replie. Charles X reprend le chemin du dernier exil. Les Bourbons ont fini de régner en France.
« Louis-Philippe était un homme rare […] très premier prince du sang tant qu’il n’avait été qu’altesse sérénissime, mais franc bourgeois le jour où il fut majesté. » 2055
Victor HUGO (1802-1885), Les Misérables (1862)
Roi-citoyen amené au pouvoir par une révolution, roi des barricades à la tête d’une monarchie bourgeoise qualifiée de « meilleure des républiques » par certains, Louis-Philippe réunit quelques-unes des ambiguïtés dont vivra et mourra ce régime.
47. Le Génie de la Bastille (ou de la Liberté) surmontant la Colonne de juillet place de la Bastille honore les morts… d’une autre révolution : les « Trois Glorieuses » journées de juillet 1830.
« Ils sont perdus. Ils ne connaissent ni le pays ni le temps. Ils vivent en dehors du monde et du siècle ! » 2022
Maréchal de MARMONT (1774-1852), à la tête des troupes royales, 26 juillet 1830. Mémoires de la comtesse de Boigne (posthume, 1909)
Cet excellent militaire est à la tête des troupes royales, soit 10 000 hommes, face aux 25 000 insurgés : 20 000 membres de la garde nationale dissoute en juillet 1827, mais qui ont gardé leurs armes, et 5 000 républicains qui ont pillé les armureries. Le combat est trop inégal, donc perdu d’avance.
« Le régime légal est interrompu, celui de la force a commencé […] L’obéissance cesse d’être un devoir. » 2023
Le National, 26 juillet 1830. Les Polémistes français depuis 1789 (1962), Pierre Dominique
Ce journal parisien d’opposition constitutionnelle, fondé par Thiers, Mignet et Carrel en janvier 1830, est financé par le banquier Jacques Laffitte, député libéral dont l’hôtel est l’un des principaux foyers de l’insurrection de juillet. Les trois journalistes dénoncent l’illégalité des ordonnances.
Le lendemain 27 juillet, les journaux interdits paraissent, mais sont saisis. C’est la première des « Trois Glorieuses » . Paris se soulève : ouvriers typographes réduits au chômage, étudiants, puis le mouvement s’étend, le peuple du faubourg Saint-Antoine marche sur l’Hôtel de Ville, bientôt le Louvre, les Tuileries. Les troupes de Marmont sont dépassées.
« Les révolutions sont de magnifiques improvisatrices. Un peu échevelées quelquefois. » 2024
Victor HUGO (1802-1885), Choses vues, 1830 (posthume)
Avec lui, tous les jeunes romantiques se retrouvent dans l’opposition. Hugo a 28 ans. C’est l’un des plus ardents. Et c’est le début d’une belle et longue vie politique, menée parallèlement à sa carrière littéraire. On peut le comparer à Chateaubriand, son modèle proclamé : « Je veux être Chateaubriand ou rien » (Lettre de 1821).
« J’ignore, Sire, si je suis toujours un oiseau de mauvais augure, mais il est décidé que je serai toujours un oiseau des temps d’orage, et celui qui tonne sur nos têtes prend un aspect formidable. » 2025
Baron de VITROLLES (1774-1854), au roi Charles X, château de Saint-Cloud, 28 juillet 1830. 1830, la révolution tricolore (1965), Jean Louis de Courson
Deuxième Glorieuse : Paris, dès le matin, construit ses barricades pour faire obstacle aux forces de l’ordre.
Vitrolles, ambassadeur et pair de France, représentant des ultras, est enfin reçu par Charles X : il tient toujours à ses quatre ordonnances et refuse la proposition du baron, d’aller discuter avec les chefs de l’insurrection parisienne. Ce serait perdre la face, pour le roi qui ne comprend pas qu’il va perdre son trône.
« Peuple français, peuple de braves,
La liberté r’ouvre ses bras.
On nous disait : « Soyez esclaves » ,
Nous avons dit : « Soyons soldats » .
Soudain Paris dans sa mémoire
A retrouvé son cri de gloire. » 2026Casimir DELAVIGNE (1793-1843), La Parisienne (1830), chanson. Recueil de chants patriotiques et guerriers dédiés aux braves Suisses qui prennent les armes pour défendre la patrie (1838)
Poète et auteur dramatique en renom, rival des romantiques sur la scène, mais libéral convaincu en politique, il écrit cette œuvre de circonstance aux accents révolutionnaires : La Parisienne fait écho à La Marseillaise.
« La troupe fraternise avec le peuple.
— Eh bien, il faut tirer aussi sur la troupe ! » 2027Réponse du prince de POLIGNAC (1780-1847), chef du gouvernement, au chef d’escadron Delarue, 28 juillet 1830. Révolution française : histoire de dix ans, 1830-1840 (1846), Louis Blanc
Dès le 27 juillet, deux compagnies des troupes royales, bombardées de jets de pierre, sont passées aux émeutiers. Le 28, dans Paris hérissé de barricades, Marmont résiste encore, tant bien que mal, avec ses 10 000 hommes. Il reçoit enfin des ordres précis du roi, toujours à Saint-Cloud : concentrer ses troupes autour des Tuileries et du Louvre. Il abandonne aux insurgés tous les quartiers de l’est et du nord de Paris.
« La dernière raison des rois, le boulet. La dernière raison des peuples, le pavé. » 2028
Victor HUGO (1802-1885), Littérature et philosophie mêlées (1834)
29 juillet 1830, c’est la « Troisième Glorieuse » de cette brève Révolution.
Les Trois Glorieuses se soldent officiellement par 504 morts – répertoriés sur la colonne de la place de la Bastille à Paris, dite « colonne de Juillet » . Bilan sans doute sous-estimé, d’autres études avancent le chiffre de 788 tués chez les insurgés et 163 morts du côté des soldats. Près de 4 000 personnes ont été blessées.
L’histoire de France est ponctuée de « journées des Barricades » – murailles vite improvisées, faites de pavés, de galets, de poutres, construites par le peuple pour barrer la route aux troupes organisées, chargées du maintien de l’ordre. La première Journée remonte à la Sainte Ligue (catholique), qui tenait Paris en 1588. En 1649, c’est la Fronde, où l’on a beaucoup joué avec les pavés. La Révolution de 1830 dépave les rues de Paris, durant ces Trois Glorieuses. Les pavés reprendront du service avec la Révolution de 1848, la Commune de Paris en 1871, la plus sanglante guerre des pavés – Hugo sera encore témoin. Au XXe siècle, Paris vivra deux séries de journées où les rues se hérissent à nouveau de barricades et de pavés, qui font également projectiles : à la Libération en 1940, et en mai 1968. Entre les deux, la « semaine des Barricades » , en janvier 1960, à Alger. Le pavé servira de moins en moins, les rues de Paris et de toutes les grandes villes étant recouvertes de macadam.
« Charles X a essayé de sauver la légitimité française et avec elle la légitimité européenne : il a livré la bataille et il l’a perdue […] Napoléon a eu son Waterloo, Charles X ses journées de juillet. » 2030
François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)
Le 30 juillet, Charles X retire les ordonnances. Trop tard. Thiers et Mignet font placarder un manifeste orléaniste. Louis-Philippe attend son heure, patiemment, prudemment réfugié à Neuilly, puis au Raincy. Tandis que La Fayette, septuagénaire actif, est de retour pour son dernier rendez-vous avec l’Histoire, de nouveau à la tête de la garde nationale rétablie, qui occupe l’Hôtel de Ville : on hisse le drapeau tricolore.
48. « Enrichissez-vous … » : citation tronquée de Guizot sous la Monarchie de Juillet, désinformation volontaire.
« Enrichissez-vous. » 2114
François GUIZOT (1787-1874), Chambre des députés, 1er mars 1843. Histoire parlementaire de France : recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1848 (1864), François Guizot
Ministre des Affaires étrangères, et pratiquement chef du gouvernement, son mot est souvent cité pour condamner ses conceptions politiques, et résumer l’esprit égoïstement bourgeois de la Monarchie de Juillet. Exemple type de désinformation par utilisation d’une citation tronquée.
Rappelons le contexte. Guizot répond aux attaques de l’opposition : « Fondez votre gouvernement, affermissez vos institutions, éclairez-vous, enrichissez-vous, améliorez la condition morale et matérielle de notre France. » Il reprend le mot lors d’un banquet, la même année : « Enrichissez-vous par le travail, par l’épargne et la probité, et vous deviendrez électeurs. » (Le droit de vote était conditionné par un seuil d’imposition, le cens.)
Louis-Philippe approuve les idées de son ministre : « C’est ma bouche » , dit-il.
49.« L’Empereur, vous n’avez rien de lui ! » : Napoléon III n’a existé que par cette illustre parenté, mais le doute existera toujours.
« Laissez le neveu de l’empereur s’approcher du soleil de notre République ; je suis sûr qu’il disparaîtra dans ses rayons. » 2181
Louis BLANC (1811-1882). Histoire parlementaire de l’Assemblée nationale, volume II (1848), F. Wouters, A.J.C. Gendeblen
Comme quoi un bon historien peut faire gravement erreur sur son temps ! C’est la République qui va bientôt disparaître devant l’Empire restauré. Il est vrai que les premiers témoins n’ont pas cru dans le destin du nouvel homme qui paraît particulièrement falot.
Louis Blanc fait ici allusion à une déclaration du candidat empruntant au lyrisme hugolien : « L’oncle de Louis-Napoléon, que disait-il ? Il disait : « La république est comme le soleil. » »
Le « peuple chansonnier » se méfie publiquement, sous la Deuxième République… avec allusion à son séjour de prisonnier en Angleterre, sa bonne éducation en Suisse… et ses accessoires vestimentaires rappelant l’illustre ancêtre.
« Je suis Corse d’origine,
Je suis Anglais pour le ton,
Suisse d’éducation
Et Cosaque pour la mine […]
J’ai la redingote grise,
Et j’ai le petit chapeau ;
Ce costume est assez beau,
On admire cette mise.
Seul le génie est absent
Pour faire un bon président. » 2188Complainte de Louis-Napoléon pour compléter sa profession de foi (1848), chanson. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier
Il dut souffrir de toutes ces chansons qui le brocardèrent, déjà en « Ratapoil » , bientôt en « Badinguet » et autres surnoms. Selon Hugo : « Peu lui importe d’être méprisé, il se contente de la figure du respect » (Napoléon le Petit).
Bien que chansonné et ridiculisé, sous-estimé, malmené, le candidat à la présidence de la République a toutes ses chances : porté par la légende napoléonienne qui enchante le peuple et l’a déjà fait député, il rassure les bourgeois qui ont vu de près le « péril rouge » , lors des dernières émeutes républicaines.
« Le citoyen Bonaparte élu président de la République » : résultats du scrutin des 10 et 11 décembre 1848, proclamés lors d’une séance solennelle à l’Assemblée. Triomphe pour le « citoyen Bonaparte » , élu au suffrage universel par 75 % des votants, (5,5 millions de voix) ! Déroute de Lamartine, héros des premiers jours de février, qui n’était plus candidat que de lui-même (17 914 voix). Les voix républicaines se sont dispersées entre Cavaignac (1,4 million de modérés), Ledru-Rollin (370 000 démocrates) et Raspail (moins de 37 000 socialistes révolutionnaires), trois candidats relativement ignorés hors Paris et la minorité éclairée.
« On craint une folie impériale. Le peuple la verrait tranquillement. » 2200
Élise THIERS (1818-1880), née Dosne. Napoléon III (1969), Georges Roux
L’épouse de Thiers témoigne, ayant vu Louis-Napoléon Bonaparte passer en revue les troupes le 4 novembre 1849. Le président est particulièrement populaire dans l’armée : il multiplie les grandes revues, augmente la solde des sous-officiers. Celui qu’on commence à appeler le « prince Louis-Napoléon » mène une politique personnelle, se fait acclamer en province, crée son propre parti, ses journaux. Les craintes de Mme Thiers sont justifiées et la carrière de son mari marquera un temps d’arrêt sous le Second Empire.
Et Louis-Napoléon, président de la République bien élu, va oser le coup d’État lui permettant de garder le pouvoir malgré la Constitution.
« La France a compris que je n’étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit. Plus de sept millions de suffrages viennent de m’absoudre… » 2220
Louis-Napoléon BONAPARTE (1808-1873), plébiscité les 21 et 22 décembre 1851. Napoléon III (1998), Georges Bordonove
Le pays (au suffrage universel rétabli) approuve massivement le coup d’État du 2 décembre 1851 : 7 439 216 oui contre 640 737 non. Mais c’est un scrutin sous haute surveillance et l’opinion publique est manipulée.
Louis-Napoléon avait choisi le jour anniversaire d’Austerlitz, 2 décembre 1805, jour de gloire pour Napoléon. Il a voulu personnellement et ardemment ce coup d’État, mais il en ressentira plus tard une réelle culpabilité : c’est sa « tunique de Nessus » , dira l’impératrice Eugénie. Un an après, il va asseoir son pouvoir impérial…
« Représentant à tant de titres la cause du peuple et la volonté nationale, ce sera la nation qui, en m’élevant au trône, se couronnera elle-même. » 2231
Louis-Napoléon BONAPARTE (1808-1873), Sénat, 4 novembre 1852. Recueil général des lois, décrets et arrêtés (1853)
Le message du prince-président s’adresse à la nation, invitée à un nouveau plébiscite. Les 21 et 22 novembre, la nation répondra massivement oui : 7,8 millions de voix, contre 250 000 non.
Émile Zola explique les raisons de ce triomphe : « La société, sauvée encore une fois, se félicitait, se reposait, faisait la grasse matinée, maintenant qu’un gouvernement fort la protégeait et lui ôtait jusqu’au souci de penser et de régler ses affaires. La grande préoccupation de la société était de savoir grâce à quels amusements elle allait tuer le temps […] Paris se mettait à table et rêvait gaudriole au dessert. »
Mais Louis-Napoléon Bonaparte est surtout porté par la magie du nom qu’il porte. À tort ou à raison ?
« L’Empereur, vous n’avez rien de lui !
— Tu te trompes, mon cher, j’ai sa famille. » 2269NAPOLÉON III (1808-1873) à son cousin germain Jérôme-Napoléon Bonaparte (1856). Histoire de la France, volume II (1958), André Maurois
Jérôme-Napoléon, dit Prince Napoléon, fils de Jérôme Bonaparte (frère de Napoléon Ier) et frère de la princesse Mathilde, mettait ainsi en doute l’ascendance paternelle de l’empereur. Non sans quelques raisons…
Sa mère, Hortense de Beauharnais (fille de l’impératrice Joséphine), avait eu avant sa naissance en 1808 bien des amants : un écuyer, son premier chambellan qui était comte, un marquis, un amiral hollandais… Les historiens ignoreront toujours si Napoléon III est bien le fils de son père Louis Bonaparte, roi de Hollande. Une seule chose est sûre : le doute devait empoisonner l’empereur.
Une nouvelle hypothèse porterait le soupçon sur « Madame Mère » , mère de Napoléon – et grand-mère de Napoléon III. Charles Bonaparte épouse à 18 ans Letizia Ramolino âgée de treize ans. La jeune femme réputée pour sa beauté est rapidement mère et Napoléon naît le 15 août 1769 à Ajaccio. La rumeur défendue par Hervé le Borgne et Edmond Outin sur une liaison adultérine avec Letizia ferait du comte de Marbeuf le père de Napoléon Bonaparte. Hypothèse démentie par les analyses ADN.
Sa famille n’était pas davantage un cadeau, surtout ce cousin germain, chef de la branche cadette, parfois appelé Napoléon V et surnommé Plon-Plon (diminutif affectueux de sa mère, devenu ridicule avec l’âge), qui affiche ses convictions anticléricales et jacobines. L’empereur se méfie de ce « César déclassé » , impulsif et velléitaire, en état de fronde perpétuelle. Mais la famille, c’est la famille.

