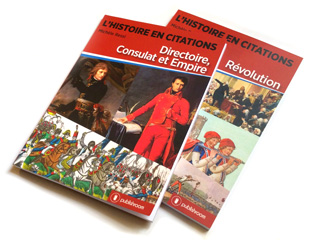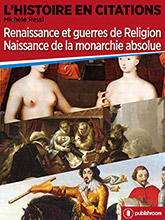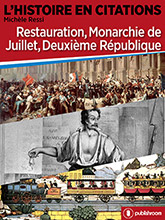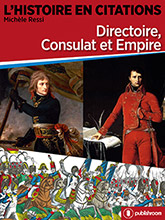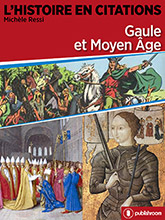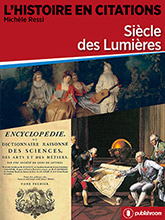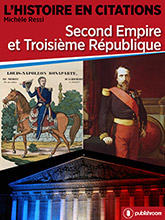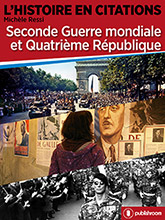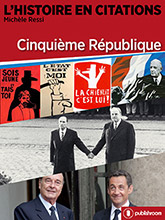Les punchlines (de la Gaule à la Révolution française)
Parole, c’est historique !
Punchline : anglicisme désignant une phrase portant un message fort ou choc (Wikipédia).
En VO : “The final phrase or sentence of a joke or story, providing the humour or some other crucial element.” (Oxford Languages)
Absent du Larousse de la langue française, le mot figure dans le dictionnaire bilingue français/anglais : il est traduit sous le terme de « fin (d’une plaisanterie) ». Il s’applique à une réplique (en anglais : line) comique et percutante (en anglais : punchy), constituant la « chute » d’une histoire drôle ou d’un dialogue de comédie.
On peut finalement traduire par « mot choc ».
Quoiqu’il en soit, la chose existe bien avant le mot !
En exagérant à peine, disons que l’esprit gaulois a inventé la punchline. Elle s’est diversifiée au Moyen Âge, s’adaptant à maintes circonstances politiques, militaires, sociales, avant de devenir un moyen d’expression très français, sous la Renaissance. Chaque période en a usé, la Révolution est en cela exemplaire, qui rebondit de punchline en punchline héroïques. L’Empire continue sur cette lancée, mais toute l’histoire contemporaine se complaît dans ce genre de joute verbale dont les Républiques usent et abusent.
Au final, une bonne moitié de l’Histoire en (3500) citations se joue en punchline.
Cet édito en huit épisodes vous en donne un échantillon au 1/10eme.
Sur le podium des punchlineurs, on retrouve les trois auteurs-acteurs les plus cités : Napoléon, de Gaulle, Hugo. Clemenceau se présente en outsider surdoué sous la Troisième, avec Gambetta dans un autre style. Invités surprise, Louis XVIII et Napoléon III, pour leur humour en situation. Nos derniers présidents arrivent en bonne place, sous la Cinquième : humour franchouillard et décomplexé de Chirac, franc-parler popu et brutalité viscérale de Sarkozy.
Enfin, « le peuple » se trouve au rendez-vous de tous les mouvements de fronde, de révolte ou de contestation, en chansons et slogans le plus souvent anonymes, héros majeur sous la Révolution, acteur talentueux de Mai 68.
Peut-on définir les punchlines à la française, malgré leur extrême diversité ?
Ce sont souvent des mots brefs, empruntés à l’Histoire en (1000) tweets, dans le « Bonus » de notre site. Certains mots « jokers » sont réutilisables à volonté, d’autres étant devenus proverbes.
L’humour, l’ironie sont des atouts majeurs, y compris dans les moments dramatiques. Le ton souvent agressif, menaçant, tueur, cynique, se fait bienveillant, optimiste et philosophique au siècle des Lumières.
Les punchlines relèvent de toutes les formes historiques : discours, appel, proclamation, correspondance, mot de la fin, poème, loi, pamphlet, slogan, chant et chanson, devise, dicton, titre dans la presse à partir du XIXe siècle.
L’improvisation dans le feu de l’action alterne avec la réflexion. Les meilleurs mots sont « en situation » : révolte, révolution, guerre, ou discours à la tribune, chef militaire parlant à ses troupes.
En résumé, c’est l’Histoire plus vivante que jamais qui vous parle de la condition humaine.
Toutes ces punchlines sont tirées de l’Histoire en citations et apparaissent dans le même ordre chronologique, avec leurs commentaires plus ou moins détaillés.