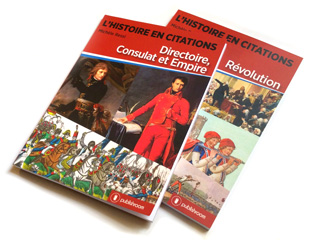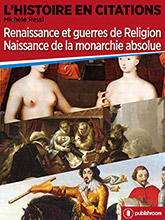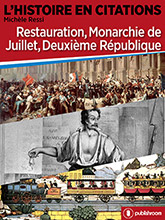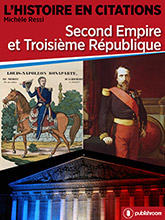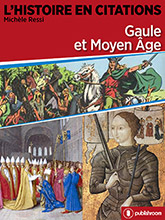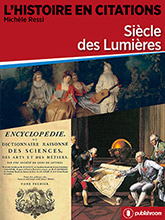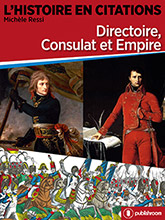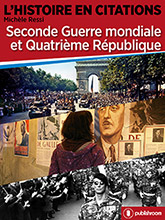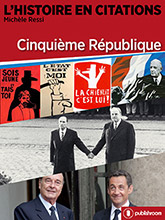Cette lecture proposée a une triple actualité. En plus du semi-confinement et des librairies fermées, le climat socio-politique est à la polémique citoyenne, cependant que les caricatures de presse font débat (et procès), parallèlement à la liberté d’expression.
Pamphlets et autres œuvres polémiques (II).
Ces textes critiques à visée plus ou moins révolutionnaire, partisane, politique ou sociale, sont typiques du Siècle des Lumières. Mais le genre pamphlétaire qui existe depuis le Moyen Âge se prolonge avec plus ou moins de talent jusqu’à nos jours. Faut-il en conclure que l’attaque violente visant un personnage politique ou les institutions du pays serait dans les gènes du Français ?
La plupart de ces textes ont défié la censure et/ou l’ordre établi en leur temps. Certains peuvent choquer aujourd’hui encore par leur violence : perversions sexuelles au XVIIIe (sadisme), slogans anarchistes (fin XIXe) ou attaques personnelles dues à l’antisémitisme de l’extrême-droite dans l’entre-deux-guerres.
Pas d’œuvre majeure sous la Révolution, mais la période peut être analysée comme un vivant pamphlet tout en actes et paroles, actions et réactions, slogans et chansons ! L’Empire exerce ensuite une censure quasi-parfaite.
Malgré la censure variable selon les régimes successifs, l’activité intellectuelle reprend ses droits au fil du XIXe siècle et le pamphlet s’affiche en tant que genre, prenant aussi la forme de chansons (désormais signées), caricatures (Daumier), articles de presse (Alphonse Karr). Dans ses Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand l’éternel opposant affirme son génie.
Hugo frappe juste et fort contre Napoléon III, brocardé en Napoléon le Petit (1852) et Rochefort profite d’une relative liberté de la presse à la fin du Second Empire.
La Troisième République permet tous les pamphlets, le féminisme en profite, l’extrême-droite en use et abuse avec Maurras, Céline, Brasillach durant la dernière guerre. Certains propos seraient aujourd’hui interdits, même si la censure est abolie : « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». La loi de 1881 a été modifiée plusieurs fois pour encadrer cette liberté eu égard au respect de la personne, la protection des mineurs, la répression de l’injure, la diffamation ou l’atteinte à la vie privée.
Sous la Quatrième et la Cinquième Républiques, la provocation a (presque) tous les droits et les slogans de Mai 68 pousseront très loin le jeu (avec ou sans humour). Dans le flot des actes, des paroles et des écrits dont on peut juger au coup par coup, retenons deux cas politiques exemplaires. Le Coup d’État permanent (1964), pamphlet anti-gaulliste revendiqué comme tel par François Mitterrand : la taille de l’adversaire lui donne un talent qu’il se plaît à reconnaître. Tout aussi personnel et polémique, le franc-parler de Chirac et son humour « brut de décoffrage » valent souvent provocation. D’autres noms s’illustrent avec talent dans le genre : Coluche, Desproges, Le Luron, Topor.
Nous ne parlerons pas de l’agressivité souvent dénoncée des réseaux sociaux, qui entre dans l’histoire contemporaine. On retourne à l’anonymat d’antan et à l’impunité quasi-totale, mais la violence ne vaut pas talent et ne fait pas sens.