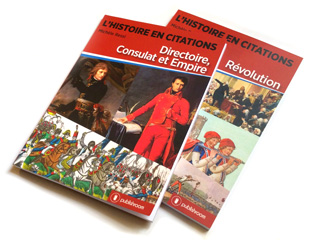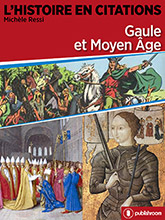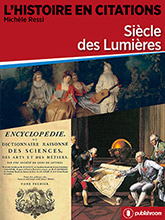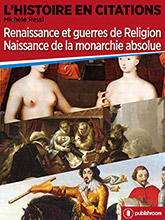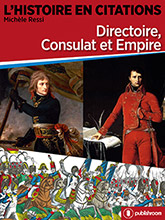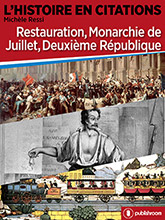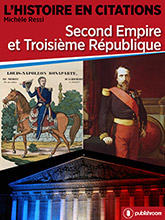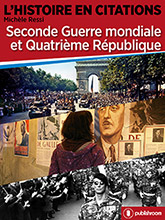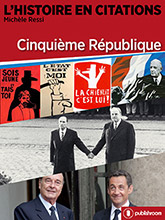Bonaparte : « C’est en me faisant catholique que j’ai fini la guerre de Vendée... »
Consulat. Chronique
Pragmatisme et réalisme prévalent en politique intérieure et extérieure.
Le traité d’Amiens avec l’Angleterre (25 mars 1802) met fin aux guerres de la deuxième coalition et peut faire croire à une paix durable. Agriculture, industrie et commerce redeviennent prospères.
Bonaparte travaille infatigablement à réformer la France. Il signe le Concordat avec le pape (15 juillet 1801) pour régler la question religieuse. Il crée la décoration nationale de la Légion d’honneur, sûr que « c’est avec des hochets que l’on mène les hommes ». Il s’emploie aussi à réformer : système d’éducation, administration, monnaie, fiscalité, droit. Il prépare le futur Code civil…